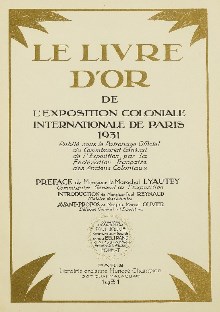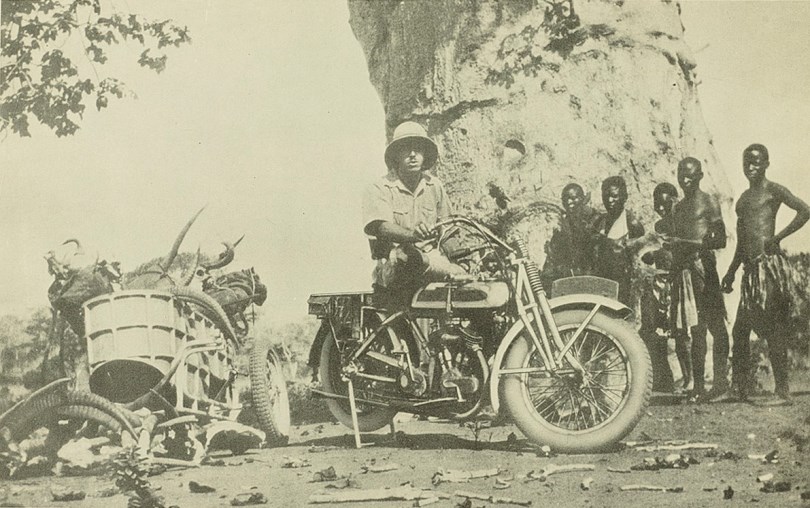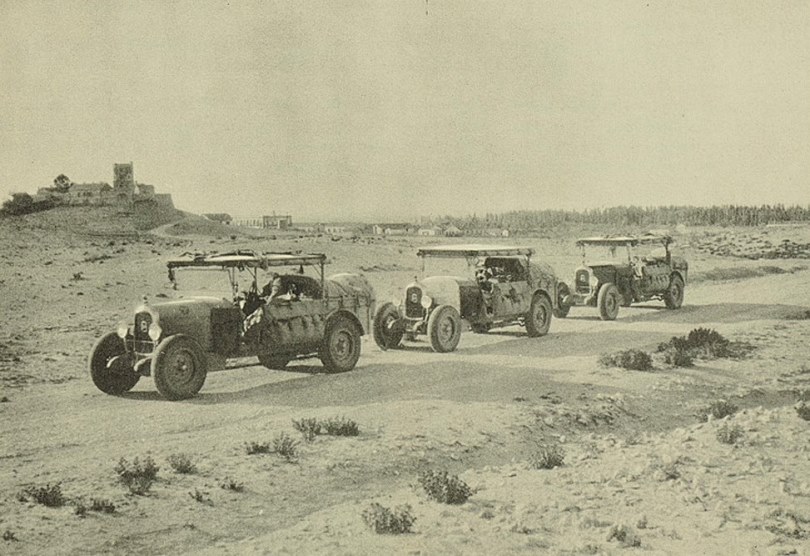Depuis
quelques années, les traversées du désert
en automobile se multiplient. Et ce n'est pas une des moindres
singularités de notre époque que de voir cités
fréquemment comme des sites bien connus, sinon comme
des buts d'excursion, les noms prestigieux de Tombouctou et
de Gao. Nous apprendrons bientôt qu'il y aura une circulation
à sens unique à Tombouctou la Mystérieuse....
Sans préjuger de la réalisation hypothétique
du chemin de fer transsaharien, l'on peut dire que l'usage
raisonné de l'automobile tend à résoudre
d'une façon pratique le problème de la traversée
du désert.
Les premiers essais furent faits en partant de l'idée
qu'un système spécial et approprié de
moyens de propulsion était indispensable pour permettre
à l'auto de circuler sur les pistes sahariennes. Mais
ni les tracteurs agricoles à Caterpillars du système
Baby Holt, que leur formidable consommation d'essence fit
rapidement abandonner, ni les chenilles souples des Citroën-Kégresse
(qui pourtant parvinrent les premiers à Tombouctou
avec l'expédition Audoin-Dubreuil), ne donnèrent
une solution commerciale de la question. L’utilisation
du pneu allait permettre de progresser rapidement. L'expédition
Renault, dont les voitures étaient équipées
avec six roues jumelées, équipées en
pneus de gros diamètre à basse pression, atteignit
le Niger en 119 heures de route, se jouant des dunes, des
ergs et des regs.
On ne tarda pas à s'apercevoir que les possibilités
du pneu à basse pression sont bien supérieures
à ce que l'on avait espéré, et qu'il
n'est pas nécessaire de recourir à des équipements
anormaux pour aborder les pistes. Celles-ci sont d'ailleurs
améliorées en certains points de leur parcours.
Quelques trous sont remblayés, quelques seuils adoucis,
quelques bosses trop menaçantes nivelées, mais
il ne s'agit là bien entendu, que de points isolés.
Dans son ensemble, la piste reste ce qu'elle est. Il n'est
pas question de la macadamiser ni de la cimenter.
Après la voiture à chenilles qui a ouvert la
voie, et la voiture à multiples roues jumelées
qui établit la transition, le jour de la voiture normale
est arrivé.
Et les raids succèdent aux raids.

Débarquement des voitures à Alger
Pendant
l'hiver 1928-29, le prince Sixte de Bourbon-Parme emmène
d'Alger au Tchad son équipe tricolore des trois Delahaye
11 CV, camionnettes de séries analogues à celles
qui effectuent quotidiennement des livraisons dans Paris.
Les pneus étaient seulement de gros diamètre
: 910 x 212. Mille deux cents kilomètres sont ainsi
parcourus sans incidents.
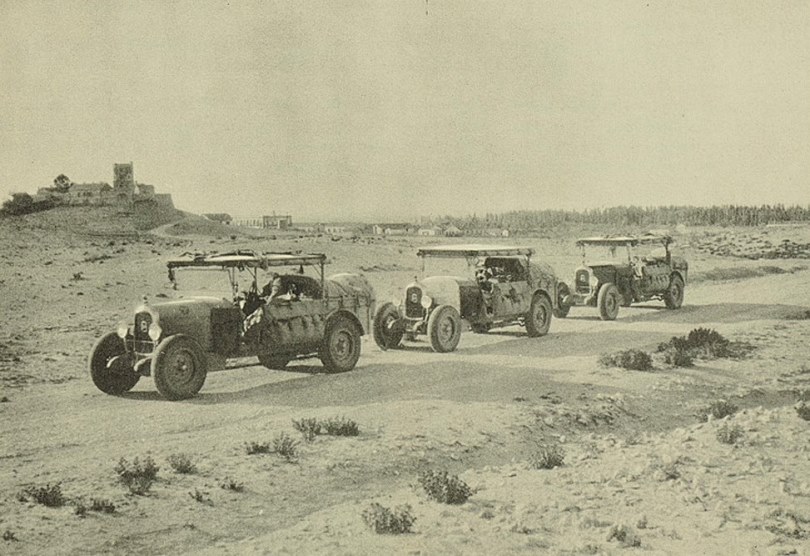
Raid Dunlop Delahaye Transsaharien
À
la même époque, le lieutenant Loiseau effectue
un raid analogue, mais dans un tout autre esprit. Il ne cherche
pas à reconnaitre comme le prince Sixte une grande
voie commerciale, mais à établir la possibilité
de vitesse sur une piste en partie connue. Il part donc à
la tête d'une équipe de cinq 10 CV Bugatti, auxquelles
le seul reproche qu'il adresse est d’être trop
lourdement chargées : 800 kilogrammes par voiture.
Malgré cet excès de poids, l'oiseau s'envole
vers Cao, roulant parfois à 110 à l'heure, traverse
le Niger, pousse jusqu'à Ouagadougou, capitale de la
Haute Volta, et revient ayant parcouru 10 500 kilomètres
sans le moindre accroc que la rupture de tuyaux d'essence
due aux effroyables cahots subis par ces voitures.
La mission Peugeot-Proust, pendant l'hiver 1929-30, accomplit
un périple qui fait pendant à celui du prince
Sixte, ayant pour objectif non plus le Tchad, mais l'Atlantique.
La particularité de ce raid est d'être effectué
par une équipe très disparate, quatre voitures
de série, mais de séries différentes
: une 18 CV, une 12 CV commerciale, une 12 CV de tourisme
et une 6 CV 201. Même succès : beaucoup d'anecdotes,
mais pas d'histoire. Et les pneus ne font pas parler d'eux.
Et, quoique disparate, l'équipe reste étroitement
groupée de bout en bout.
Nous n'avons mentionné là que les expéditions
les plus typiques. La place nous manque malheureusement pour
les décrire toutes. Citons seulement la promenade soudanaise
et équatoriale des camions gazogènes Panhard
et Levassor, le raid du lieutenant Estienne, etc....
Aujourd'hui, le trafic saharien est entré dans l'ère
des réalisations commerciales, des compagnies puissantes
se sont créées, qui exploitent des lignes régulières
à l'aide de véhicules appropriés dont
certains sont fort luxueux.
Le succès, somme toute, est venu le jour où
les voitures ont pu chausser les pneus appropriés.
Ces pneus doivent être à gros volume d'air et
à basse pression pour présenter à la
fois une grande souplesse et une large surface d'appui. Ils
doivent être à tringles pour résister
victorieusement aux réactions d'accrochement latéral,
fréquentes sur des sols ni sablonneux ni rocailleux
où une glissade transversale s'arrête souvent
sans douceur sur un obstacle résistant. Ils doivent
être constitués d'une gomme de premier ordre
résistant aux alternatives de brûlure et de gel
ainsi qu'à l'action destructrice du sable. Nous avons
demandé à Dunlop (auquel s'adressent tous les
constructeurs qui organisent des expéditions sahariennes,
même s'ils ne sont pas clients habituels de cette marque,
et aussi tous les exploitants de services automobiles africains)
de bien vouloir nous révéler le secret du pneu
saharien. Dunlop nous a répondu qu'il n'y avait pas
de pneu saharien mais que les bons pneus, fait de bonne gomme
et de bon coton étaient également aptes à
tous les services.
Rien d'étonnant, dans ces conditions à ce que
l'on soit maintenant habitué à réunir
dans une même pensée celle des difficultés
vaincues de la traversée du désert, et celle
de l'utilisation des pneus Dunlop.