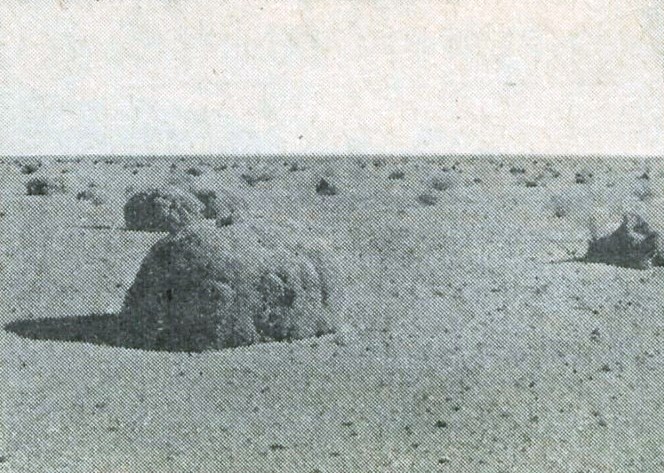Dans
le cadre provincial du vieux Jardin des Plantes à
Paris, figurez-vous un laboratoire paisible, encombré
de bocaux où baignent des poissons conservés
dans l’alcool. C’est là que je vais trouver
mon ami Théodore Monod, l’explorateur saharien
qui vient de passer quinze mois au désert (il en
est à son sixième voyage en Afrique depuis
1922) et qui en a rapporté des documents scientifiques
nombreux sur la géologie, l’ethnographie et
la préhistoire du Sahara.
À
quoi ça ressemble, un désert ?
Monod vient de publier un livre dont je vous recommande
la lecture, car il est aussi pittoresque que passionnant,
Méharées, explorations au vrai Sahara (1), où il
raconte ce qu’il a vu.
— Les lecteurs de Jeunesse-Magazine,
lui dis-je, aimeraient connaître quelques-uns des souvenirs
de vos voyages au désert ?
— Voyons, savent-ils à quoi ça
ressemble, un désert ? me demande Monod.
— Bien sûr, lui dis-je. Ils en
ont déjà vu des photographies, avec des caravanes, des dunes,
du sable à perte de vue.
___________________
(1) Je sers, éditeur. Paris 1937

Un aspect inattendu du désert au nord
de Taoudeni
— Oui, je sais, me dit-il, une immense plaine de sable,
c’est l’idée classique qu’on se
fait d’un désert. C’est un des aspects
du Sahara, mais il en est bien d’autres, infiniment
variés. C’est la faute de Biskra, c’est
par là qu’on a abordé le désert
pour la première fois. Au débouché
de l’Aurès, une chaîne de montagnes,
on est tombé dans la plaine et quelle plaine ! une
steppe horizontale, des sablons, des chotts, du sel, une
vraie marée basse. C’est pour cela qu’on
a cru pendant longtemps que le Sahara était un ancien
fond de mer desséché. Si on avait attaqué
le désert par l’Aïr, le Hoggar ou le Tagant,
pareille hypothèse ne fût jamais née.
« On trouve de tout au Sahara, des roches, des collines,
des falaises, beaucoup de pierres... et aussi quelquefois
du sable. À cela près qu’il n’y
pleut guère, c’est un sol semblable aux autres.
Le Sahara n’est un désert qu’à
cause de son climat.
« Transporté un peu plus au Nord, sous des
cieux plus humides, il ne tarderait pas à se faire
Bretagne, Touraine et Normandie, avec forêts, rivières,
prairies, écrevisses et nénuphars. Son aridité
a pour simple origine l’excessive disproportion entre
la quantité d’eau que lui verse la pluie et
celle que lui soustrait l’évaporation. Voilà
ce qu’il est essentiel de bien comprendre.
Quand
l’orage crève au Sahara
—
Vous venez de parler de la pluie. Pleut-il donc quelquefois
au désert ?
— Mais oui, bien entendu ; il n’y a pas sur
la terre d’endroit où il ne pleuve jamais.
Le Sahara est un pays où il pleut rarement : une
averse tous les dix ans à In-Salah. Mais quand cela
arrive, c’est un vrai déluge. Comme les murs
des maisons sont en argile, ils fondent.
Le 17 janvier 1922, à Tamanrasset, vingt-deux personnes
sont ensevelies sous un mur qui s’écroule :
huit morts. La noyade n’est pas le moindre des dangers
au Sahara, surtout dans la montagne où, dans l’oued
à sec une heure auparavant, bouillonne tout à
coup un torrent profond souvent de plusieurs mètres
et assez violent pour balayer sans peine troupeaux et bergers.
L’évacuation d’un camp envahi, la nuit,
par le flot, n’a rien de plaisant ; si l’averse
accompagne le mascaret, le divertissement est complet :
vous pouvez m’en croire : j'ai essayé !
« Le plus ennuyeux, c’est que tout est gâché,
les bagages, les vivres, les couvertures, le cuir des selles
(fixé avec du crottin et des épines d’acacia).
— Je comprends cela d’autant mieux, dis-je à
Monod, qu’il m’est arrivé en 1916 pareille
mésaventure dans l’Aurès. Mais décrivez-moi
un peu votre caravane ; combien d’hommes, combien
de chameaux vous accompagnaient ?
Le
« nécessaire » d’un explorateur
—
Un nombre extrêmement variable. En novembre 1934,
j’ai accompagné à européens et
trois indigènes. Quant aux chameaux, leur nombre
dépend de la distance à franchir.
« En quittant Tindouf, à Noël 1935, pour
un parcours de 2 000 kilomètres, nous emmenions sept
chameaux.

La monture de l’explorateur
—
Et les bagages ?
— Ils ne sont pas compliqués :
mes burnous, une djellaba marocaine (c’est
une tunique en laine ou en poil avec des demi-manches et
un capuchon), des sandales en peau d’Oryx, l’antilope
du Sahara méridional, ou encore en peau de pneu d’auto,
très utilisés par les indigènes et inusables, un mongech.
— Un quoi ?
— Un mongech, une pince
à enlever les échardes, indispensable à tout va-nu-pieds
en pays épineux. Une petite théière d’étain, un quart,
une marmite, une bouilloire, deux assiettes de fer battu,
une cuillère (pas de fourchette, à quoi bon ? C’est
un engin de carnivore), un trépied en tringles à rideaux
pour suspendre le chaudron, une petite outre à beurre fondu,
des sacs de cuir pour le blé moulu, le gruau d’orge,
le riz, les dattes sèches, les arachides ; enfin les peaux
de bouc pour l’eau.
« Ensuite tous les instruments et outils
nécessaires pour les recherches scientifiques, depuis les
punaises et les crayons jusqu’aux thermomètres-frondes,
sans oublier le matériel photographique, la chambre claire
pour dessiner, et tous les emballages, caisses, sacs, boîtes,
etc., pour les échantillons géologiques, l’herbier,
et tout ce qu’il faudra soigneusement empaqueter pour
le ramener en bon état pour les collections du Muséum.
« Tout cela est très simple, mais la liste
de ce qu’on emporte doit être préparée
avec un soin extrême. Si quelque chose manque par
la suite, pas moyen d’y remédier: la boutique
la plus proche, où l’on pourrait trouver un
bout de ficelle, est à 5oo kilomètres !
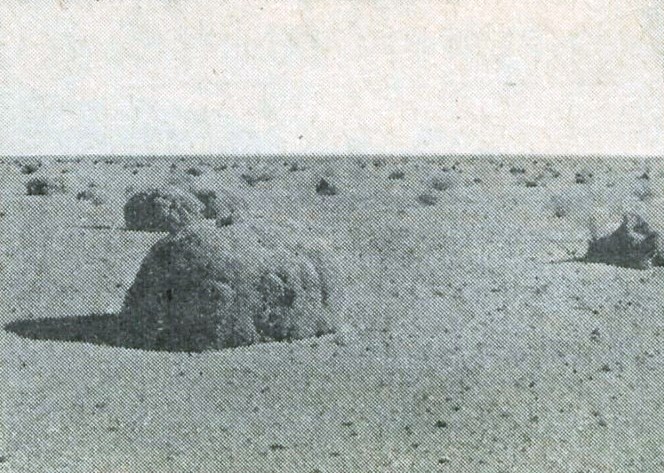
Les « choux-fleurs » du désert sur la hamada de Tindouf
Un menu végétarien
—
Et que mangiez-vous, du couscous, je pense ?
— Non, le couscous, c’est
du luxe : il faut beaucoup trop de temps pour rouler les
boulettes et les cuire dans un récipient percé. La nourriture
quotidienne, c’est la Kessera, galette de
blé moulu, cuite dans le sable. La matière première pour
la Kessera comme pour le couscous est du blé écrasé
entre deux pierres, procédé employé depuis les temps préhistoriques.
La Kessera est prête une demi-heure après l’arrivée
à l’étape. On pétrit la pâte pendant qu’on allume
le feu. On fait un trou dans le sable du foyer, mélangé
de cendre et de braise. On y plonge la pâte. Un moment après,
c’est cuit.
« Il y a aussi le riz : bouillie grise, sale, parfois
sans sel ni graisse, relevée de grains de sable,
de poils de bouc, de brins de paille.
À l’indigène, on le mange avec les doigts
(la cuiller est un luxe). Après le repas, se lécher
les doigts et surtout les creux qui les séparent,
puis se les essuyer sur la plante des pieds, merveilleusement
propre, polie, fourbie, récurée par le sable.
« On complète le menu par des dattes sèches,
des abricots, des cacahuètes.
« Au chapitre des boissons, on trouve le lait, le
thé vert et l’eau, cette dernière, plus
ou moins sale, avec des goûts variés, dont
celui de la « guerba », l’outre en peau
de bouc, fait le fond.

Pétrissage de la « Kessera »
Ce
problème : ne pas mourir de soif
—
L’eau doit être une chose singulièrement
rare et précieuse au Sahara ? Et comme on ne trouve
évidemment pas un point d’eau à chaque
étape, son transport est, je pense, un des plus importants
problèmes pour l’explorateur ?
— Il y a beau temps qu’il est résolu
! Depuis l’antiquité, le récipient idéal
est trouvé : c’est la peau de bouc, la guerba,
incassable, souple, facile à arrimer par les pattes
(celles du bouc), facile à réparer.
— Combien contient-elle ?
— 20 à 25 litres d’eau.
— Combien faut-il d’eau par homme et par jour
?
— En hiver, 4 litres (y compris l’eau pour la
cuisine). C’est un minimum. En été,
quand il fait en plein midi 44° à l’ombre,
la consommation est doublée : 8 à 10 litres.
— Et les points d’eau, à quelle distance
sont-ils l’un de l’autre ?
— Cela varie entre o et 6oo kilomètres. À
raison d’étapes journalières de 5o kilomètres,
quand on dépasse cinq jours sans eau, ça cesse
d’être une promenade et ça devient du
sport. Mais les Touareg des Iforas le font chaque année,
en traversant le Tanezrouft entre Tisserlitine et Ouallen
: 400 kilomètres en 9 jours avec des moutons.
« En traversant le Lemriyé, entre Tiniouilig
et Araouan, nous avons fait 6oo kilomètres sans point
d’eau, en 18 jours.
— Et si l’on s’égare, si l’on
ne trouve pas le point d’eau, ou s’il est tari
?
— Ça fait partie des risques à prévoir
; c’est l’équivalent du naufrage en mer
pour le navigateur.
Souffrir...
et se taire
—
Et si l’on est malade, que devient-on ? Que fera-t-on
de vous ?
— Rien. Il n’y a rien à faire ! Il faut
marcher à tout prix, sous peine de mourir de soif,
vous et vos compagnons. Si vraiment vous êtes incapable
de vous tenir en selle, on vous attachera, mais l’étape
se fera, parce qu’il faut qu’elle se fasse !
« C’est une rude école, mais combien
salutaire. Ici, dans les villes, nous nous plaignons pour
le moindre bobo. Nous prenons l’habitude de nous dorloter.
Là-bas, aucune plainte, c'est tout à fait
inutile puisqu’il n’y a personne à apitoyer
: alors, il ne reste qu’à serrer les dents,
en prenant l’air du Monsieur-qui-n’a-pas-mal-du-tout.
Impossible
de poser le pied par terre !
—
Vous me parliez d’étapes de 5o kilomètres
par jour. Comment les parcouriez-vous ?
— L’hiver, étape d’une seule traite
de 7 heures à 10 heures. L’été,
on part à 4 ou 5 heures du matin, et on s’arrête
plus tard, vers 18 ou 19 heures avec une halte aux environs
de midi.
« Deux à trois heures de marche à pied
au moins, ensuite on monte à chameau. Dans l’après-midi,
parfois, nouvelle séance de marche à pied.
Au milieu du jour, la température du sol peut atteindre
8o°. Impossible de poser le pied nu par terre ! Pourtant,
il faut bien descendre s’il y a un échantillon
intéressant à ramasser... On s’en lire
en boitillant !
— Que ramassiez-vous, tout au long de vos courses
?
— De tout, des cailloux, des pierres taillées,
des fossiles. Mes poches se remplissaient de ce que je ramassais
moi-même ou de ce que des collaborateurs bénévoles
(européens ou indigènes) m’apportaient,
trouvailles parfois sans l’ombre du plus léger
intérêt. Pour ne pas froisser les donateurs
ni décourager leur zèle, j’avais deux
poches à mon séroual (culotte bouffante),d’un
côté celle du Muséum, avec un fond,
de l’autre la poche « à cadeaux »,
qui n’en avait plus, permettant de restituer discrètement
au désert toute découverte inutile.
Des
pêcheurs à la ligne au Sahara ?
—
La géologie saharienne est à la fois très
facile et très difficile. C’est un livre ouvert
: on trouve tout sur le sol ; pas de forêts, de maisons
ni de cultures pour gêner l’observation. Mais
pour tourner chaque page, il faut parcourir des distances
énormes, par centaines de kilomètres.
— Et la préhistoire ?
— J’ai recueilli de nombreux dessins et inscriptions
faites sur des rochers. Il y en a de modernes, d’autres
fort anciennes (par exemple 5 000 ans avant J.-C.). Parmi
les objets à ramasser, on trouve des meules, des
haches, des pointes de flèche en pierre taillée.
J’ai recueilli des hameçons en os de crocodile...
— Comment ? des pêcheurs à la ligne au
milieu du Sahara ?
— Mais oui ! Le climat du Sahara a été
autrefois beaucoup moins aride que maintenant, et il y a
eu de grands lacs, qui ressemblaient au Tchad actuel.
« Sur les bords vivaient au temps de l’âge
de pierre, des populations de paysans et de pêcheurs.
Les preuves de ce changement de climat abondent. Tenez,
voyez dans ce tube ces graines subfossiles, ramassées
dans le désert.
— Oui, qu’est-ce que c’est ?
— Des graines de micocoulier.
Nous
voici revenus dans le laboratoire du Muséum. Par
la fenêtre, on voit les pelouses et les ombrages.
Je regarde la carte des parcours accomplis dans le Sahara
par Théodore Monod. On pense à des zigzags
dessinés par un insecte capricieux.
Je songe à ces interminables cheminements dans le
désert pendant des milliers et des milliers de kilomètres.
Quelle leçon d’énergie et de persévérance
!
F. Quiévreux.

Ravin dans la falaise du Harik
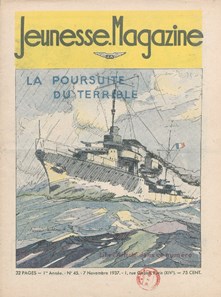

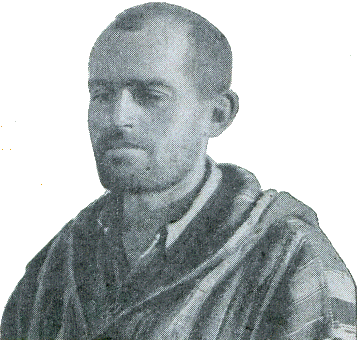 Impossible
de poser le pied par terre !
Impossible
de poser le pied par terre !