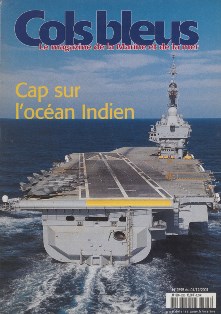
Cols bleus : le magazine de la Marine et de la mer n° 2 595 du 1er décembre
2001
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

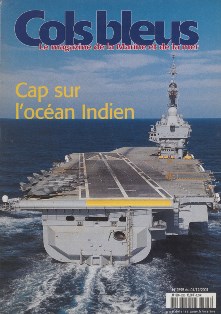
Cols bleus : le magazine de la Marine et de la mer n° 2 595 du 1er décembre
2001
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

par Guillaume MICHEL
Mythe fécond de la littérature, l’Atlantide inspire également les auteurs de Cols Bleus qui, au moment où le cinéma donne une nouvelle actualité à la légende, nous proposent deux articles présentant certes quelques redondances mais qui se complètent aussi. Premier épisode.
Couverture de l’Atlantide de Pierre Benoît.
Ce roman, paru en 1919, valut à son auteur un succès littéraire remarquable
Énigme d’une brillante civilisation engloutie par un mystérieux cataclysme. Création d’une imagination puissante ? Réalité transmise par nos pères ?
Quoi qu’il en soit, la littérature et les études scientifiques ne tarissent pas sur cette Atlantide dont on recherche encore les ruines improbables.Les experts en atlantologie se réfèrent à deux célèbres dialogues de Platon, dits de Timée et de Critias, rédigés au Ve siècle avant J-C. Le premier rapporte qu’une guerre avait jadis opposé la cité d’Athènes à la puissante Atlantide. Cette île, située au large des colonnes d’Hercule (le détroit de Gibraltar), aurait été « plus grande que l’Afrique et l’Asie réunies », et dominait une partie des continents jusqu'en actuelle Italie et en Égypte. Ses habitants entreprirent d'asservir le reste de la Méditerranée et affrontèrent les Athéniens. C'est alors que la terre sembla s'entrouvrir et l'Atlantide disparut sous la mer. On n'en sait guère plus. Le texte ne dit rien ni des mœurs ni des réalisations grandioses des Atlantes.
Platon y revient dans un autre récit plus détaillé dans lequel il développe la croissance prodigieuse de cette civilisation puis sa brutale décadence, quand les Atlantes, qui avaient toujours vécu confortablement en parfaite autarcie, entreprirent de commercer avec d'autres peuples. Du sanctuaire voué au culte des dieux, on fit un puissant port de commerce. La cité profanée, la corruption s'accrût avec la puissance et la gloire militaire. « Alors, écrit Platon, alors donc le dieu des dieux, Zeus, qui gouverne selon les lois de la justice, dont les regards discernent partout le bien et le mal, apercevant la dépravation d’un peuple naguère si généreux, et voulant le châtier pour le ramener à la vertu, assembla tous les dieux dans sa demeure céleste au centre de l’univers, et les ayant assemblés, il leur dit... », il leur dit... ? C’est justement ce qu’on ne saura jamais, car le récit s'arrête là brutalement, sur une phrase inachevée. On imagine que la colère de Zeus précipita la perte des Atlantes, et ce n’est qu’en recoupant ce texte avec le récit du Timée que l’on croit mieux connaître la fin subite de leur empire. Toutes ruines englouties, l’Atlantide commençait sa carrière dans la littérature des mondes perdus.
La nouvelle Atlantide : une cité souterraine maîtrisant l’énergie nucléaire.La fortune littéraire de l’Atlantide
Platon avait-il transcrit le souvenir oral d’une civilisation historique, ou s’était-il joué de son monde par quelque fable de son invention ? L’érudition et le fantasme se disputèrent longtemps le monopole du mythe, qui inspira les premières œuvres de science-fiction, telle La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon dès 1627.
C’est d’ailleurs l’un des grands auteurs du genre qui écrivit les pages les plus célèbres relatant la découverte des ruines de la ville engloutie : à quelque Vingt mille lieues sous les mers. Dans ce roman publié en 1870, Jules Verne embarque son lecteur à la rencontre de mondes sous-marins dont, bien sûr, la plaine de l’Atlantide. C’est au cours d’une excursion en scaphandre que le capitaine Nemo et le professeur Aronnax découvrent les ruines éparses de la cité : « Là, sous mes yeux, ruinée, abîmée, jetée bas, apparaissait une ville détruite, ses toits effondrés, ses temples abattus, ses arcs disloqués, ses colonnes gisant à terre, où l’on sentait encore les solides proportions d’une sorte d'architecture toscane ; plus loin, quelques restes d’un gigantesque aqueduc ; ici, l’exhaussement empâté d’une acropole, avec les formes flottantes d’un Parthénon ; là, des vestiges de quai, comme si quelque antique port eut abrité jadis sur les bords d’un océan disparu les vaisseaux marchands et les trirèmes de guerre ; plus loin encore, de longues lignes de muraille écroulées, de larges rues désertes, toute une Pompéi enfouie sous les eaux, que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards ! » Le professeur réalise alors la portée de cette découverte, et se rappelle les travaux et les noms de tous les érudits qui, comme lui, s’étaient passionnément disputés au sujet de ces ruines. Pierre Benoît est l’un de ces auteurs qu’on ne lit plus que rarement. Son roman L’Atlantide lui valut pourtant, en 1919, un succès littéraire remarquable. L’hypothèse ne manquait pas d’originalité : deux officiers, le capitaine Morhange et le lieutenant de Saint-Avit, partent à la recherche de l’Atlantide... Chez les Touaregs, dans le massif du Hoggar ! L’erreur commune des savants, qui se fient à Platon, serait en effet de croire que l’Atlantide a sombré. Tous ont cru à un engloutissement. Or, ce que découvrent les deux officiers est qu’il n’y a pas eu immersion de l’Atlantide, mais émersion du continent saharien tout autour.
Un cataclysme engloutit la cité.La mer s’est donc retirée. Les terres entourant l’île antique ont émergé et le désert a pris la place de la mer. De l’île verte et grasse ne reste plus que le massif asséché que, pour leur malheur, Saint-Avit et Morhange partent explorer. L’intrigue de leur rencontre avec Antinéa, la dernière reine des Atlantes, peut paraître banale, mais la thèse géologique de ce roman lui a valu de rester parmi les chefs-d’œuvre de la littérature atlantique. Le dernier classique du genre pourrait bien être une bande dessinée fort bien documentée, parue en 1957. C’est la quatrième des aventures du capitaine Francis Blake et du professeur Philip Mortimer, confrontés à L’Énigme de l'Atlantide. L’auteur, Edgar P. Jacobs, avait commencé sa carrière dans l’ombre de Hergé à colorier les albums de Tintin. L’élève s'affirma vite par son souci d’exactitude et son travail de documentation, qui firent de chaque publication des fameux Blake et Mortimer un événement dans l’école du réalisme belge. Dans L’Énigme de l'Atlantide, Jacobs imagine que les Atlantes ont survécu au cataclysme en se réfugiant dans d’immenses cavités souterraines localisées sous les Açores. L’urbanisme de leur cité enfouie, construite avec force béton armé, ainsi que ses naïves soucoupes volantes, feront sourire le lecteur d’aujourd'hui, mais le scénario de l’aventure est captivant et vraisemblable – parce que bien renseigné. Finalement, l’Atlantide souterraine s’effondre et de curieux engins, sortes de bilboquets géants, surgissent de la mer pour s’envoler dans l’espace. L’imagination de Jacobs repousse les limites du genre... Les Atlantes d’hier deviendront-ils nos Martiens de demain ? La saga atlantique continue.
Ce ne sont là que quelques ouvrages parmi des dizaines d’autres, que l’on aurait peine à recenser. Objet favori de la science-fiction, l’Atlantide semblait ne plus appartenir qu’au domaine de l’esprit. Pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, des chercheurs rêvent de pouvoir démontrer le contraire en retrouvant les ruines de l’Atlantide.L’Atlantide de Platon, comme la Troie de Homère, passa longtemps pour la création d’une imagination puissante. Vers 1873 cependant, un pionnier de l’archéologie, Heinrich Schliemann, crut retrouver en Turquie les ruines de la cité de Troie... L’existence de la civilisation homérique était ainsi démontrée ! Or, si Homère a dit vrai, si Troie a vraiment existé, l’Atlantide ne pourrait-elle être à son tour retrouvée ? Les pistes sont aussi nombreuses que tout ce que les océans recouvrent de curiosités géologiques. On frise parfois le canular. Trois hypothèses retiennent pourtant l'attention des chercheurs.
Recherche de la cité perdue dans le désert...Un fantasme d'archéologue ?
La première situe l’Atlantide en Méditerranée : c’est l’hypothèse Santorin. Des hommes s’étaient établis il y a des milliers d’années sur ce fragment d’île volcanique, et y bâtirent une cité qui disparut dans une formidable éruption vers le milieu du deuxième millénaire avant J.-C. En 1967, un archéologue grec, Spyridon Marinatos, mit à jour les vestiges de la ville enfouie sous les cendres. La découverte était d’importance. On parla bien sûr d’une « Pompéi préhellénique ». On parla surtout de l’antique Atlantide... Ce qui fut retrouvé sur le site permet d’imaginer un urbanisme, un art et un artisanat raffinés très proches de ce qu’avait décrit Platon qui n’aurait été que le destinataire lointain d’un récit amplement déformé. Or cette hypothèse reste controversée. Comment accorder l’estimation chronologique de Platon et la datation scientifique de l’éruption ? Et comment ne pas tenir compte de sa localisation de l’Atlantide au large de Gibraltar ? Autant chercher l’île dans l’océan de son nom. C’est la seconde hypothèse selon laquelle l’Atlantide serait engloutie bien plus loin, au coin du sinistre triangle des Bermudes. En 1968, des plongeurs découvrent l'existence d'une construction sous-marine au nord de Bimini, entre la Floride et la grande île des Bahamas. Il s'agit d'une chaussée parfaitement rectiligne de 548 mètres de long sur 6 mètres de large, dont une extrémité s'incurve légèrement pour prendre l'apparence d'un ]. Or ces vestiges ne sont pas un caprice de la géologie. Ce sont des hommes, de nombreux hommes, qui les ont taillés à angles droits, transportés, puis alignés... Mais qui, et quand ? On ne peut que constater la présence des blocs, leur nombre et leur masse. Le reste ne relève que d'extrapolations : combien étaient-ils pour soulever de telles charges, avec quels instruments, pour quelles raisons astronomiques ou religieuses... Ce sont autant de questions que l'on se pose aussi pour toutes les civilisations mégalithiques, à Carnac, Stonehenge, jusque sur l'île de Pâques. Cela ne suffit pas pour identifier la chaussée de Bimini comme un reste de l'Atlantide. On n'y voit que la trace intrigante d'une société mégalithique sur le continent américain il y a quelques milliers d'années. Pour en déduire davantage, il faut vouloir y croire !
Préfère-t-on se garantir de cautions scientifiques ? Une étude vient justement d'être publiée dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences, qui pourrait bien mettre d'accord tous les atlantomanes en réconciliant les données du mythe, de l’histoire et de la géographie. Jacques Collina-Girard, chercheur au CNRS, démontre que, si tant est que l'Atlantide ait existé, elle ne peut avoir existé qu'au débouché de Gibraltar et correspondrait à l'actuel haut-fond de Spartel.
« Un instant je pus entrevoir les ruines du temple d’Hercule enfoui, au dire de Pline et d’Avenius, avec l’île basse qui le supportait. »
« Là, sous mes yeux, apparaissait une ville détruite. »La date avancée par Platon correspond en effet à une remontée lente des eaux qui auraient englouti tout un chapelet d'îles faisant face à l'actuel Gibraltar, et dont la plus importante aurait précisément disparu il y a onze mille ans - soit les neuf mille ans de Platon ! La plus importante de ces îles, l'actuel banc de Spartel, mesurait 14 km de long sur près de 5 km de large, à mi-voie entre l'Europe et l'Afrique, presque à portée de canot. L'Atlantide n'aurait donc été submergée qu'au rythme de deux mètres par siècle, par une paisible montée de la mer. Faut-il donc sans attendre y lancer une expédition de recherche ? On ne trouverait guère sur ces hauts fonds que les traces d'une société paléolithique de chasseurs-cueilleurs – selon ce même scientifique. Or les sociétés paléolithiques sont avant tout nomades, et ne produisent aucun vestige digne d'une quelconque cité... Si donc une île fut engloutie là où le précise Platon, il ne s'y établit rien de si durable ni remarquable que l'Atlantide du mythe. À une vérité géologique correspond donc un mensonge historique.
Une fable morale
Alors ? Mi-songe, mi-vérité, l’Atlantide a et n'a pas existé. Cette légende illustre en fait une leçon de morale que Platon voulait adresser à ses contemporains, les Athéniens. Un tel récit n’avait pour lui qu'une valeur d'illustration de sa pensée, tout comme plus tard les paraboles d'un autre Homme. La leçon de Platon vaut encore aujourd’hui : les puissances insolentes, oublieuses de l’ordre naturel ou divin, se vouent d’elles-mêmes à un funeste destin. Tout empire périra. Simple remontrance de philosophe ? L'histoire du vingtième siècle est marquée d'expérimentations hardies et d'une dévastation irrémédiable des ressources naturelles. Les eaux remontent lentement et le climat se dérègle... Cela n'est pas niable. Le mythe de l'Atlantide symbolise l'empire technique d'une société sur la nature et sur d'autres puissances. À nous de faire en sorte que le récit de nos origines ne devienne pas aussi... la chronique d'une fin redoutée.•