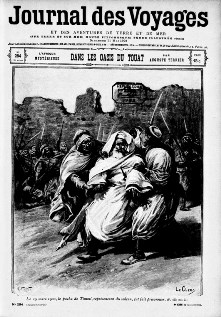
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 284 du 11 mai
1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

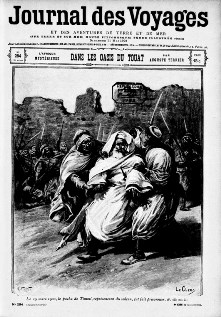
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 284 du 11 mai
1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

_______
Carte des oasis sahariennes
Depuis deux ans et demi, la France occupe les oasis de l’Extrême-Sud du département d'Oran demeurées si longtemps fermées à toute pénétration européenne. Et cependant, seules, quelques publications coloniales spéciales ont donné la description de celte région si intéressante de l'Afrique du Nord. Aucun récit détaillé n’a été encore soumis au grand public.
Fidèle à son programme, le Journal des Voyages a jugé nécessaire de publier ce récit éclos sous la plume si autorisée de notre collaborateur Auguste Terrier, d'après les notes des officiers des affaires indigènes d'Algérie.
Tout en apprenant à connaitre la nouvelle possession de la France, nos lecteurs se rendront compte que ces campagnes du Sud algérien sont aussi pénibles et brillantes que celles du Soudan, de Madagascar ou du Tonkin, et ils accorderont leur sympathie aux braves Français qui travaillent là-bas, sous un soleil de feu, pour la plus grande Algérie et pour la plus grande France !LA DIRECTION
_______
I
LE TOUAT MEURTRIER
« Et maintenant, capitaine, que vous , avez vu de loin les têtes des palmiers de la bourgade maudite, tournez bride avec votre escorte, et reprenez la route du Nord. On n’entre pas encore, on entre moins que jamais à In-Salah ! » C’est en 1891 que Émile Masqueray, le regretté doyen de l’École des Lettres d’Alger, qui sut retrouver la plume de Fromentin pour évoquer devant nous ses visions d’Afrique, écrivait cette conclusion à un article où il dépeignait la vie et les crimes du groupe d’oasis du Touat et du Tidikelt et critiquait l’inactivité de la France eu face de ces bourgades d’assassins coupables du massacre de tant de missions françaises. Sa conclusion resta vraie pendant huit années encore. Mais le 28 décembre 1899, elle fut enfin démentie : le drapeau français était planté à In-Salah, la principale de ces oasis, et il y est aujourd’hui encore. La France est à In Salah.
Maintenant on sait donc enfin ce que sont et ce que valent ces oasis jadis si mystérieuses, et nos officiers d’Algérie en ont dressé des rapports détaillés qui sont du plus haut intérêt. C’est avec ces excellents guides que nous allons conduire aux oasis du Sud oranais les lecteurs du Journal des Voyages : nous espérons que du moins les photographies qui accompagnent cette étude et que nous devons à d’obligeantes communications du commandant Laquière, chef du service des affaires indigènes de la division d’Alger, du capitaine Clausse et du lieutenant Martial, leur feront voir, mieux que notre récit, ce coin d’Afrique si rapproché de nous et qui hier cependant en était si éloigné.
Les oasis du Touat, du Gourara et du Tidikelt, situées dans l'Extrême-Sud oranais étaient demeurées sans maîtres à la suite du traité franco-marocain de 1845 qui avait délimité la frontière entre le Maroc et l’Algérie. C’est en 1860 que des Français essayèrent pour la première fois d’y pénétrer : le commandant Colonieu et le lieutenant Burin se joignirent à une caravane commerciale à destination des oasis, mais ils furent mal reçus au Gourara, les villages fermaient leurs portes à leur arrivée et ils durent rentrer à Géryville sans avoir pu prendre contact avec les indigènes. En 1864, l'Allemand Rohlfs put visiter les oasis et en rapporta de précieux renseignements, mais il avait dû pour y entrer renier sa qualité de chrétien et d’Européen. Paul Soleillet et Largeau ne furent pas aussi heureux et en 1876 trois Pères Blancs du cardinal Lavigerie, Ménoret, Paulmier et Bouchard, furent assassinés à Hassi Inifel. Dès ce moment, il apparaissait que les populations des oasis nous étaient hostiles : dans tout ce pays de la poudre (blad el baroud), malheur à l’Européen qui risquait de pénétrer le secret d’In-Salah !
Même, comme le disait Masqueray, l’oasis d’In-Salah tuait de loin comme une plante vénéneuse, car on a la preuve que le massacre de la mission Flatters en 1881 à Tadjenout fut accompli par les Touareg à son instigation. Ce déplorable événement, qui mettait fin à toutes les entreprises projetées de chemin de fer transsaharien, amena aussi de notre part dans le Sud algérien une inaction presque complète qui dura jusqu’en 1890; le chemin de fer fut toutefois poussé jusqu'à Ain-Sefra, mais les deux missions qui tentèrent de pénétrer dans les oasis eurent le triste sort de leurs devancières : en février 1886, le lieutenant Palat était assassiné au Gourara et, en 1889, Camille Douls, qui voyageait déguisé en Arabe, fut également tué au Tidikelt.
Ces deux crimes méritent d’être racontés en quelques lignes.
Marcel Palat était un jeune lieutenant de hussards qui, tout en publiant sous un pseudonyme quelques volumes de vers et de nouvelles algériennes, tels que Fleur d'alfa, les Arabesques, Mariage d'Afrique, préparait avec ardeur un grand voyage à travers l’Afrique. Il voulut d’abord partir du Soudan pour aller en Algérie, mais quand il eut réuni les quelques billets de mille francs nécessaires à son voyage, on l’amena à renverser son itinéraire. L’Algérie devenait son point de départ et le Touat se trouvait sur sa route.
Comptant sur une recommandation du chef de la grande tribu des Oulad Sidi Cheikh, il partit le 3 décembre 1885 d'El-Goléa avec deux indigènes seulement : Bel Kassem et Ferradji. Neuf jours après il se trouvait au Tinerkouk, rencontrant d’ailleurs partout une grande méfiance et volé consciencieusement par les indigènes. Enfin, le25 janvier 1886, il put se mettre en route vers le Sud, pour le Tidikelt. Quelques jours après le bruit de son massacre parvenait en Algérie. Le noir Ferradji, seul survivant, raconta que Palat avait été bien reçu à Deldoul par Bou-Amama, l'ancien chef de l’insurrection de 1881, mais que le 22 février, à Hassi Cheikh, à quatre journées de marche d’In-Salah, ou avait trouvé son cadavre ainsi que celui de l’interprète Bel Kassem.
Le lieutenant était étendu la face contre terre, l'épaule droite traversée de deux balles; ses blessures saignaient encore et il avait dans la bouche, fortement crispée, l’index de la main droite que ses assassins lui avaient coupé et planté entre les dents, en manière de risée et de mépris.
Le meurtre était dû sans doute aux pillards Ba Hammou et il était d’autant plus facile que le malheureux lieutenant voyageait sans escorte.
L’assassinat de Camille Douls ne fut pas moins tragique.
Cet héroïque explorateur avait, tout jeune encore, fait au Maroc un voyage d’exploration. Afin de pouvoir voyager plus aisément il se faisait passer pour musulman et il s’était fait déposer sur la côte du Sahara, au cap Garnet, par des pêcheurs des Canaries, comme un naufragé. Là il pensait exciter ainsi la pitié et la confiance des tribus maures. Mais les Oulad Delim qui le recueillirent, loin de lui faire bon accueil le maltraitèrent, le chargèrent de chaînes et l’emprisonnèrent. Lui, sans s’émouvoir, récitait force prières arabes et finit par attendrir un pèlerin de la Mecque, un Hadj, qui affirma qu’il devait être Turc. Douls accepta cette naturalisation salutaire, fut délivré, transformé en nomade et vécut cinq mois sous la tente dans ce pays inexploré.
Mais comment en sortir ? Heureusement le chef de la tribu voulut lui donner sa fille en mariage, et comme c’est le fiancé qui doit payer une dot aux beaux-parents, Douls demanda à aller en Turquie pour chercher la somme. On le laissa partir. Il longea la côte de l’Océan et arriva à Maroc (Marrakech), la capitale, en même temps que le ministre anglais, sir Kirby Green, venu pour présenter ses lettres de créance. Un des compagnons de sir Kirby reconnut Douls et bientôt la nouvelle s’ébruita. Furieux, le sultan fit incarcérer notre compatriote qui allait subir un triste sort sans l’intervention du ministre anglais. Douls put gagner Tanger et la France.
Cette singulière aventure eût guéri un moins audacieux. Elle ne fit que stimuler son ardeur. Il voulut tenter d’atteindre Tombouctou en partant du Maroc et en se faisant une fois encore passer pour musulman. Et pour se donner plus de crédit, il alla en Égypte et de là à Tor. au pied du binai, pour se mêler à la foule des Hadj revenant de la Mecque. En octobre 1888, il rentrait ainsi à Tanger sous le nom d’El Hadj Abd-el-Malek et se mit de nouveau en route avec deux Marocains et des lettres de recommandation du chérif d’Ouazzan.
Malgré ses précautions, Douls, dès son arrivée aux oasis, fut reconnu pour un Européen, même pour un Français. Néanmoins, ayant rencontré au Reggan des Touareg Ibatanaten, il conclut un marché avec deux d’entre eux pour aller jusqu’à Azaouad, sur la route de Tombouctou. Mais à peine arrivé dans l’Akabli, Douls, s’étant étendu sous un tamarix pour faire la sieste, s’endormit et les deux Touareg lui passèrent une corde autour du cou et l’étranglèrent. Puis ils se partagèrent les 2 000 francs en or qu’il avait dans sa ceinture.
Il était évident que tout le pays était infesté de coupeurs de route, de pillards, et que les voyageurs étaient à la merci des rezzous de Touareg. Même les Châamba avaient souvent à lutter contre les pirates du désert et c’est ainsi qu’en 1887, les Chaâmba El Mouadhi, d’El-Goléa durent repousser un rezzou de Touareg Hoggar venus jusqu’à Hassi Inifel, près du fort Mac-Mahon d’aujourd’hui, pour enlever des chameaux. Les Touareg furent battus et sept d’entre eux faits prisonniers ; ils furent même livrés aux autorités françaises et internés à Alger à leur grande honte : « Nous tuons nos prisonniers, disaient-ils ; pourquoi nous gardez-vous en prison comme des voleurs ? » L’un d’eux était ce Targui Ischekkad-ag-Rhâli qui vint à Paris, fut désigné pour accompagner Paul Crampel dans son voyage au lac Tchad et fut, avec la petite princesse congolaise Niarinzhe, le héros du bal de l’Opéra de 1890. Étrange fortune que celle de ce barbare qui, transplanté du Sahara à Paris, devait aller l’année suivante mourir aux bords du Tchad sans pouvoir regagner son désert !
II
L’OCCUPATION FRANÇAISE
Ainsi s’allongeait la liste des crimes des chefs des oasis sahariennes. En 1890 il sembla que la France allait enfin mettre ordre à cette déplorable situation. L’opinion publique s’intéressait passionnément aux choses africaines et le Comité de l’Afrique française qui se fondait propageait dans tout le pays la nécessité d’unir entre elles les trois parties de notre domaine, l'Algérie, le Soudan et le Congo, plan si nettement formulé par Paul Crampel. On regarda de nouveau vers les oasis sahariennes. Et ce fut pour y trouver un concurrent. Le Maroc, en effet, ne s’était point désintéressé de ces oasis. Les armées marocaines, qui autrefois étaient allées jusqu’à Tombouctou et avaient dominé cette partie du Niger, avaient fait de nombreuses expéditions au Touat et au Tidikelt. De plus, c’est là que s’était réfugié Bou-Amama, l'instigateur de la grande révolte sud algérienne de 1881, et il poussait les habitants des oasis à se soumettre au Maroc. Ce fut chose faite dès 1884 et, trois ans après, une députation allait à Méquinez demander au sultan du Maroc, Moulay-el-Hassan, le rattachement des oasis à l’empire chérifien. Le sultan s’empressa d’y envoyer ses agents et surtout des collecteurs d’impôts. La France, informée de ces agissements, protesta auprès de lui ; il fit des promesses assez évasives et n’en continua pas moins ses intrigues.
L’occupation d’El-Goléa en 1891 sembla marquer que la France était décidée à marcher de l’avant, d’autant plus qu’à la Chambre M. Ribot, ministre des Affaires étrangères, déclarait qu’il ne tolérerait de la part du Maroc aucun acte de souveraineté sur les oasis et que la question n’était pas une question marocaine, mais une question de police au Sud de notre Algérie.
Malheureusement on ne se décidait point à occuper enfin les oasis, malgré les efforts du gouverneur général Cambon qui jugeait l'heure venue et malgré les craintes des habitants qui attendaient chaque jour une colonne française. D’autre part, M. Cambon faisait établir des fortins ou bordjs au sud d’El-Goléa, Fort Miribel, Fort Mac-Mahon, etc. Plusieurs officiers et explorateurs se rendirent jusqu’aux portes d’In Salah dans des raids audacieux, tels que ceux du commandant Godron en 1805, des commandants Germain et Laperrine en 1898, de M. Foureau, etc. Mais aucun n’avait le droit ni le pouvoir d’occuper et, excités par les marabouts fanatiques et par les promesses des pachas marocains, les habitants des oasis refusaient leur soumission.
Leur principale force était dans l’irrésolution du gouvernement français. Un événement capital y mit fin en décembre 1899.
Le 28 de ce mois, le géologue Flamand, professeur éminent de l’École des Sciences d’Alger, déjà connu pour de nombreux travaux scientifiques sur le Sud oranais, arrivait devant In-Salah, accompagné d’une petite escorte militaire commandée par le capitaine Pein. Il y fut soudain attaqué par 1 200 hommes venus d'In-Salah et des oasis voisines et commandé par Hamoud-Badjouda, chef du parti anti-français. La mission française, composée de 150 hommes environ, repoussa cette attaque dans un brillant combat et les gens d’In-Salah durent faire leur soumission.
Ce fut en France une surprise générale, mais, après un temps d’hésitation, on décida de maintenir l’occupation et de renforcer la petite mission qui avait si vaillamment mis fin à la trop longue incertitude de la politique française. Le commandant Baumgarten fut immédiatement envoyé à Ksar-el-Kebir, la principale oasis d’In-Salah, et y trouva la mission Flamand-Pein fortement installée; le 5 janvier 1900, elle avait repoussé une seconde attaque venue d'Igosten, d’In Rhar et de l’Aoulef. Puis, sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement arrêta un projet d’occupation méthodique et il envoya deux colonnes : l’une sous le commandement du colonel Bertrand, chargée d’occuper Igli et la vallée de la Zousfana ; l’autre dirigée par le colonel d’En et chargée d’achever la conquête du Tidikelt.
Le 19 mars 1900, celle-ci dut emporter de vive force l’oasis d’In Rhar où s’étaient réunis les habitants encore hostiles.
Ceux-ci s’étaient groupés sous le commandement d’un Marocain qui se faisait appeler le pacha de Timmi et se disait le représentant du sultan du Maroc : il fut fait prisonnier. Ce fut un beau combat d’artillerie; à 1 300 mètres, nos canons, postés sur une dune, ouvrirent une brèche dans le mur de la grande kasba et, quand l’infanterie s’élança à l’assaut, ce n’étaient partout que cadavres, gens sans tête, sans bras, sans jambes. L'effet des obus à mélinite avait été foudroyant.
Le colonel d’Eu profita de sa victoire pour achever l’occupation du Tidikelt et il s’empara sans coup férir de l’Akabli et de l’Aoulef. Pendant ce temps, le 5 avril, la colonne Bertrand occupait Igli sans. combattre. Puis c’est au Gourara que le gouvernement envoyait deux colonnes (Ménestrel et Letulle) qui l’occupèrent en mai 1900.
Telle était la situation au mois de mai 1900 : le Tidikelt était occupé, ainsi que le Gourara et Igli. Restait le Touat proprement dit, dont les dispositions étaient encore incertaines. À ce moment, le général Servière, commandant la division d’Alger, décida de visiter les nouveaux territoires ajoutés à sa division et d'aller sur place étudier l’organisation à donner au Tidikelt et au Gourara : au cours de ce voyage, le Touat fut traversé pour la première fois en entier, et ce fut, en réalité, une inspection complète des oasis sahariennes.
Grâce au commandant Laquière, qui accompagnait le général, nous avons un récit détaillé de cette reconnaissance et nous nous bornons à le suivre pour , décrire aux lecteurs du Journal des Voyages cette région intéressante et si longtemps mystérieuse.(à suivre)
AUGUSTE TERRIER
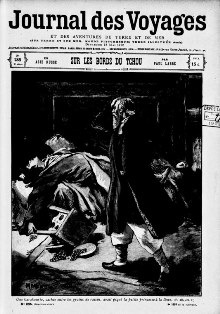
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 285 du 18 mai
1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


III
AU TIDIKELT
Parti d’Alger le 21 mai 1900. accompagné du commandant Laquière, du capitaine du Plessix, de l’interprète Reymond, des lieutenants Soudant et Pelletier, et d’une escorte de 10 chasseurs d’Afrique, de 27 cavaliers ou méharistes arabes, le général Servière arriva le 13 juin à Fort-Miribel où il s'adjoignit un peloton d’une trentaine de spahis sahariens. Le fort est relié à El-Goléa par une ligne télégraphique optique, c’est un des points les plus chauds de la région et on y nota, ce 13 juin, 49° à l’ombre. Dès le lendemain on se remettait en route pour le Tidikelt à travers la Hamada ou plaine caillouteuse, en longeant les hauteurs du Baten et en coupant l’Oued-Mya. Région pauvre en eau. Le problème de l'eau existe ici comme dans toutes les régions chaudes de l’Afrique et il faut surveiller attentivement les puits. C’est la région des tilmas, réservoirs naturels formés par l’accumulation de l’eau dans les dépressions argileuses, par suite étanches, recouvertes de graviers qui empêchent l’évaporation de la nappe liquide. Lorsqu’on veut utiliser les tilmas, il suffit de creuser dans le gravier un trou d’un mètre environ de profondeur pour trouver une eau excellente qui se renouvelle à mesure qu’on la puise.
Les indigènes qui traversent la région prétendent qu’après une pluie abondante les tilmas contiennent de l’eau pour trois ans. Ils s’élèvent contre les forages de puits prescrits par l’autorité militaire en disant qu’on ne doit jamais laisser ouvert un puits de tilmas, afin de ne pas diminuer la réserve d’eau par l’évaporation, et en effet ils rebouchent toujours soigneusement, après s’en être servis, les puits qu’ils ont creusés dans les tilmas. Les vents violents et chauds peuvent en effet produire l’évaporation qu’ils redoutent et il est du reste très facile de creuser les trous à eau, quand on en a besoin.
Le 23 juin, la colonne arrivait à Foggaret-ez-Zoua, au Tidikelt, et le lendemain à In-Salah. Elle devait y rester jusqu’au 12 juillet.
Le Tidikelt est la région située au Sud du dernier étage du plateau du Tademaït; c’est une longue bande de terrain sablonneux de près de 300 kilomètres, sur laquelle on trouve de l’Est à l’Ouest six groupes d’oasis :
1° Le district de Foggaret-ez-Zoua. Il comprend quatre ksour (ou maisons) et oasis. La population est de 460 âmes, dont 323 Arabes ou Berbères blancs, 99 Harratines, descendants de métis ou d’esclaves affranchis, et 38 nègres. Ces oasis sont pauvres en palmiers et en bestiaux ;
2° Le groupe d’Igosten qui comprend 310 âmes et 8 000 palmiers ;
3° Le district d’In Salah. C’est le plus célèbre. Il comprend onze groupes de maisons alignées du Nord au Sud et la population totale est de 1 698 habitants, dont 435 Harratines et 175 nègres. Les maisons y sont peu importantes, sauf la casba des Oulad Badjouda qui est un fortin quadrangulaire d’une réelle valeur défensive. Ces Badjouda sont la grande famille d’In-Salah et n'ont de rivaux que les Bahamou.
Pour protéger leurs jardins, les gens d’In-Salah ont établi parallèlement à leurs plantations de grandes haies de branches de palmiers qui retiennent les sables des dunes voisines et forment ainsi une dune artificielle.
On devine que la vie même de ces oasis dépend de l'eau. C’est elle qui permet les quelques cultures de céréales et de figuiers dont se nourrissent les Ksouriens d’In-Salah. Ils ont dû dépenser dans ce but une prodigieuse activité. Il leur a fallu chercher, dans des couches aquifères souterraines, l’eau qui ne leur tombe presque jamais du ciel. — on a vu des périodes de douze années sans pluie au Touat, — et l’amener par une canalisation d’une incroyable étendue, marquée à la surface du sol par des lignes de cônes percés de trous ayant servi à l’expulsion des matériaux de déblai et servant encore de prise d’air, Ce sont les foggara ou feggaguirs. Le commandant Laquière en fait la curieuse description suivante :
« Dans tout le Tidikelt, comme d’ailleurs au Touat et au Gourara, lorsqu’on arrive dans le voisinage d’une oasis, on aperçoit de longues lignes de petites levées de terre, de forme tronconique, d’épaisseur et de relief variables, qui ont souvent plusieurs kilomètres de développement. Sur certains points, ces monticules de terre atteignent près de 2 mètres de hauteur et ont un diamètre moyen de 3 mètres, mais le plus généralement ils ont 0m80 de hauteur et 1m50 d’épaisseur à la base. Quelquefois aussi ils sont presque à fleur de terre. Dans chaque file, l’écartement moyen des petites levées est de 8 à 10 mètres. Lorsque l’oasis a une certaine étendue, ces lignes se multiplient, tout en restant sensiblement parallèles, et toujours orientées de l’Est à l’Ouest. Elles sont généralement simples, mais il arrive aussi que des branches latérales viennent se raccorder à la file principale. Ces longs alignements indiquent la présence dans le sous-sol des galeries qui constituent les foggara.
Femmes harratines puisant de l’eau à In-Salah
Groupe de femmes devant la casbah d’In-Salah
Fort Miribel — Une Hariania — Une vieille indigène. — Types d'Harratins.
Rue à Ksar el Kébir. — Ksar Djedid, In-Salah. (Photographies communiquées par le commandant Laquière et le lieutenant Martial)« Chacun des petits monticules de terre est percé d’un trou central qui, lors du creusement de la galerie, a fait office de cheminée d’aération et de puisard pour l’extraction des matériaux ; ceux-ci, déposés sur le sol, ont formé les levées de terre tronconiques qui s’alignent de proche en proche sur toute la longueur du forage. Ces puisards ou cheminées d’aération sont conservés avec soin pour permettre le nettoyage des foggara. Les galeries vont au loin capter les eaux souterraines, pour les amener à fleur de sol par une pente judicieusement calculée. Leur hauteur est variable, mais généralement suffisante pour qu’un homme puisse travailler facilement. Sur certains points leur voûte s’élève à 3 et 4 mètres au-dessus du radier. L’eau captée coule par un canal entaillé dans le radier; à droite et à gauche sont quelquefois réservées deux banquettes permettant de circuler dans la galerie. Les galeries ne sont pas maçonnées, mais taillées dans une argile compacte très résistante.
« L’eau, une fois amenée à la bouche de la foggara, au niveau du sol naturel, est répartie entre les différents usagers suivants leurs droits. Les foggara n'appartiennent pas en effet à la collectivité, mais sont des propriétés privées, œuvres de particuliers. Il existe pour chaque oasis un règlement des eaux, appliqué par le kiel el ma (mesureur de l’eau), qui est toujours un personnage des plus importants, du seul fait de sa fonction. Il tient registre des parts et tours d’eau, ainsi que des mutations qui surviennent. Pour vérifier la répartition, le kiel el ma se sert d’un instrument étalon, en métal, percé de trous de diverses grandeurs, qui lui permet de vérifier très rapidement si le volume de l’eau, effectivement attribué à chaque propriétaire, reste bien égal à celui qui a été fixé.
« L’eau des foggara sert aussi à l’alimentation des habitants. On la puise alors par l’un des regards dont on a découvert l’orifice, comme on le ferait dans un puits ordinaire. Plusieurs trous sont affectés à cet usage, les autres demeurent fermés.
« Quelques rares foggara ne donnent plus d’eau, « elles sont mortes » ; il est probable qu’elles seraient susceptibles de revivre, si elles étaient réparées ; mais les indigènes disent qu’ils ont perdu le secret de ces constructions et qu’ils ne sauraient plus rétablir une foggara tarie. « On pourra se rendre compte de l’importance des foggara d’In-Salah, en sachant que chacune d’elles est de 4 kilomètres 500, ce qui représente un développement total de 120 kilomètres de conduites souterraines. La nappe d’eau est captée à une profondeur de 15 à 20 mètres. »
Détail surprenant : l’étude de ces travaux d’adduction a donné lieu à une surprise. Toutes les eaux des feggaguirs descendent de l’Est à l’Ouest et une partie des eaux qu’ils captent proviennent sans doute des montagnes du Nord du pays des Touareg. Même fait se retrouve au Touat, où toutes les eaux viennent aussi de l’Est, en sorte que leur abondance est un problème.
Comme cultures, il faut citer les palmiers au nombre de 101 000 environ, quelques figuiers, de rares pieds d’une vigne agreste, donnant des grappes d'un petit raisin noir agréable à manger, du blé et de l’orge, du sorgho et du mil, quelques légumes d’été. L’industrie est nulle. In-Salah est un marché où les matières précieuses apportées du Soudan (plumes d’autruche, ivoire, peaux de lions et de panthères, selles, et, jusqu’en 1900, esclaves) s’échangent contre des produits du Nord.
Les habitants sont d’origine variée. Les Arabes et les Berbères, les plus nombreux, oppriment les Harratines, race vaincue et dépossédée du sol, et les noirs esclaves. À côté d’eux, des individus de toutes les races d’Afrique. Ils s’établissent par groupes et voisinent sans se mélanger. Ils sont divisés en deux grands partis, ou sofs, les Ihamed et les Séfian, qui se détestent et souvent se battent sans savoir pourquoi. Il n’y avait parmi eux avant l’occupation française aucune autorité constituée. Dans les circonstances graves, les hommes les plus notables par leur influence personnelle ou leur fortune se réunissaient en assemblée ou djemàa pour délibérer sur le parti à prendre et les moyens d’action : c’est dans ces djemâa que les Badjouda, adversaires de la France, avaient toujours fait triompher leur opinion. Aucun impôt n’était payé, sauf des cadeaux au sultan du Maroc dont les agents venaient de temps en temps dans le pays. Il y avait toutefois un cadi qui réglait les successions et les transactions entre particuliers lorsqu’ils lui demandaient son office. Le meurtre et le vol, très rares dans tout le Tidikelt, étaient réprimés par la population elle-même : l’homicide était puni de mort et lynché comme en Amérique, mais le plus souvent il était banni. Quant au voleur, outre la restitution du larcin, il était condamné à recevoir un nombre de coups de bâton déterminé par la victime du vol ;
4° Le district d’In Rhar. Il comprend sept ksour, 478 habitants, 32 000 palmiers ;
5° Le district de Tit, qui compte trois ksour et 15 000 palmiers. La casba de Tit, maintenant caserne de spahis sahariens, est entourée d’un fossé extérieur d’une profondeur de deux mètres. La disposition intérieure a été respectée. Lorsqu’on franchit la porte d’entrée, on accède dans un couloir qui est un véritable chemin de ronde circulant le long du rempart. C’est là que se tenaient les défenseurs du rez-de-chaussée qui tiraient par de nombreuses meurtrières. Au centre de la casba étaient les magasins et les logements. Cette casba était donc à la fois un refuge et un fort ;
6° Le district de l’Aoulef. Il comprend une vingtaine de ksour répartis en deux groupes principaux : l’Aoulef el Arab et l’Aoulef Chorfa. Ses habitants sont très commerçants.
M. Rimbaud, interprète militaire, a trouvé et étudié sur la Gara (ou mamelon rocheux) des Chorfa de curieuses inscriptions ou tifinar. Les Berbères nomades avaient l’habitude d’exercer sur les roches et les pierres leurs talents d’écrivains ou de dessinateurs. Les inscriptions de la Gara des Chorfa sont antérieures au XVIIe siècle, et elles sont dues aux Touareg qui venaient sur cette position dominante assister aux luttes de deux tribus aujourd’hui disparues : les Oulad Ahmed et les Oulad Ismaïl. Quelques-unes comprennent quelques vers, par exemple ceux-ci où un Targui déplore la capture d’un chameau de selle : « Faites entendre aux hommes les sons de l’ateklas — mais non à moi. — Lorsque j’irai à vous, la monture qui me servait en vedette — aura été emmenée. Ma monture a été prise et je ne suis point mort. » Un dessin représente un combat à la lance entre deux fantassins, d’autres des méharistes en vedette. Une autre inscription est une épigramme : « Je suis Chekkadh, fils de l’amrar. Il ménage sa personne » ; cette expression signifie craindre, redouter une fatigue, être aux petits soins pour soi-même. Pour les lecteurs qui seraient curieux de connaître un spécimen de la langue de ces inscriptions, en voici un des plus curieux : Dimardeq couaïen eïlaneq djannin hou fol chanem ouareq. Ce qui veut dire : « Ils chantent maintenant, ils ont crié hou auprès de ces tentes. »
7° Le district d’Akabli qui comprend six ksour. Les habitants font beaucoup de commerce avec le Soudan, et l’Akabli est un point de réunion des caravanes.
La colonne Servière quitta l’Aoulef le 21 juillet, se rendant au Touat.
(à suivre)
AUGUSTE TERRIER

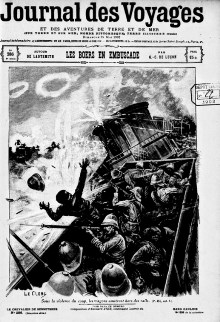
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 286 du 25 mai
1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


IV
AU TOUAT, L’ACCUEIL DES INDIGÈNES
En sortant de l’Aoulef, le général Servière arrivait en pays inexploré. Le Touat avait toujours été, au même degré que In-Salah, un centre de résistance à la France. Allait-on y trouver des hostilités, ou bien le prestige de nos précédentes victoires suffirait-il à nous ouvrir le pays ?
Dès les premières indications, on fut rassuré. Une petite caravane venue de Taourirt, et rencontrée le 22 juillet, annonça que les indigènes du Reggane avaient décidé de faire bon accueil à la France. En effet, le lendemain, dès que la colonne fut en vue du gros bourg de Taourirt, les notables vinrent lui souhaiter la bienvenue : « Hier, dit le chef Mohammed ben Mohanèche, nous pensions avoir pour maître le sultan du Maroc Abd el Aziz. Aujourd’hui, notre seul maître est la France. Notre ville vous est ouverte, nous demandons seulement que les familles et les palmiers soient respectés. » Le général Servière les assura qu’ils n’avaient rien à craindre et que, désormais, la France seule les protégerait. Dans la ville, on trouva des délégués des autres ksour du Reggane, venus aussi pour saluer le représentant de la France.
Bientôt un petit marché s’ouvrit près du camp français. Mais les paiements étaient difficiles, car les indigènes ne connaissaient pas et refusaient la monnaie de cuivre. Il fallut établir un cours de comparaison entre les monnaies françaises et les diverses monnaies marocaines, arabes, tunisiennes, de toutes les époques, qui ont cours au Touat : la mouzouna, qui vaut le tiers d’une pièce de quatre sous ; le tliti, qui vaut trois mouzounas ; l’oukia, qui en vaut quatre ; le stiti, qui équivaut à notre pièce de cinquante centimes ; le stache, 1 franc : le mitkal, 2 fr 50; le douro de Marie-Thérèse, de 3 francs à 3 fr 50; enfin, l’écu français de 5 francs, que les Touatiens appellent le cinco.
De Taourirt, le général envoya une reconnaissance vers Timadanin, ville située à deux heures de marche et qui avait spontanément envoyé sa soumission ; la kouba de cette ville est d’une architecture assez élégante, et elle offre cette singularité que le dôme central est terminé par une bouteille en verre ordinaire : c’est, parait-il, une bouteille rapportée de Tombouctou, à travers le Sahara, par une caravane qui l’a placée là en commémoration de son retour heureux.
Le groupe d’oasis qui succède au Reggane, en remontant vers le Nord, est le Sali. L’organisation en est curieuse. Il n’y a ni djemâa, ni chef. Dans chaque district, les affaires publiques sont délibérées dans une assemblée générale, où chaque famille envoie un délégué et qui n’a pas de président : c’est le parlementarisme dans sa forme la plus simple et la plus pratique. Les individus qui ne se conforment pas à la décision de l’assemblée sont punis d’amendes dont le produit sert à indemniser les habitants qui ont participé aux dépenses de réception des hôtes de passage, car il est d’usage que tous les étrangers soient hébergés dans les ksour où ils se présentent, et les frais de l’hébergement sont supportés par les habitants qui en ont le moyen. Il n’y a ni impôts ni taxes d’aucun genre, et toutes les transactions se font par actes sous seing privé. Le vol est rare. Le voleur est condamné à restituer le produit de son larcin et à payer une amende. Le meurtrier est remis aux parents de la victime qui peuvent le tuer, mais généralement il offre la dia ou prix du sang.
Le 26 juillet on se remit en route, toujours au Nord, dans la zone plus inconnue encore du Zaouiet Kounta. C’est de là qu’on pouvait craindre une attaque, mais le général fut vite tranquillisé par la lettre suivante qu’il reçut à Bou-Ali et dont nous jugeons curieux de reproduire le texte :
« De la part de Mohammed ben Kaddour et Abd el Kader ben Allal, khenafsa du Kef :
Cimetière et Koula de Sali« Venus pour faire du commerce à Timmi, nous avons appris qu'un grand chef, appelé général, s’était rendu au Reggane. Tous les kebars du Timmi se sont réunis et ont décidé qu’ils n’attaqueraient ni le général ni personne de son goum. La route est telle que vous pourriez porter sur votre tête de l’or et de l’argent : nous voulons dire que vous n’aurez rien à craindre en chemin jusqu’au pays de Timimoun. Nous avons engagé le porteur de notre lettre moyennant 20 francs, remettez-les-lui, ô chef, ô général. Ce messager est de l’Aoulef.
« Le salut. »
Il devenait probable que l’accueil serait le même partout, et en effet, quand on arriva le 27 juillet à Adrar (Zaouïa Kounta), centre religieux de grande importance, le marabout Mouley Mohamed ben Mouley Ismaïl était à la porte extérieure de la ville et offrit une diffa au général. Celui-ci refusa cette hospitalité trop généreuse, mais pénétra dans la ville et la visita: la population, silencieuse, était étreinte de peur au passage du général et de ses officiers ; elle se multiplia pour que la colonne ne manquât de rien.
Deux jours après, on arrivait à Tamentit, autre gros bourg du Touat. L’empressement des habitants paraissait moindre ici et un seul indigène vint au- devant du général, se disant envoyé par la djemâa. « Il n’est pas, lui répondit-on, dans les usages arabes, d’envoyer ainsi un seul représentant et on n'acceptera les offres faites que s’il vient un certain nombre de kebars. » Les kebars ou personnages (littéralement les grands) ne tardèrent pas à venir, mais sans le principal d’entre eux Ba Youssef, qui s’était caché par peur d’être emmené prisonnier. Ils apportaient du fourrage et en refusaient le prix, mais le général leur en fit accepter le montant pour être remis aux pauvres : les notables, on le sut plus tard, eurent soin de se partager sans vergogne ces 120 francs destinés à... l’assistance publique.
L’Erg.
Tamentit est remarquable par les hautes murailles qui l’entourent et dont les fossés sont de très bonnes défenses : elle offre l’aspect d’une ville du Moyen Âge. On y trouve aussi une météorite célèbre dont le voyageur allemand Rohlfs a parlé ; elle est haute de 40 centimètres et large de 60 centimètres ; les indigènes disent que c’était à l’origine un bloc d’or qui s'est successivement changé en un bloc d’argent, puis de pierre, par la volonté de Dieu, pour punir les habitants qui se battaient pour la posséder. C'est le centre industriel de la région. On y fait notamment des bijoux réputés, bracelets, anneaux, clefs spéciales, bagues à parfum; on dit que cette aptitude à l’industrie des gens de Tamentit leur vient d’ancêtres juifs.
Ces bagues à parfum portent en guise de châton une boite rectangulaire de deux centimètres de côté, avec un couvercle mobile qui, lorsqu’il est fermé, s’élève en pointe ouvragée d’un joli effet. Quant aux clefs, ce sont, dit le commandant Laquière, dont les rapports sont vraiment remarquables d’attention minutieuse et d’observations de détail, de véritables objets d’art de ferronnerie. Elles sont en fer poli, assez semblables à celles qu’on fait au Soudan. C’est Tamentit qui en fournit toutes les oasis. Les indigènes les portent suspendues, ainsi que leur couteau et leurs amulettes, à un large anneau de laiton, fendu de façon à pouvoir s’ouvrir sous un certain effort et faisant office d'anneau brisé ; cet anneau, dont tout homme est porteur, est gravé de dessins en creux. Il s’attache aux vêtements, sur l’épaule gauche, par une cordelette en cuir tressé, et pend sur la poitrine avec tous les objets qu’il supporte : telles les Parisiennes de nos jours laissent pendre à leur corsage une collection variée de breloques.
Une nouvelle marche amena la colonne, le 30 juillet, devant la ville d’Adrar, qui compte 24 ksour et qui est le chef-lieu de l’oasis du Timmi. C’est le centre politique du Touat et c’est là que résidait le pacha marocain, fait prisonnier à In Rhar et interné à Laghouat. On fut de suite fixé sur les intentions de la ville, car la djemâa vint souhaiter la bienvenue au général et lui demanda la mise en liberté du frère de Mohammed-Abderrhaman, chef principal du pays. À quoi le général répondit que la liberté serait rendue au prisonnier si les habitants du Timmi demeuraient sages et tranquilles. « Nous avons pour nous la force, ajouta-t-il, nous savons punir, mais nous sommes aussi très généreux.
La casbah de Tamentit. (Photographies communiquées par le commandant Laquière.)
Une des rues de Tamentit.
La venue des Français sera pour les habitants un bienfait, leur commerce et leur industrie se développeront, ils n’auront rien à craindre pour leur religion, leurs familles et leurs biens. »
Ce discours produisit son effet, si bien que, le soir, les gens d’Adrar ayant su qu’on avait informé le camp français de la possibilité d'une attaque, vinrent en délégation assurer le général de leurs intentions pacifiques. Et, défait, la nuit se passa sans incidents et le lendemain nos officiers purent visiter la ville. Elle contient de nombreuses casbahs une population importante, et c’est le centre stratégique du Touat. Comme dans tout le Touat, le costume des habitants est ici très simple et même sommaire. Les enfants vont nus ou à peu près. Les hommes portent une courte chemise qui s’arrête à hauteur des genoux et dont les manches ne dépasse pas le coude. La tête est couverte d’un petit bonnet pointu en coton blanc, qui ne protège que le haut du crâne.
Le séjour à Adrar était le fait politique principal de la reconnaissance du général Servière. La seule oasis importante traversée ensuite par la colonne fut celle de Deldoul, où s’était autrefois réfugié Bou-Amama, le chef de la révolte de 1881. La maison du célèbre agitateur est devenue un lieu de pèlerinage et la légende veut que tous ceux qui y pénètrent soient atteints de fièvre. L’oasis de Deldoul est une des plus belles. Le commandant Laquière la décrit d’une plume pittoresque en quelques traits : « À cent mètres de la maison de Bou-Amama, l’oasis très douce, très vigoureuse, superbe Tout d'abord le jardin dont Bon-Amama avait la jouissance. Il est à côté de la prise d’eau qui coule à gros bouillons, claire, fraîche, très légère, et forme, avant d’entrer dans les canaux de répartition, une rivière de plus d'un mètre de largeur. La végétation est splendide ; sous les palmiers très élevés poussent en grande quantité des légumes et des céréales, de beaux figuiers et de la vigne grimpante. »
Mais ce n'était pas seulement l’attrait de l’oasis qui avait amené Bou-Amama à Deldoul. Ainsi établi à la croisée des routes du Maroc et de l'Algérie, il était certain de n’être jamais surpris ; de plus les excellents pâturages qui entourent Deldoul y retenaient les dissidents qui formaient sa garde et ses partisans. Aussi est-il demeuré là jusqu’à notre action dans les oasis : il s'est alors réfugié au Maroc, mais il a engagé à diverses reprises des négociations pour demander l’aman (pardon) et il ne semble plus inquiétant pour nous.
Le 7 août 1900, la colonne arrivait au poste français de Timimoun, capitale du Gourara, et le 18 à El-Goléa. En deux mois, elle avait pris possession pacifiquement de cette région du Touat, jadis si redoutée. Il avait suffi de montrer un peu d’énergie pour que les ksouriens se soumissent à nous. Rien n’indiquait mieux que nous aurions pu, depuis plusieurs années, nous rendre maîtres des oasis.
En achevant le carnet de route qu’il avait tenu pendant le voyage que nous venons de raconter, le commandant Laquière résumait ainsi ses impressions :
« Du 21 juillet au 7 août 1900, il nous a donc été donné de parcourir la région du Touat proprement dit, de son extrémité sud : Taourirt, dans le Reggane, à sa partie la plus septentrionale, Sbâ, ainsi que la région encore inexplorée du Gourara qui est au Sud de Deldoul.
« Cette exploration, amenée par les événements, a permis de se rendre un compte précis de la géographie de ce pays, qu’aucun Européen n’avait parcouru depuis le passage de Gérard Rohlfs, en 1861.
« C’est une région riche en palmiers, formant une bande d’oasis et de ksour de près de 200 kilomètres de long, du Sud au Nord. L’eau y coule partout très abondante dans des foggara le plus souvent à fleur du sol, et il est à croire qu’avec nos procédés modernes on en augmenterait le volume actuellement débité.
« Les dattes, qui forment le principal objet de trafic, sont particulièrement estimées des indigènes. On trouve aussi du blé en assez grande abondance, et, dans la région comprise entre le Sali et Tamentit, du tabac et du henné, articles d'exportation dont il y a lieu de tenir compte.
« Enfin, le pays ne présente aucune difficulté pour rétablissement d’un chemin de fer, dont il parait être la voie la plus naturelle vers le Soudan.
(à suivre)
AUGUSTE TERRIER

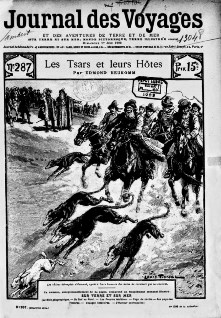
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 287 du 1er
juin 1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


V
LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS ET LA QUESTION DE FIGUIG
Le voyage du général Servière eu 1900 s’était passé sans combats, les villes et les oasis s’étaient ouvertes devant lui et il semblait que la France dût se hâter d’établir dans ces oasis sa domination appuyée sur quelques postes, très suffisants pour maintenir l'ordre. Malheureusement on tergiversa, on hésita, faute d’entente et de décision, à envoyer quelques troupes à cette oasis d’Adrar que nous avons décrite comme le centre politique du Touat.
Aussi, dès la fin d(août, les adversaires de l’influence française reprenaient courage et attaquaient à Sahela Metarfa, près de Timimoun, une reconnaissance et nous tuaient deux officiers. Le général Servière fut envoyé une seconde fois au Touat eu janvier 1901. Il s'agissait d’établir définitivement la domination française. Le 26 janvier 1901, le général était à Timimoun avec une colonne forte de 600 hommes et se rendait à Sahela Metarfa où avait eu lieu l’attaque de la fin d’août. Toutes les oasis envoyèrent des délégués, affirmant que les attaques étaient dues aux Berabers nomades. Mais comme on venait d’apprendre que le poste de Timimoun avait été attaqué, le général remonta au Nord et, le 28 février, à Charouïn, il repoussait les Berabers, puis leur faisait donner la poursuite dans les dunes : l’opération, brillamment menée, nous coûta cependant deux officiers tués, le capitaine Ramillon et le lieutenant de la Hellerie : on retrouva le corps du premier déchiré, les moustaches arrachées, le visage couvert de blessures. La Djemâa de Charouïn vint le 3 mars faire sa soumission, mais, à titre de punition, on exigea des otages et le démantèlement des casbahs. Le 9 mars, il fallut encore combattre avec l’oasis de Talmin qui avait suivi l’exemple de Charouïn. On se rend compte de la difficulté de ces campagnes quand on se rappelle ce que nous avons dit du manque d'eau dans tout le pays. Talmin est, en effet, au milieu des sables : c’est l’Erg, « mer mouvante de sable ténu s'élevant en vagues de plus de cent mètres, infranchissable pour nos mulets d’artillerie et notre convoi de munition ». (C‘ Laquière.) Il fallait donc à chaque étape se renseigner sur les points d’eau de cette autre terre de feu : on les appelle des nebas et il faut les connaître, car rien ne les laisse deviner et un étranger au pays pourrait mourir de soif au-dessus de l’eau sans se douter de sa présence : au point voulu on creuse le sable et à un mètre l’eau apparaît, très bonne et très claire.
Les habitants de Talmin, en voyant arriver la colonne formée en deux parties, ouvrirent le feu les premiers, cachés dans leurs jardins clos de haies en branches de palmiers. Nos troupes les délogèrent de jardin en jardin et bientôt toute la population fut enfermée dans la casbah. Le général Servière allait faire ouvrir le feu, quand on vit sortir les femmes et les enfants que la Djemaâ envoyait à l’abri du feu dans un petit ksar. Naturellement le feu s’arrêta par respect de cette population inoffensive et l’on profita de ce court répit pour occuper les positions élevées des dunes d’où on pourrait bombarder et incendier le village s’il était nécessaire de recourir à cette extrémité. Mais la Djemaâ envoya à ce moment une lettre de soumission acceptant à l’avance toutes les conditions. Ici encore il fallut imposer un châtiment : le général exigea des otages, dont le vieux caïd, qui avait été l’âme de la résistance, et une contribution de guerre.
Pendant que le commandant Laquière allait faire une reconnaissance dans l’Aouguerout, le général Servière descendait de nouveau jusqu’au Tidikelt et revenait au Gourara le 8 avril 1901. À Ksabi il faisait sa jonction avec les troupes de la division d’Oran qui venaient d’occuper la vallée de l’Oued Saoura et de fonder des postes à Béni-Abbès, à lgli, à Taghit, etc. Le 8 mai, il était de retour à Alger, laissant cette fois les oasis-définitivement soumises.
Ce second voyage, dont nous devons également le récit au commandant Laquière, avait permis de se rendre un compte plus exact des grandes divisions du Gourara, du Touat et du Tidikelt, et notamment de la division de leurs populations en soffs (ou çofs) dont nous avons déjà dit quelques mots.
Lhamer Tamrst
Cette division est ancienne et répandue comme l’était jadis la séparation des Guelfes et des Gibelins. Les habitants des oasis sahariennes sont du soff lahmed ou du soff Sofian, par tradition, sans savoir pourquoi, et naturellement les deux soffs étaient en rivalité politique, et souvent en lutte ouverte. Aussi, le Maroc, quand il avait tenté d'établir un embryon d'organisation politique dans les oasis, avait eu soin de désigner deux pachas : un au Timmi, pour le soff lahmed; l’autre Timimoun, pour le soff Sofian. On a vu que la conquête française des oasis avait commencé par In-Salah et le Tidikelt. Ce pays étant lahmed, le pacha du Timmi, avec des contingents recrutés dans ce soff, s’était donc porté au secours du Tidikelt et avait été fait prisonnier à In-Rhar ; mais les Sofian du Touat, ne se considérant pas comme solidaires des lahmed, avaient refusé d’aller à leur secours, et c’est à cette division que nous avons dû de ne pas rencontrer une hostilité générale des ksouriens. Par contre, dès que le Tidikelt fut conquis, les lahmed se soumirent et les Sofian devenaient sinon hostiles, du moins méfiants et réservés. Aujourd’hui les deux soffs semblent avoir reconnu notre domination. Le chef des lahmed, Mohammed Abderrhaman, caïd de Timmi. est convaincu que la France lui laissera son prestige et y ajoutera les honneurs qu’elle a déjà accordés aux grands chefs de l’Algérie. Quant aux Sofian, la défaite du caïd de Bouda les a découragés de toute résistance.
InzegmirEntre ces deux grands partis, la diplomatie de nos officiers du Touat n’aura pas de peine à régner. Au cours des divers incidents que nous venons de raconter on a vu à plusieurs reprises l’action du Maroc, qui, nous l’avons dit, avait espéré devenir le maître des oasis. Il apparaissait nettement que les agents du Maroc étaient les instigateurs de ces troubles. Aussi est-ce au sultan du Maroc que notre gouvernement s’en plaignit. Le sultan envoya alors à Paris une mission qui conclut avec nous un traité (juillet 1901), relatif à la répartition des tribus entre les deux pays. C’est à la suite de ce traité qu’une commission mixte franco-marocaine est allée en février 1902 inspecter la région au Sud d’Ain-Sefra et de Duveyrier, et qu'il a été décidé qu’un officier français resterait désormais en permanence dans la ville marocaine de Figuig pour surveiller la frontière. Le délégué marocain était Si-Mohammed el Guebbas et le chef de la délégation française le général Cauchemez, un des plus experts de nos officiers du Sud- Oranais. En réalité, le Maroc n’avait qu’une autorité toute morale à Figuig et ce fut surtout grâce au voisinage de nos troupes que Guebbas y fut bien reçu.
Les gens de Figuig s’étaient vantés de ne jamais ouvrir leurs ksour aux roumis, et quelques jours avant l’arrivée de Guebbas et du général Cauchemez, venus ensemble par le chemin de fer d’Ain-Sefra qui est prolongé jusqu’à Djenan-ed-Dar, ils avaient assassiné deux officiers français, les capitaines Gratien et de Cressin, qui se promenaient dans le voisinage du poste de Duveyrier. Aussi, furent-ils surpris quand ils virent le représentant du sultan du Maroc arriver avec des soldats marocains, accompagné d’officiers et de soldats français !
L’accueil fut plutôt médiocre. Les ksouriens de Figuig, surtout les premiers jours, affectaient de supporter avec peine la vue de nos soldats et ceux-ci entendaient souvent dire, en se promenant dans les ksour : « Les chiens passent là, ils peuvent bien y passer aussi ! » Ceux qui ne se bouchaient pas le nez auprès des Français disaient que si le sultan n’en avait pas donné l’ordre, les infidèles ne boiraient pas de leur eau.
D’ailleurs, un seul officier français est demeuré à Figuig comme résident. Les autres se sont bornés à visiter l’oasis qui est fort belle. Ce point de Figuig aura, dans l’histoire de nos relations avec le Maroc, assez d’importance pour que nous en parlions un jour avec détails aux lecteurs du Journal des Voyages. Mais disons, dès à présent, que Figuig semble la perle du Sud-Oranais. L’eau y coule à pleins bords, formant de véritables cascades; à l’ombre de la forêt de palmiers vit tout une végétation tropicale, grenadiers, figuiers ; partout de l’orge très belle. Les divers villages qui forment l’oasis sont propres, malgré leurs nombreux passages couverts. Ils sont peuplés et témoignent d’une certaine activité commerciale. Certaines maisons sont très soignées et ont des petites fenêtres en arc ornées de grilles en fer forgé. D’autre part le chemin de fer qui va actuellement d’Ain-Sefra à Djenan-ed-Dar sera prolongé jusqu’à Igli et nous permettra d’exercer une surveillance et une action politique dans cette partie du Maroc, car on établit une station à 1,500 mètres seulement de Figuig, à Beni-Ounif. Il est permis d’espérer que cet arrangement mettra fin aux incidents de frontières qui se produisaient trop souvent entre la France et le Maroc. Il y aura sans doute encore, dans la région de Figuig, des affaires, peut-être quelques combats, mais nous les réglerons de concert avec le représentant du Maroc dans cette oasis.
Évidemment, rien ne nous serait plus facile que de prendre Figuig de force le jour où le Maroc ne serait plus en mesure d’y garantir la sécurité, et quelques décharges d’artillerie suffiraient à calmer la résistance des ksouriens. Mais ce serait, pour nous, intervenir militairement au Maroc, et que se passerait-il alors ? L’empire des Chérifs est vermoulu et anarchique, et le sultan est loin d’avoir une autorité réelle sur cet immense empire. Mais. si nous l’attaquons, les autres puissances demanderaient à partager les dépouilles. À peine nos armées auraient-elles franchi la frontière pour commencer la conquête, très longue et très laborieuse, du Maroc oriental, que l’Angleterre, par exemple, occuperait les forts et les vallées très riches qui avoisinent l'Océan. Nous n’aurions, nous, que les sables.
Au contraire, les Français doivent être pour le Maroc des collaborateurs dévoués, et sans doute, plus tard, des protecteurs. Il faut, à cet État anarchique et en décadence, l’intervention morale et amicale d’un État européen. Nous sauverons et nous rendrons prospère le Maroc comme nous avons sauvé et rendu prospère la Tunisie : l’empire voisin de l’Algérie est le complément naturel de l’Afrique française du Nord, et il ne cessera d’être indépendant, il ne sortira, comme disent les diplomates, du statu quo que pour devenir français.
Notre action au Touat et dans les oasis marocaines, en réglant définitivement la situation de ces territoires, a terminé une ancienne difficulté pendante avec le Maroc, et nos rapports avec le gouvernement marocain (le Maghzen) se sont ainsi bien améliorés Tel est le résumé de l’établissement de la France au Gourara, au Touat et au Tidikelt. Nous avons pris plaisir à le présenter aux lecteurs du Journal des Voyages, car si les journaux français ont souvent publié des nouvelles de cette action saharienne, jamais ils n’en ont dégagé la marche d’ensemble, et il appartenait à notre journal, toujours en quête des faits de notre histoire coloniale, de compléter cette lacune.
Puits aménagé dans l’Oued Méguiden. (Photographies du commandant Laquière.)
Oasis des ouled Rached (Gourara). — Dunes artificielles.
Porteurs de paille.(à suivre)
AUGUSTE TERRIER

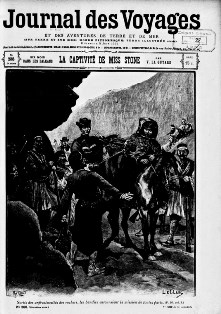
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer n° 288 du 8 juin
1902
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


VI
LA VALEUR DES OASIS ET LE TÉLÉGRAPHE TRANSSAHARIEN
Les lecteurs du Journal des Voyages qui ont bien voulu suivre, à travers nos précédents articles, — ou plutôt à l’aide des remarquables photographies dont l’obligeance du commandant Laquière, du capitaine Clausse et du lieutenant Martial nous a permis de les illustrer, — l’histoire de l’occupation des oasis sahariennes se sont déjà certainement posé une question :
« Que vaut pour nous ce pays de sable dont la population n’est pas très dense, dont les productions sont rares et où le ravitaillement des postes et des colonnes est si onéreux ? Est-ce la peine de tant dépenser pour un si mince résultat ? »
C’est à cette question que nous voudrions répondre en terminant notre étude.
Nous avons déjà montré l’importance de l’occupation des oasis au regard de notre politique au Maroc : elle a réglé un différend que nos rivaux anglais et allemands pouvaient exploiter contre nous, et, tout en évinçant définitivement le Maghzen marocain du Touat et d’In-Salah, elle a amélioré nos rapports avec le Maghzen du jeune sultan Abd-el-Aziz.
De plus, les oasis étaient le refuge de tous nos adversaires. C’est là que se réunissaient tous ceux qui conspiraient contre la France, les fanatiques musulmans, les marabouts qui redoutaient notre contrôle et les pillards et coupeurs de route qui craignaient notre police. C’était un foyer d’agitation antifrançaise, d’où était parti le signal de tous les crimes qui se sont accomplis depuis trente ans dans le Sud-Algérien. On pardonnera à notre vive admiration pour le grand écrivain oublié que fut Émile Masqueray de rappeler quelques traits du merveilleux tableau où il faisait revivre la propagande anti-française qui se faisait au Touat et à In-Salah et les prédications des ksouriens contre nous.
« Il semble, écrivait-il, que Dieu les ait créés tout exprès pour qu’ils nous haïssent. Musulmans fanatiques, sémites de toutes nuances, esclavagistes, hommes anciens et presque immuables sur le seuil de l’humanité, ils sont en lutte contre nous par antipathie de race, de religion, de temps même ; car on dirait que les siècles sont ennemis comme les peuples, quand ils se rencontrent. Mais il y a plus encore. Tout ce qui nous déteste dans le grand désert, tout ce qui nous craint, tout ce qui s’effraye par avance de nous y voir creuser des puits, aplanir des routes, ouvrir enfin à la civilisation moderne ce grenier de chair humaine qu’on appelle le monde noir, les dresse contre nous comme un obstacle, les prêche sans cesse, les encourage et les excite jusqu’à la folie. Elles tendent toutes vers leur lagune salée et leurs bourgades de terre, les caravanes de Ghadamès qui vont porter jusqu’au Sud du Maroc les verroteries de l’Italie, le thé et le calicot de l’Angleterre. Elles passent loin de nous par le travers, au Sud d’Ouargla, évitant de toucher un seul point de la terre des Infidèles. Ceux-là sont chargés d’idées de révolte universelle, de projets panislamiques et d’invitations à la guerre sainte ! Pendant un mois de marche le long de la Tunisie et de l’Algérie, ils maudissent la France et, quand ils descendent à Ksar-el-Kébir, leur premier mot est : « Prenez garde à la France, « haïssez la France ! »
« Là aussi aboutissent les caravanes de l’Ouest parties du pied des montagnes neigeuses qui dominent le Maroc et Fez. Elles aussi sont suivies par de dévots pauvres et des ascètes aux joues creuses qui vont en sens inverse visiter les sanctuaires de l’Islam ; mais il s’y mêle une espèce nouvelle, agents de l’Allemagne et de l’Italie, courtiers véreux, futurs caïds, affamés et hardis comme des chacals, qui s’entendent à merveille avec les fanatiques de la Tripolitaine. Quand ils entrent dans In-Salah, c’est le Maroc qu’ils amènent avec la Triple-Alliance, et les voilà sur les marchés, poussant à l’action, invectivant les timides, dénonçant les suspects et murmurant à l’oreille des exaltés, non plus : « Défiez-vous de la France ! » mais : « À bas la France ! « Sus aux Français ! »
Aujourd’hui, cette propagande est terminée et nous avons augmenté ainsi la sécurité de notre Extrême-Sud-Algérien.
Cette importance stratégique et politique des oasis sahariennes l’emporte de beaucoup sur leur valeur économique. On a vu que leurs productions consistent surtout en palmiers et céréales, suffisant à faire vivre leurs populations, mais non à assurer une exploitation rationnelle. Évidemment la sécurité que nous y avons établie va développer le nombre des cultures et des palmeraies. Nos officiers apprennent aux indigènes à faire des routes, à creuser des puits, à améliorer leurs procédés de culture, et les forages artésiens déjà opérés donnent des résultats très satisfaisants. Mais nous ne devons pas compter faire de ces oasis un territoire de colonisation ni même d’exploitation, et il faut qu’elles nous coûtent le moins possible.
Déjà par la faute du peu d’entente qui a régné entre les diverses autorités militaires et civiles, la conquête a coûté fort cher, et, pour le ravitaillement, on a employé et fait mourir des milliers de chameaux dont les squelettes jonchent les diverses pistes qui vont d’El-Goléa vers les oasis. On s’est à peu près décidé à donner à ces territoires leur autonomie : ils auront un budget spécial alimenté par un léger impôt indigène et par quelques taxes, et les dépenses consisteront surtout en travaux publics. De plus, l’administration française serait représentée par quelques officiers des affaires indigènes et les troupes employées seront des troupes sahariennes vivant sur le pays : quelques cavaliers et méharistes feront à bon compte la besogne de police sous le commandement de nos officiers du Sud. Mais l’intérêt principal des oasis au point de vue commercial est qu’elles étaient un lieu de passage et de réunion des caravanes qui font le trafic entre le Soudan et l’Afrique du Nord. On sait que le Sahara peut être justement comparé à une vaste mer, dont les vaisseaux sont les caravanes. Beaucoup passaient au Tidikelt et au Touat pour aller au Maroc.
La captivité de Miss Stone
Une rue de Sérès
Depuis que l’Algérie était française, elles n’y venaient plus, mais se rendaient au Maroc, d’une part, et à Tripoli, de l’autre, se rejoignant dans le Sahara, en plein désert, au Sud de notre Algérie. On a déjà tenté à plusieurs reprises de les détourner de ces deux buts et de les ramener à Ouargla ou à Ain-Sefra.
On a même, en 1896, créé dans l'Extrême-Sud des marchés francs, c’est-à-dire où les marchandises arrivaient sans payer de droits de douane, de façon que les caravaniers, y trouvant les marchandises qu’ils importent au Soudan, le sucre notamment et les cotonnades, à meilleur marché qu’à Tripoli ou à Fez, y vinssent régulièrement. Ce système a donné peu de résultats. M. Révoil, le gouverneur général de l’Algérie actuel, qui dirige notre politique saharienne avec une remarquable compréhension des intérêts de la France, a été plus avant dans cette voie : il a fait signer le 1er février dernier un décret qui exempte des droits de douane pour le Sud les toiles de coton, les guinées de l'Inde française et les thés de toute provenance. On pourra ainsi rompre le commerce que les Marocains et les Tripolitains font avec le Soudan, à l'exclusion de notre Algérie.
*
* *
Voici, en effet, arrivé le moment où l’Algérie n’est plus fermée au Sud. Jusqu’à ce jour, nos cartes portaient sans discontinuité la teinte française, de la Méditerranée jusqu’au Soudan et au Congo. Mais, en fait, l’Algérie était bornée au Sud par le Sahara où nous n’étions pas les maîtres. La barrière, c’était le Touat et les oasis ; elle est brisée, et on s’occupe de réaliser cette jonction de l’Algérie avec le Soudan, qui n’avait pu être opérée jusqu’à ce jour que par la mission saharienne Foureau-Lamy.
Pendant de longues années cette jonction s’était résumée aux yeux du public sous la forme d’un chemin de fer transsaharien. Que de projets ont été formulés, étudiés, allant les uns à Tombouctou, les autres au lac Tchad ! C’est pour examiner la possibilité de l’un d’eux que la mission Flatters alla se faire massacrer à Bir-el-Gharama, en 1881. Depuis lors, le projet a été abandonné ou, tout au moins, ajourné, et l’on recule, jusqu’à nouvel avis, devant l’énormité des dépenses que coûterait la pose du rail à travers les vastes espaces désertiques, et devant les faibles résultats commerciaux qu’il donnerait : l’exemple du succès du Transsibérien russe, dont le but et les ressources sont autres, ne convainc pas les sceptiques du Transsaharien.
Aussi est-ce à un projet beaucoup plus simple et plus immédiat que l’on semble se rallier aujourd’hui : celui d'une ligne télégraphique reliant l’Algérie à Tombouctou.
Du Touat, le fil télégraphique (ou une ligne de postes de télégraphie sans fil) irait jusqu’au Niger, un peu en aval de Tombouctou, et au lieu de faire passer par les câbles sous-marins anglais nos dépêches pour nos colonies du Sénégal, du Soudan, de la Guinée, de la Côte-d’Ivoire et du Dahomey, nous les ferions parvenir par une ligne terrestre entièrement française.
Que se produirait-il en effet actuellement, au cas où un conflit éclaterait entre la France et l’Angleterre ? Nous nous trouverions dans l’impossibilité de donner des ordres télégraphiques à ces colonies, car le premier soin de nos adversaires serait d'accaparer et de nous fermer les câbles télégraphiques, qui appartiennent à des compagnies anglaises ; eussions-nous des câbles nationaux que leur marine, probablement maîtresse de la mer, les couperait. Nos troupes de l’Afrique occidentale seraient donc sans communications avec la France. Au contraire, si le fil télégraphique joint Alger à Tombouctou et au Sénégal, notre armée d’Algérie-Tunisie sera en relations permanentes avec celle du Sénégal-Soudan.
*
* *Pour établir ce fil il suffira de jalonner de quelques postes (Telaya, Timissao, Inchouchaïe, etc.) la route de Tombouctou à In-Salah.
Ces postes, occupés par des méharistes, communiqueraient constamment entre eux et il serait possible, en cas d’hostilités, de faire parvenir assez rapidement aux troupes du Soudan des cartouches et des munitions fabriquées en Algérie, ce qui serait d'autant plus précieux qu’au Soudan les cartouches Lebel n’ont leur force que pendant une année : la poudre perd son effet par suite de la trop grande chaleur, et la balle ne porte plus qu’à cent ou deux cents mètres.
Ainsi la future jonction télégraphique nous rendrait indépendants des câbles anglais. Ajoutons, pour être complet, qu'à côté de ce projet, que nous savons être soumis au gouvernement et favorablement accueilli en principe, un projet privé, non moins intéressant, dû au colonel Monteil, l’explorateur bien connu, tend à établir cette ligne télégraphique en partie sous terre, non pas du Touat à Tombouctou, mais de Gabès (Sud tunisien) au lac Tchad.
Quant au tracé du Touat à Tombouctou, il a déjà fait l’objet de longues études, notamment au Soudan où les officiers du premier territoire militaire ont opéré de nombreuses reconnaissances et engagé avec les nomades des relations utiles.
L’occupation du Touat et d'In-Salah l’a rendu possible, et, sans doute, il amènerait la soumission des Touareg Hoggar, qui nous sont jusqu’à ce jour demeurés hostiles.
C’est l’œuvre de demain, et le gouvernement français est résolu à la tenter. Vaste projet, plus efficace que les chimériques chemins de fer transsahariens, trop coûteux ! La France, en travaillant à sa réalisation, prouvera que l'Afrique, même conquise, reste la terre des prodiges et des grands exploits.
Groupe d'indigènes près d’Adrar. — L'abreuvoir, entre Telmin et Charouin
L’Oued Mia. (Route d’El-Goléa à In-Salah, 19oo)
Fort Mac-Mahon
AUGUSTE TERRIER