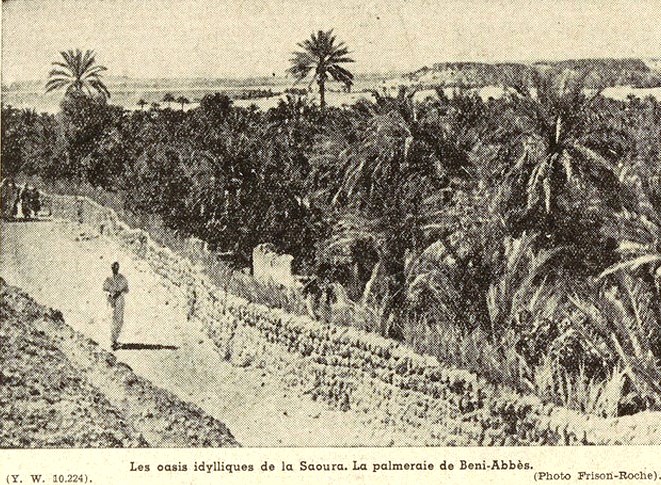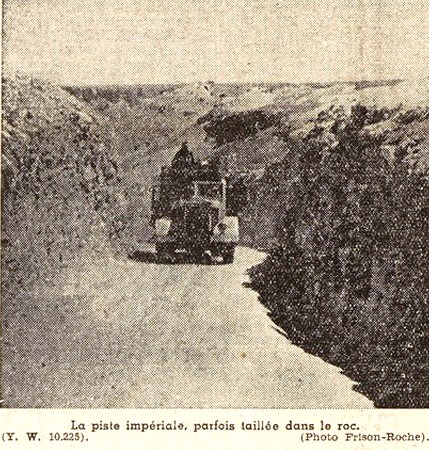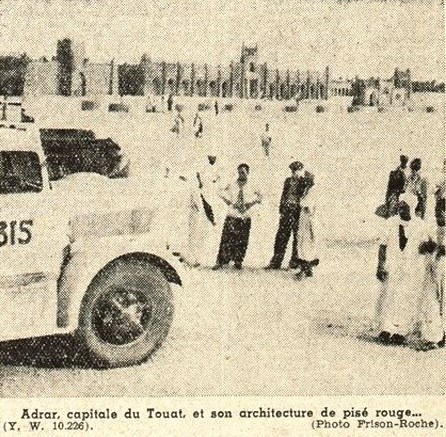Nous
avions quitté Béchar comme la chaleur tombait.
Toute la journée le vent de sable avait soufflé
semblant vouloir, par sa persistance, nous décourager
de tenter l’aventure ; l’aventure ? Non pas
! Une simple expérience plutôt. Il s’agissait
tout bonnement d’aller par-delà les regs, les
sables et les hamadas du Sahara chercher en Afrique Noire
ce qui nous manque le plus à l’heure actuelle
: du carburant. Dans la cabine du lourd camion, nous rêvions,
les yeux fixés sur la piste monotone qui s’enfonçait
dans l’infini des solitudes. Peu à peu les
rafales de vent se calmèrent et comme nous escaladions,
à l’heure vespérale, les premières
rampes du tragique Djebel Arnal, le calme se fit soudain.
Le sable en suspens s’égoutta doucement, dévoilant
un paysage calciné, tourmenté et irréel
tout doré par les derniers rayons de soleil. On n’entendit
plus bientôt que le ronronnement puissant du moteur
qui, sans faiblir, nous emportait vers le Sud.
Béchar,
capitale industrielle du Sud
Colomb-Béchar
! Qui reconnaîtrait dans cette ville moderne le Béchar
d’il y a dix ans seulement. Tout est transformé,
agrandi, vivant, animé. Béchar, simple poste
saharien, est devenu la Capitale Industrielle de l’Afrique
du Nord. Le désert s’efface devant l’assaut
des voies ferrées qui le mangent chaque jour, des
lignes télégraphiques qui jalonnent le reg
de leurs poteaux filiformes, des pistes aux dimensions impériales
qui s’entrecroisent au petit bonheur et dans toutes
les directions. De tous côtés des chantiers
se créent, des forages s’exécutent,
et la nuit comme le jour on peut entendre le bruit sourd
des machines qui arrachent au sol ses trésors minéraux,
Il n’y a pas place ici pour parler du charbon de Kenadsa,
c’est un sujet qui mérite à lui seul
plus ample développement ; nous y reviendrons.
Certes Béchar a perdu de ce fait une grande partie
de son charme ; il faut, pour le retrouver, aller rêver
le long de l’oued qui coule à plein bords en
ce printemps pluvieux...
Pour l’instant, nous sommes quatorze, répartis
tant bien que mal sur trois camions qui se dirigent au rythme
cadencé des pistons vers Gao la mystérieuse,
vers le Niger aux eaux troubles, vers l’Afrique Noire
si pleine de promesse.
La piste est belle. La tôle ondulée apparaît
certes un peu partout, mais il y a tant de trafic sur ce
secteur que c’est chose normale et les chocs nous
bercent plutôt qu’ils ne nous gênent.
Bientôt nous ne verrons plus du désert que
ce que nous laisse entrevoir le faisceau des phares : les
bossellements de la piste, et, de chaque côté,
le mur de nuit dressé comme une barricade jusqu’au
plafond d’étoiles. Des gerboises, des lièvres
traversent la route. Le chauffeur fixe comme dans une rêverie
les cent mètres de son paysage, et la piste qui se
continue en un interminable ruban.
Mon compagnon s’éveille d’un songe :
— Réussirons-nous ?
— C’est certain, vieux ! Ne doutons plus, nous
avons œuvre utile à faire là-bas.
Une
piste neuve surgit
au rythme des concasseurs
On
a dîné sur le bord de la piste. Abderrahmane
et Brika, nos deux boys, ont fait flamber des branches épineuses.
Le méchoui se rôtit doucement sur la braise,
et la sherba aromatisée bouillonne sur son foyer.
Chacun s’étend à même le reg,
heureux de respirer, heureux surtout de goûter le
calme des solitudes ; la fraîcheur brutale tombe ;
on s’enveloppe dans son burnous et l’on songe.
Puis il faut repartir, dans la nuit, jusqu’à
ce que le chauffeur, les yeux clignotants de fatigue, débraye
de lui-même.
— Assez pour ce soir ! dit-il. Dormons !
Les néophytes déballent leur matériel
de camping ; les sahariens de la mission s’enroulent
dans leurs burnous, à même le sable et s’endorment
paisiblement. Tiens ! la lune vient de se lever derrière
cette gara tabulaire. Elle se promène sur le bivouac,
et il me semble qu’elle nous sourit. On voudrait pouvoir
veiller toute la nuit ; le calme est si complet, l’air
si pur, le ciel si beau ! La fatigue surgit qui nous écrase
dans un profond sommeil.
Un bruit puissant nous réveille. Des sons lourds
et mats, qui s’entrechoquent, se précipitent,
puis tout à coup s’arrêtent, mêlés
au fracas des pierres brisées. Un bruit de chantier
couvre le silence de l’aube rougeoyante. Où
sommes-nous ? Hier soir nous avions avancé mécaniquement
sur une piste excellente, puis nous avions fait halte au
petit bonheur, et voici que nous nous éveillons en
plein chantier. Des rouleaux compresseurs ahanent sur la
piste... sur la route, devrions-nous dire, car cette portion
au Nord d’Igli est en voie de goudronnage. Des concasseurs
tirent le matériel nécessaire de la gara voisine.
Dans un fond d’oued la palmeraie bruisselle sous le
vent d’Est. Déjà le soleil implacable
calcine ce désert minéral et les nappes d’air
commencent à vibrer au ras des pierres.
C’est maintenant un plateau dénudé,
un reg monotone qui se poursuit, bordé à l’Ouest
par de hautes dunes roses. Des oasis idylliques de la Saoura
nous ne verrons rien ; nous longeons le grand fleuve quaternaire,
sans le voir. Il suffirait pourtant de sortir de la piste
et de faire une pointe pour dominer tout à coup la
houle des palmes et apercevoir le poste de Beni-Abbès,
enchâssé dans les dunes du Grand Erg Occidental.
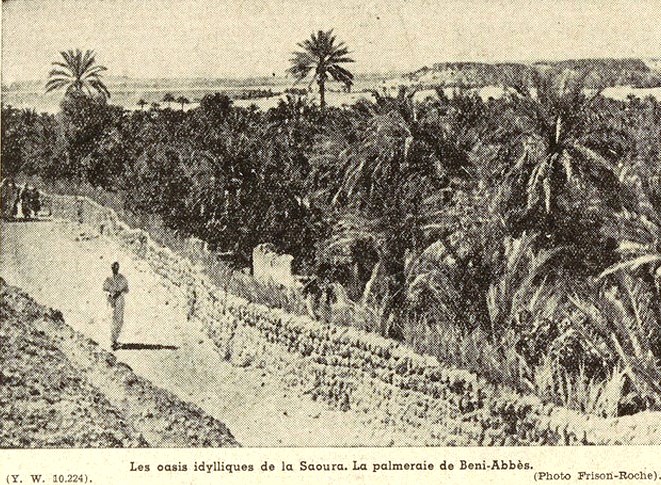
Dans
le lointain, maintenant, apparaissent des montagnes ; leurs
formes, indécises au début, se précisent
à mesure que nous avançons ; il nous faudra
cependant plusieurs heures avant d’en atteindre le
pied. De plateau en plateau la piste s’abaisse et
rejoint enfin la Saoura, qu’elle longe un instant
avant de s’engager par un défilé austère
dans les ravins de la Gardette.
Au passage, nous ramassons dans les oueds une solide provision
de bois mort ; plus au Sud, nous ne trouverons rien ; rien
jusqu’au Soudan, à 1 500 kilomètres
de distance.
Aujourd’hui
et jadis...
Le
Passage de la Gardette était, il y a quelques années
encore, entouré d’une fâcheuse réputation.
Une mauvaise piste serpentait à travers les gorges
encombrées de blocs et de cailloux, escaladait au
plus direct les petits cols qui se succèdent sans
interruption sur près d’une centaine de kilomètres.
Actuellement, la piste est large, bien taillée dans
le roc, son sol est caillouteux mais roulant, il y a même,
à certains endroits, des « sens unique ».
Le désert se civilise !
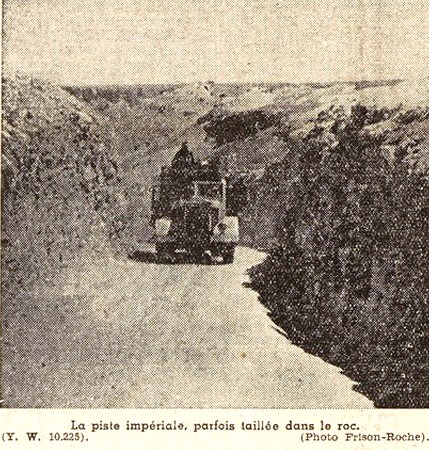
Une
haute barrière rocheuse nous sépare du lit
de la Saoura, bordé par les impressionnantes dunes
de l’Erg. De toute cette splendeur saharienne on ne
distingue rien, sauf quelques rares échappées,
qui permettent de contempler l’admirable situation
de Kerzaz avec son poste à coupole blanche sur lequel
flottent très haut nos trois couleurs. La France
veille aux confins de l’océan des sables.
Un dernier effort, et les camions parviennent au Col 15.
C’est une étroite brèche qui plonge
directement sur une immense sebkra à quelques vingt
kilomètres au Nord du Foum-el-Kheneg. La piste descend
sans un lacet, tantôt taillée dans le roc,
tantôt utilisant le thalweg d’un ravin sauvage
et ensablé. Nous avons avec nous de vieux sahariens.
Pour eux, ce passage évoque des journées de
souffrances et d’efforts pénibles. Aujourd’hui,
comme plus tard au retour, nous passerons directement au
poids total de vingt tonnes, sans rencontrer de difficultés.
« Autrefois », — nous dit Paulian, qui
fut l’un des pionniers de cette piste, — «
autrefois, nous cherchions notre voie au petit bonheur.
On déchargeait d’abord les camions ou les voitures,
puis on démarrait en première, l’équipage
poussant aux roues. On progressait mètre par mètre
pour hisser le véhicule jusqu’au sommet. On
s’ensablait parfois à la montée et il
fallait peiner pendant des heures pour dégager la
voiture. Puis, après, c’était le transbordement
à dos d’homme de la cargaison : l’aller
et retour inlassable, sous le soleil de feu, du mécanicien
et de son graisseur. On mettait parfois plus d’une
journée, surtout au retour, pour franchir le col.
Non ! les chauffeurs qui font la piste actuellement ne pourront
pas imaginer ce que fut le travail de leurs prédécesseurs.
»
— Et pourtant ! dit-je, vous êtes restés
fidèles à la piste.
— À chaque saison, on jure de ne plus descendre
vers le Sud, mais, à l’automne, on reprend
le volant ; l’attrait du Sahara est le plus fort.
Et puis, c’est une véritable vocation ; ceux
qui ne l’ont pas ne reviennent jamais. C’est
toujours les mêmes que vous retrouverez, pestant dans
le vent de sable, jurant en posant les « creshba »
sous les pneus lors des ensablements, démontant leurs
moulins sous le vent infernal, la bise glaciale ou la touffeur
d’une nuit d’été ; la piste a
ses apôtres et ses fidèles. Mais bientôt
ils disparaîtront, tués par le Progrès.
Est-ce une piste, ceci ? ... »
Et, dans un geste presque indigné, mon interlocuteur
me montre du doigt l’immense radier en surélévation
qui traverse les sables mouvants. « Regardez les vieilles
traces ! à droite et à gauche ! Alors on naviguait
au petit bonheur, et les plus malins y restaient parfois
des heures. Maintenant... pfuit !! un coup d’accélérateur,
et l’on se retrouve de l’autre côté
sur un terrain solide. »
La nuit tombait comme nous atteignîmes le Foum el
Kheneg. La Saoura y trace son lit dans une gorge étroite
pour s’épandre ensuite librement sur plusieurs
kilomètres de largeur. Ce n’était à
notre voyage d’aller qu’un oued asséché
rempli de végétation, mais quelques jours
après notre passage, l’oued, grossi des eaux
de la Zousfana, coulait de l’Atlas Marocain. On signalait
bientôt deux mètres d’eau à Beni-Abbès.
Les témoins virent la crue emporter en moins de six
minutes l’énorme digue sur laquelle passe la
piste. Ici, au Foum, ce fut la même chose ; en un
clin d’œil les blocs furent descellés,
et le radier s’éparpilla à travers les
sables, tandis que cette partie du désert à
450 kilomètres au Sud de Béchar, était
transformée en un véritable lac. Pendant un
mois les communications furent coupées.
Mais ce phénomène aura du bon : les pâturages
sont magnifiques un peu partout et les troupeaux de chamelles
arrondissent une bosse magnifique.
Sba,
l’oasis aux eaux vives !
Nous
ne ferons que passer au Foum ; il faut continuer, sans arrêt,
sans trêve. Nos poids lourds ne vont pas vite, mais
en marchant jour et nuit à 30 kilomètres de
moyenne, on fait son petit bonhomme de chemin. Le jour naissant
nous trouvera devant Sba, la première des oasis du
Touat ; la palmeraie vient mourir en bordure du reg sur
lequel passe la piste ; une piste magnifique, large et bien
entretenue. Entre notre voyage aller et notre retour, il
s’écoulera à peine un mois. Cela suffit
pour faire disparaître cent kilomètres de tôle
ondulée.
Un peu partout des chantiers surgissent. Une poignée
d’hommes est déposée un beau matin au
bord de la piste avec quelques cylindres d’eau, de
l’orge et des dattes, et du lever au coucher du soleil,
on travaille, on rase les bosses, on comble les creux, on
nivelle et on empierre. Et grâce à tous ces
obscurs, grâce aux chefs énergiques qui les
commandent on peut désormais rouler en paix à
travers le désert.
Qu’elle est belle notre piste impériale !
Ici, elle tranche d’un trait rougeâtre le désert
et l’oasis. Au bruit métallique des moteurs
a succédé le calme ; nous faisons halte à
proximité de la fontaine : de tous côtés
les harratines surgissent, sortant des ruelles étroites,
curieux, serviables et un tantinet mendiants. Les jeunes
filles, la cruche sur la hanche, font un va et vient incessant
du village à la source. Ce n’est pas à
proprement parler une source. L’eau limpide, purifiée
par un long cheminement souterrain, affleure le sol ; elle
provient d’une antique Foggara, dont on aperçoit
de loin en loin, à travers le reg, les affouillements
profonds.
Paulian, qui fut parmi les premiers à traverser le
Tanezrouft, à l’époque héroïque,
dirige le remplissage des cylindres d’eau. La mission
comprend en effet quatorze personnes, avec en plus trois
camions et une voiturette, et il faut prévoir de
l’eau pour mille kilomètres. Bien sûr,
si tout va bien, nous passerons en trois jours le redouté
Tanezrouft, mais si d’aventure et la malchance aidant
nous avions une panne, il s’agit d’être
paré.
— Terminé, déclare-t-il au bout de quelques
heures. Nous avons de quoi boire pendant quinze jours. »
Sans plus tarder nous repartons, dépassons Adrar,
capitale du Touat, aux magnifiques remparts de pisé
rouge, et poursuivons notre route sur Reggan, dernier poste
et dernier point d’eau avant le Soudan.
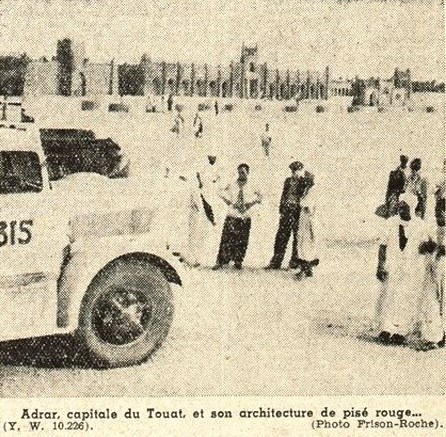
Nous
venons de franchir un peu plus de sept cents kilomètres
depuis Béchar. En aucun endroit la piste n’a
présenté une quelconque difficulté
et quand à s’égarer ? Autant vaudrait
dire sortir d’une route nationale ! Il reste maintenant
le plus dur à faire. De Reggan à Gao il y
a treize cents kilomètres. Sur 800 kilomètres,
c’est la traversée du Tanezrouft que nous allons
entreprendre sans arrêt.
Une joie profonde nous soulève à l’idée
de connaître enfin la totale solitude.
Roger
FRISON-ROCHE.