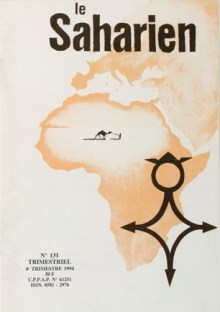
LA RAHLA (Amicale des Sahariens)
Le Saharien n° 131– 4ème trimestre
1994
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
LE SAHARA,
PREMIER « EXPORTATEUR »
DE POUSSIÈRES DE LA PLANÈTE
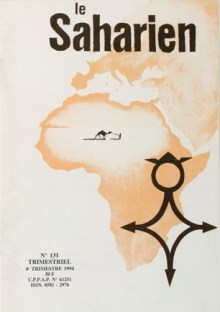
LA RAHLA (Amicale des Sahariens)
Le Saharien n° 131– 4ème trimestre
1994
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
LE SAHARA,
PREMIER « EXPORTATEUR »
DE POUSSIÈRES DE LA PLANÈTE
Entre les années 1954 et 1963, j’ai partagé mon temps entre l’Institut de Météorologie et de Physique du Globe situé à Alger, et l’Observatoire de Tamanrasset dépendant de cet Institut. C’est là que la présence de la brume sèche, due à de fines particules de poussière saharienne, m’est apparue durant le printemps et l’été. Les montagnes du Hoggar qui se dessinent si nettement l’hiver, deviennent alors souvent invisibles. Cette remarque avait déjà été signalée par le Père de Foucauld qui constate pour la première fois « un temps très brumeux à partir du 20 mars 1906 alors qu’avant le temps était très clair ; ce temps clair ne réapparaît qu’en septembre ». Nommé ensuite à l’Observatoire du Pic-du-Midi, à 2 862 mètres dans les Hautes-Pyrénées, la neige me changea du sable et, lors d’une mission d’observation en février 1972, une importante arrivée de poussière saharienne me fit retrouver le désert ! Depuis cette époque, j’ai étudié chaque apport saharien sous cette forme ou bien sous celle de pluies de boue avec, pour la partie géologie, la participation de C. Lucas.
La poussière saharienne
1. Production. Si une partie d’entre elle provient de stocks hérités, il faut envisager sa création par les moyens suivants : la succession de froid et de chaud, de gel et de dégel dans les montagnes et, surtout l’usure des roches due au passage régulier et efficace des vents de sable, la corrosion qui a façonné le paysage. L’altération chimique joue aussi un rôle efficace avec, par exemple, l’hyposulfite de sodium qui désagrège le granit comme dans le cratère de l’Ouksem (Atakor) et la cristallisation du sel qui rend pulvérulente la couche superficielle des sebkras. Lorsque la pluie arrive (très rarement, mais davantage sur les massifs montagneux) l’eau se répand partout entraînant limons et argiles et prend alors une couleur rougeâtre. Le dépôt solide transporté finit par sécher et se craquelle, fournissant de fines lamelles mobilisables par le vent. Ce fait se trouve amplifié par les activités humaines, le passage des animaux et surtout l'utilisation des véhicules tous- terrains.
2. Mise en suspension. Les tempêtes de poussière, appelées à tort tempêtes de sable, constituent au Sahara des phénomènes de très grande ampleur pouvant largement dépasser les limites de ce désert. En général, le sable trop lourd ne peut s’élever au-dessus de quelques mètres, alors que la poussière peut atteindre des altitudes supérieures à quatre kilomètres. La dimension de cette dernière varie de trente à cinquante microns, celle du sable se situant au-dessus.
Une tempête de poussière débute ainsi : sous l’influence des vents, de la turbulence, et de la forte insolation, les grains de sable vont commencer à se déplacer à la surface du sol, surtout entre treize et dix-sept heures. Le moyen employé est la saltation, ce qui signifie qu’un grain, soulevé par le vent, va en percuter un autre en retombant et ainsi de suite, puis, par roulage, les grains avancent en glissant et roulant, lorsque leurs dimensions sont trop importantes pour la compétence du vent. Ce dernier forcit, le sable chassé sur le sol s’organise en filets sinusoïdaux dont le nombre se multiplie, et au-dessus de lui, la poussière monte de plus en plus haut. Les phénomènes météorologiques qui contribuent au déclenchement de ces tempêtes de poussière, ou les renforcent, sont : les tourbillons, les cumulo-nimbus, nuages d’orage qui « aspirent » la poussière et les chasse-sable, chasse-poussière provenant d’une perturbation saharienne ou régénérée par l’Atlas Marocain. Se trouvent aussi les chasse-sable d’accélération dus à l’augmentation de la pression sur le Nord du Sahara, ce qui amplifie la vitesse du vent. Le plus spectaculaire d’entre eux, le mur de sable, est consécutif à l’arrivée d’un front froid. Sa vitesse importante et son air plus lourd que celui de l’air chaud saharien font qu’il s’enfonce en coin sous ce dernier et le soulève, entraînant avec lui sable, poussière et tous les débris, végétaux entre autres, qui se trouvent à la surface du sol. Tous les phénomènes météologiques cités plus haut appartiennent au groupe des lithométéores.
Photo Météosat - Météo-France. 12-8-1987
Par un vent moyen, les dunes « fument ». Cette expression signifie que des poussières leur sont arrachées et partent. Sur une dune du Grand Erg Oriental (Tunisie) en 1990, j’ai recueilli, à son sommet, à dix centimètres du sol et en cinq minutes, trois grammes de poussière dont le diamètre était inférieur à cent cinquante microns.
La grande majorité de la surface du Sahara est intéressée par les lithométéores. À l’aide des bulletins météorologiques français et européens, il est possible de retrouver les endroits où ces derniers se sont formés. Il s’agit de la Mauritanie, de la frontière Algéro-Marocaine, du Sud du Hoggar, du Nord du Niger, de la Libye et du Soudan. Les photographies prises par les satellites permettent de suivre la progression des nuages de poussière (voir photographie) et l’étude des trajectographies des masses d’air qui les acheminent facilite notre compréhension de ces phénomènes.
3. Retombées. Les poussières, nous l’avons vu, sont amenées par le vent, et une diminution de sa force ou des précipitations, donnant alors des pluies de boue, les font retomber au sol. Sur la surface du Sahara, il est évident que, lors du transport, les grains les plus lourds vont arriver au sol les premiers et que la masse totale aura diminué des 2/3 avant d’avoir parcouru 2 000 km. Cela signifie qu’un prochain lithométéore va pouvoir remobiliser ces poussières pour les abandonner plus loin. Il se produit donc un remaniement complet du matériau et, de plus, il arrive même qu’un front froid très actif traverse tout le désert, provoquant ainsi une importante tempête de poussière sur son passage, et qui va contribuer encore à la disséminer davantage.
Le Sahara étant bordé d’eau sur trois de ses côtés, les sédiments sont constitués majoritairement de poussière dont l’accumulation diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’Afrique. La Méditerranée orientale compte mille fois plus de poussière en suspension que l’occidentale, tant est fréquente la présence de leurs nuages en provenance de Libye et d’Egypte et qui ne sont arrêtés par aucune montagne.
L’on estime d’une manière générale, qu’en moyenne, plus de 350 millions de tonnes annuelles (M/t) partent du Sahara et se répartissent ainsi (poids estimé au départ et à l’arrivée), en empruntant les directions suivantes :
l’Ouest 260 M/t50 (Caraïbes en été, Guyane en hiver)
le Sud pas d’estimation connue
le Nord-Est 70 M/t20
le Nord 40 M/t10 (le Maghreb est très concerné)
Les différences, trouvées entre les tonnages donnés au départ et à l’arrivée, proviennent, d’une part, de la longueur du trajet et d’autre part, de la région de départ qui n’est pas la même suivant la direction empruntée.
Certains auteurs américains pensent que les épisodes de sécheresse au Sahel sont à mettre en rapport avec une sensible augmentation des arrivées de poussière sur la Côte Est des États-Unis. L’on a noté aussi que certains cyclones, qui la ravagent, pouvaient avoir leur origine dans des départs de poussière du Sahara.
Tous les déserts « exportent » de la poussière, toutefois en bien moindre quantité que le Sahara et, lors de retombées au sol, le poids annuel trouvé au m² peut atteindre par exemple 150 gr autour de Tel Aviv, 54 dans l’Arizona et plus modestement, 1 gr environ dans le Sud de notre pays. Une seule arrivée a déposé en 1976, 13 gr au Caire et en 1983, 6 gr dans le Sud-Ouest. Pour l’Europe, nous avons pu suivre avec J. Dubief et C. Lucas (1984) le passage d’un important nuage qui a laissé des traces au sol des Pyrénées à la Suisse, terminant sa course sous forme d’aérosols sur les bords de la Baltique. Son origine provenait du centre du Sahara occidental. En 1991, nous avons estimé avec J. Dessens que 0,15 M/t étaient parvenues en France (épisode des 6-9 mars) avec des retombées en Italie ainsi que dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.
Ces chutes de poussière et surtout de pluies de boue sont connues depuis l’Antiquité car le populaire les assimilait, de par leurs couleurs, à des pluies de sang, ce qui ne manquait pas de frapper les imaginations et donc de laisser des traces dans la littérature. D’après mes recherches, le document le plus ancien les mentionnant remonte à 1 577 avant J.C. et leur nombre total, actuellement supérieur à 800, concerne le Moyen-Orient, le Maghreb, l’Atlantique Sud et l’Europe ; aucune périodicité n’a pu être décelée. Souvent, ces arrivées de poussières, pluies de boue n’intéressent qu’une surface restreinte et passent ainsi inaperçues. C’est pour pallier cet inconvénient que le réseau POUSSAH, pour POUSsières SAHariennes, a été créé en 1982. Des correspondants, situés en Europe et autour du Bassin Méditerranéen, me signalent les retombées de poussière, pluies de boue et des bacs, placés dans le Sud de la France, permettent de collecter des échantillons qui sont ensuite analysés. La dimension des grains (granulométrie) varie de 4 à 12 microns et se composent en moyenne, de quartz 54 %, de phyllosilicates, micas et argiles 25 %, de carbonates 19 %, ainsi que de pollens et de spores. Il est à remarquer que les poussières emportées hors du désert appauvrissent le sol car le sable, lui, y demeure.
Si les explosions volcaniques impressionnent par leur caractère cataclysmique et des quantités de poussière mises en jeu, celles, sahariennes, bien que beaucoup plus discrètes, ne jouent pas moins un rôle important dans notre atmosphère. Leur étude n’a pu être abordée ici, dans sa totalité, ni dans tous ses détails, car elle couvre un domaine extrêmement vaste.
Alain BÛCHER
Physicien adjoint à l’Observatoire Midi-Pyrénées,
auteur d’une thèse de Doctorat d’État,
« Recherches sur les poussières minérales d’origine saharienne ».