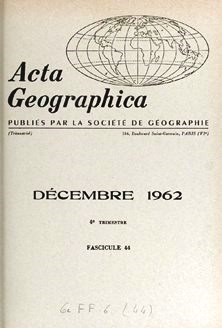
Acta Geographica n° 44 de décembre 1962
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

LES TÉMOIGNAGES PRÉHISTORIQUES DU TANEZROUFT
___________________
Comptes-rendus de missions par le Commandant R. RICATE
___________________
Au cours des missions que j’ai effectuées au Tanezrouft — et notamment en 1960 et 1961 — j’ai découvert de nombreux témoignages préhistoriques qu’il m’a semblé utile de publier, d’autant que rares sont les chercheurs qui ont parcouru cette région fort intéressante, certes, mais combien inhospitalière !
*
* *
LA CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE DU SAHARA
Non encore bien établie, cette chronologie peut se résumer ainsi :
L’existence de la « Pebble-Culture » a été démontrée (notamment au Nord de Tindouf), mais ce sont surtout les vestiges des industries paléolithiques et néolithiques qui abondent au Sahara.
*
* *
LE TANEZROUFT
Baptisé à juste titre « le désert de la soif et de la peur », le Tanezrouft est une immense plaine totalement désertique, de forme triangulaire, dont la superficie est d’environ le 1/3 de celle de la France. Situé au cœur du Sahara, ses limites exactes sont :
— au Nord, les palmeraies du Bas-Touat (Reggan, etc.) ;
— à l’Ouest, l’Erg Chech ;
— au Sud, la Sebkha de Taoudenni d’un côté et l’Adrar des Iforas, de l’autre ;
— à l’Est, les contreforts du Hoggar (In-Ziza, Timissao).Une piste (l’ex-piste impériale n° 2) qui relie Colomb-Béchar à Gao, traverse le Tanezrouft dans le sens N-S 4, en passant par la Balise 250, Bidon V et Bordj-Pérez.
Avant l’indépendance de l’Algérie (1er juillet 1962), deux employés indigènes, se tenaient à la Balise 250 de fin octobre à début mai. Ils étaient chargés de ravitailler en carburant et en eau les automobilistes se rendant de Reggan à Tessalit, sous réserve qu’ils aient contracté une assurance spéciale, avec la société « Mer-Niger ». Bidon V était inoccupé. Près des bâtiments vides, une modeste croix se dressait sur la seule tombe du cimetière ensablé, la tombe d’une petite fille de trois ans que ses parents avaient entraînée dans la traversée du Sahara...
Quant à Bordj-Pérez, il s’agissait d’un poste de Gendarmerie, occupé en permanence et parfaitement aménagé (eau courante, électricité, humidificateurs, frigidaires, radio, etc.). Construit durant l’hiver 1959-1960, je l’avais fait baptiser du nom du gendarme François PEREZ, mort pour la France à Colomb-Béchar le 25 octobre 1958. Sentinelle avancée du Sahara, à proximité de la frontière du Mali, Bordj-Pérez était, par ailleurs, un havre fort apprécié des voyageurs.
Géographiquement, le Tanezrouft (que j’ai personnellement traversé 16 fois) peut et doit même, à mon avis, être divisé en deux parties bien distinctes :
— le Tanezrouft oriental (entre la piste impériale et les contreforts du Hoggar),
— le Tanezrouft occidental (entre la piste impériale et l’Erg Chech).
Le premier, bien connu des nomades et des caravaniers, comporte plusieurs points d’eau, un peu de végétation et du gibier (mouflons, addax et gazelles notamment. J’y ai même vu deux autruches et une biche mohor dite « Robert »). Le second est un désert total, du moins sur les 9/10 de son étendue. Il existe en effet un peu de végétation dans certains oueds, au Sud d’une ligne Bidon V — Taoudenni.
LA MISSION « ADDAX » ET ORYX » (NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1960)
Cette mission se divisait en deux parties :
1) Addax, qui consistait à relier Colomb-Béchar à Tamanrasset via Reggan - Bordj-Pérez et Timissao (le Préfet de la Saoura y participait) ;
2) Oryx, véritable raid, qui consistait à effectuer, pour la première fois, la traversée en automobile du Tanezrouft, dans le sens E-O, en reliant le Hoggar à l’Erg Chech, via Bidon V.
Nous avons parcouru 5 400 km du 21 novembre au 12 décembre 1960 et, accidentellement, nous avons découvert deux importantes stations néolithiques au cours de ce périple.
La première, que nous avons baptisée « Addax 1 » se situe en plein « reg », à 120 km Nord-Ouest de la Balise 250 par 25° 10’ Nord et 0° 20’ Ouest. Quittant la piste impériale avec deux jeeps, à environ 100 kms au Sud de Reggan, nous avions poussé une pointe en direction de l’Erg Chech. Nous roulions depuis deux heures, lorsque sur le thalweg Est d’une légère dépression, mon attention fut attirée par la tache caractéristique d’une station préhistorique. Sa couleur grisâtre, due à la présence des tessons de poteries, des pierres noircies par le feu, des nombreux éclats et des diverses pièces lithiques, contrastait, en effet, avec la couleur rose du « reg ».
Le Préfet, qui découvre ainsi « sa » première station, n’en croit pas ses yeux. Il est vrai qu’elle est assez importante. Large d’une centaine de mètres, elle s’étale, en arc de cercle, sur un bon kilomètre. Nous n’avons pas le temps, et je le regrette, d’en faire un inventaire détaillé, mais nous la parcourons. Les meules dormantes (il y en a plus de 50) sont toutes retournées, intactes, la face contre terre. Seul, apparaît le fond, à moitié recouvert d’ailleurs, par le sable. Dans la plupart des cas, le broyeur est à côté. Nous découvrons également sur cette station :
— un pilon cylindrique de 45 cm de long sur 6 de diamètre, en quartzite ;
— quelques haches polies, en lydienne ;
— une plaquette de grès rose, légèrement ovale, aux bords biseautés et polie sur une face, de 10 cm de diamètre sur 5 mm d’épaisseur. Au centre de la surface polie, on distingue des traces d’ocre ;
— une pierre à rainures, en grès, en forme de petit pain, de 17 cm de long sur 9 de large et 5 d’épaisseur. Elle comporte sur une face, 3 rainures longitudinales et parallèles d’un centimètre de largeur chacune et, sur l’autre face, une seule rainure, identique aux trois autres ;
— un casse-tête, en forme de disque, en grès dur percé d’un trou en son centre. Diamètre de l’ensemble 10 cm et du trou 2,5 cm. Épaisseur : 3 cm.
Quelques jours plus tard, à l’Est du puits de Timissao (s’orthographie également Tim-Missaou) où il existe de belles gravures rupestres, connues depuis longtemps, nous avons trouvé, sur le « reg », une très jolie meule en forme de cuvette. Il s’agit d’une pierre très dure, dont je n’ai pu définir la matière. Son diamètre est de 24 cm, la profondeur de 4 et l’épaisseur totale de 9. Elle est parfaitement polie, à l’intérieur comme à l’extérieur.
De Tamanrasset, quatre véhicules seulement (2 jeeps et 2 Berliet-Gazelle), montés chacun par 2 hommes participèrent à la mission « Oryx ». Peu après Silet, nous empruntâmes le lit de l’oued Tamanrasset. Cet oued, sec bien entendu, à fond de sable dur est dépourvu de végétation : il n’existe que trois gommiers, du genre thala en tout et pour tout.
À une centaine de kilomètres Sud-est de Bidon V, nous avons ramassé quelques pièces préhistoriques (meules, broyeurs et haches) et, en plein milieu du lit de l’oued, large à cet endroit de 2 à 3 kms j’ai remarqué la présence de 4 à 5 fondations de fours, d’environ un mètre de diamètre et ayant, vraisemblablement, servi à la cuisson de poteries (Il existait de nombreux tessons à proximité).
De l’autre côté de la piste impériale, à environ 150 kms Ouest d’Aménèrène-el-Kasbah, nous découvrons, accolé à un erg, un plateau rocheux hérissé de plus de 200 tumuli préislamiques. Une vingtaine de kilomètres plus loin, second plateau avec une centaine de tumuli identiques aux premiers. Nous en avons fouillé trois, en vain. L’existence de ces tumuli était-elle connue ? Je l’ignore. Je sais, certes, qu’il existe des milliers de tumuli au Sahara, dont l’âge est, vraisemblablement, antérieur à l’Islam, mais je n’ai jamais rencontré d’aussi denses rassemblements dans une région aussi déserte.
PIÈCES DÉCOUVERTES AU COURS DES MISSIONS ADDAX ET ORYX.
(Dessin de G. Ducoudre)
1 : Hache. – 2 : Pendeloque. – 3 : Casse-tête.
Certains auteurs pensent que le tumulus est un tombeau et que si on n’y découvre aucun ossement, c’est que les corps qu’ils contenaient, ont disparu avec le temps. Bien que des squelettes humains aient parfois été découverts dans des tumuli, notamment au Tassili des Ajjers, je ne pense pas que le caractère funéraire de ces monuments soit nettement démontré, d’autant qu’en l’occurrence, les rassemblements que je cite, sont situés dans une région actuellement inhospitalière dans laquelle nous n’avons découvert aucun autre vestige permettant d’affirmer que l’homme y ait vécu. Ne s’agirait-il pas d’offrandes faites aux dieux, par des nomades de l’époque néolithique, nomades qui ne restaient que peu de temps dans cette région, mais y revenaient périodiquement (pâturages) ? C’est peut-être la raison pour laquelle on ne trouve aucune trace de vie. En effet on peut penser qu’un nomade qui se déplaçait avec sa meule, son broyeur, sa hache et ses flèches (seuls outils susceptibles de résister au temps) ne les abandonnait pas et repartait vers d’autres régions en les emportant.
Ces tumuli, de forme conique, mesurent, en moyenne, 3 à 5 mètres de diamètre, sur 1,50 m à 2 mètres de haut.
Le lendemain, à une centaine de kilomètres de là, en direction du Nord-est, après avoir ramassé quelques meules et haches isolées, nous découvrons, sur un excellent « reg », des mégalithes. Il s’agit de cercles de pierres de 5 à 10 mètres de diamètre. Ces pierres, grosses comme le poing, étaient régulièrement posées sur 2 ou 3 rangées. Attestent-elles l’existence d’un culte ancien, adoration du soleil par exemple ?
À quelques kilomètres de l’Erg Chech, nous apercevons un énorme rocher, d’environ 30 mètres de haut sur 50 de diamètre. Aucune carte n’en fait mention et pourtant, il s’agit là d’un excellent point de repère et d’un remarquable poste d’observation. Je le situe par 24° 15’ Nord et 2° 00’ Ouest. En février 1961, un « Dakota » militaire qui survolait l’Erg Chech a cherché, sur ma demande, à repérer ce rocher que j’ai baptisé « Rocher du Gendarme ». Il y parvint, le photographia et le situa, quant à lui, par 24° 00’ Nord et 2° 00’ Ouest ; ce qui me paraît bien un peu au Sud, mais j’avoue que mes moyens d’orientation étaient assez modestes : cadran solaire, boussole à prismes et carte aéronautique au 1/1 000 000.
Deux grottes (dont une très vaste) sont creusées à la base du rocher. Elles sont à demi emplies de sable. Nous y avons découvert plusieurs squelettes d’addax et de gazelles mais aucune trace de présence humaine, ni préhistorique, ni contemporaine. Il est vrai que nous n’avons pas fouillé les grottes à fond, car il nous aurait fallu plus d’une semaine pour en évacuer le sable.
À 12 km au Nord-est de ce rocher (cap 55°) nous découvrons notre seconde station préhistorique depuis le départ de Colomb-Béchar. Nous la baptisons « Oryx 1 ». Elle occupe le sommet d’une légère éminence et est répartie dans un cercle d’environ 500 mètres de diamètre. Là aussi, le matériel lithique est recouvert d’une mince couche de sable. Il faudrait pouvoir passer plusieurs jours sur place ; mais Reggan, avec qui je suis en liaison radio, m’a fait savoir, le matin même, que je devais évacuer cette zone au plus vite, à cause de la bombe atomique qui n’allait pas tarder à être expérimentée...
Au cours des quelques heures passées sur « Oryx 1 », nous avons néanmoins mis à jour :
— 23 meules dormantes intactes, en grès, dont la plus grande mesure 82 cm de long sur 38 de large. Il s’agit d’une très belle pièce, légèrement concave, très bien polie, fine et élégante ;
— 57 molettes et broyeurs de différents modèles ;
— 1 galet en forme de cœur de 15 cm de long - Largeur au sommet : 10 cm, à la base : 5 cm – Épaisseur : 7 cm. Une rainure (gorge) en fait le tour. Il peut s’agir d’un peson destiné à équiper des filets de pêche. (Les pesons de pêche qui figurent à la planche X, page 507 du livre « Préhistoire de l’Afrique » de Mademoiselle ALIMEN, présentent une gorge transversale alors que celle de mon galet est longitudinale) ;
— 3 haches plates polies, dont la plus grosse mesure 13 cm de haut – Tranchant : 9 cm ;
— 2 herminettes polies ;
— 2 haches « boudin », dont une de 24 cm de long sur 4 d’épaisseur ;
— 6 bolas ;
— des débris de poteries. (J’ai pu reconstituer en partie, une sorte de calebasse à col, de 16 cm de haut, diamètre de l’ouverture : 10 cm et de la panse : 17 cm. Elle a été décorée, probablement, par application d’une vannerie avant la cuisson) ;
— 2 tarières ;
— 1 lame à dos abattu ;
— des grains de collier (œufs d’autruche) dont certains sont noircis au feu ;
— 1 grattoir, finement taillé sur un côté avec, au dos, trois alvéoles, comme pour y mettre les doigts ;
— 1 pendeloque (le trou servant à la suspendre porte des traces très nettes d’usure).
À 16 km à l’Est de cette station, nous découvrons une lame de poignard, au pied d’un rocher, parmi des ossements d’antilope. Il s’agit d’une fine lame de bronze (à un tranchant) qui a été cassée. Le morceau, qui comprend la pointe, mesure 105 mm de long sur 10 de large et 1 d’épaisseur.
*
* *
MISSION AUTRUCHE (NOVEMBRE 1961)
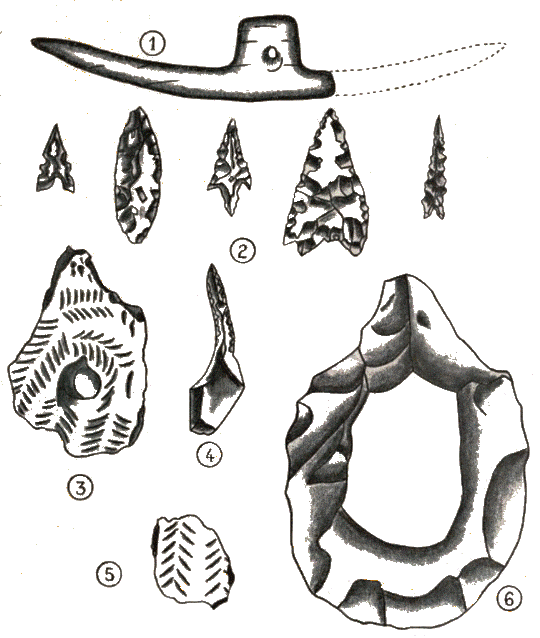 PIÈCES DÉCOUVERTES AU COURS DE LA MISSION AUTRUCHE
PIÈCES DÉCOUVERTES AU COURS DE LA MISSION AUTRUCHE
(Dessin de G. Ducoudre)
1 : Hameçon. – 2 : Flèches : - 3 : Anse de calebasse en poterie.
– 4 :Tarière. – 5 : Fragment de poterie. – 6 : Coup de poing.
Cette mission, à laquelle participait notamment J. MATEU, du C.N.E.S., a parcouru 4 600 kms entre le 11 et le 28 novembre 1961.
Le 13, nous quittions la piste impériale à 60 km au Sud de Reggan, en direction de l’Erg Chech (Cap 275). Nous avons successivement découvert les stations suivantes :
Autruche 1 (néolithique)
Dans l’oued Messaoud, sur la bordure orientale de l’Erg Chech. Environ 10 km Nord d’Hassi-Bouras par 26° 18’ Nord et 0° 28’ Ouest. Outillage complet.
Autruche 2 (néolithique)
Toujours dans l’oued Messaoud, à hauteur d’Hassi- Boura, par 26° 13’ Nord et 0° 32’ Ouest. Meules et broyeurs.
Autruche 3 (néolithique)
Environ 65 kms Sud du puits de Rezzeg Allah par 23° 13’ Nord et 0° 53’ Ouest. Très belle station que Monsieur MATEU se propose de décrire et sur laquelle nous avons découvert 23 poteries, 27 meules entières, 263 broyeurs et molettes, 46 bolas, des fragments d’œufs d’autruche, des objets de parure, des haches, des flèches, etc.
Autruche 4 (néolithique)
Environ 30 kms Ouest d’Amérènène-el-Kasbah par 22° 03’ Nord et 0° 09’ Ouest, là où l’oued Tamanrasset se perd dans les sables. Des poteries, des haches polies, des grattoirs, une flèche, des broyeurs et des fragments de moules.
Autruche 5 (néolithique)
Dans l’oued Tamanrasset, à environ 25 kms Est d’Aménèrène-el-Kasbah par 22° 04’ Nord et 0° 40’ Est. Une grosse perle en serpentine, des haches polies, 2 flèches, des feuilles de laurier, des grattoirs, des boulets et quelques fragments de poteries.
Autruche 6 (néolithique)
Dans un feidj d’erg à environ 35 km Nord-ouest de Bordj Pérez par 21° 56’ Nord et 0° 45’ Est. Très nombreux grattoirs rabots, des flèches triangulaires à base concave, des poinçons, des lames, des feuilles de laurier et un hameçon de pierre polie.
Le 21 novembre, à 12 km Nord de Bordj Pérez nous quittons la piste et prenons le Cap 90° pour prospecter cette fois, la partie orientale du Tanezrouft. Nous y avons découvert :
Autruche 7 (néolithique)
Dans l’oued Ilaferh, à environ 45 kms Nord-est de Bordj Pérez, par 21° 41’ Nord et 1° 10’ Est. De la poterie, des flèches, des broyeurs, des fragments de meules, des grattoirs de différentes formes et quelques microlithes.
Autruche 8 (néolithique)
Entre l’oued Tamanrasset et l’oued Ilaferh, à environ 105 km Nord-est de Bordj Pérez par 21° 52’ Nord et 1° 48’ Est à proximité de la piste chamelière reliant l’Adrar des Iforas à In-Ziza. De la poterie, des broyeurs (dont 5 enterrés ensemble dans une calebasse en terre), des herminettes dont une taillée sur une face, les autres étant polies, des perforateurs, des boulets et quelques grattoirs.
Autruche 9 (néolithique)
À 100 kms Sud du massif d’In-Ziza (que les Touareg désignent sous le nom de « In-Chicbaou ») et à environ 135 kms Est-Nord-est de Bidon V par 22° 42’ Nord et 2° 21’ Est. Il s’agit là d’un atelier de meules, de broyeurs et de boulets (des centaines d’exemplaires). Une magnifique meule dormante, enterrée de champ, mesurant 80 cm de long sur 49 de large a été mise à jour.
Autruche 10 (paléolithique)
Sur la partie orientale de l’atelier précédent, au pied d’une dune. Des outils de facture acheuléenne (bifaces dit « Coups de poing » et des disques nucléiformes).
Nota : C’est la seule station paléolithique que j’ai découverte au Tanezrouft, encore qu’elle se situe sur la bordure orientale de ce « désert des déserts ».
*
* *
CONCLUSIONS
Les observations que j’ai faites me permettent de conclure que :
— Les hommes préhistoriques n’ont pratiquement jamais vécu sur le « reg » du Tanezrouft, mais seulement dans les oueds ou en bordure de ceux-ci, ou encore, à proximité des ergs ou des massifs montagneux.
— Le centre du Tanezrouft n’a été parcouru que par des hommes du néolithique.
— Les actuels oueds du Tanezrouft (anciens cours d’eau importants) étaient déjà ensablés à l’époque néolithique puisqu’on découvre des témoignages préhistoriques au fond même de ces oueds.
— Par contre, il existait encore, à cette époque, des petits lacs. On trouve en effet des traces de vie sur les bords de certaines dépressions non pas au sommet, mais sur la pente elle-même, ce qui laisse donc à penser que le niveau d’eau de ces lacs était déjà bien bas.
— L’assèchement qui se manifestait déjà à l’époque néolithique n’a fait que s’accroître, puisque, maintenant, les fonds de ces dépressions sont secs. J’ajouterai, pour terminer, qu’à l’heure actuelle, aucun nomade ne se risquerait à traverser le Tanezrouft entre Amérènène et Kasbah et l’Erg Chech, car il sait (quoiqu’en mentionnent certaines cartes) qu’il n’existe aucun point d’eau entre Taoudenni et Reggan, soit environ sur 600 km à vol d’oiseau.
Ct R. RICATE