
LA
RAHLA (Amicale des Sahariens)
Les Amis du Sahara n° 9 - Octobre 1933
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
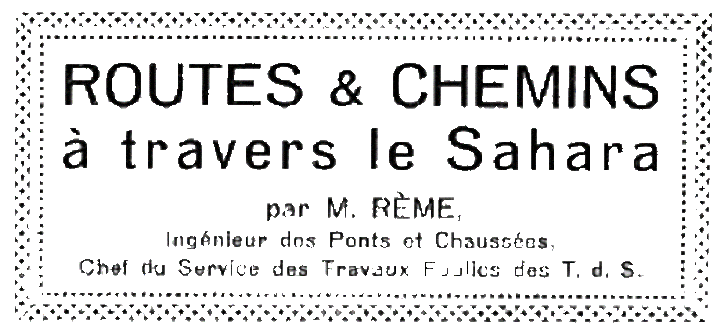

LA
RAHLA (Amicale des Sahariens)
Les Amis du Sahara n° 9 - Octobre 1933
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
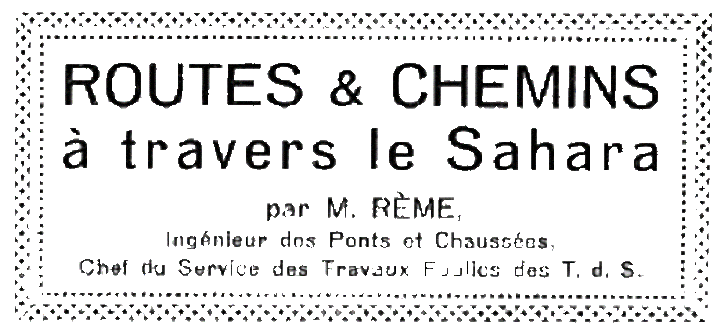
M. le général MEYNIER, Directeur des Territoires du Sud au Gouvernement Général de l’Algérie, dans une de ses précédentes causeries, vous a décrit, en une langue imagée et ardente, l’attirance du Sahara et l'emprise qu’il exerce sur ceux qui y ont vécu, Je suis sûr qu'il vous a communiqué son enthousiasme au point que vous êtes, sans doute, maintenant impatients de gagner ces régions, au charme si prenant et que vous vous demandez par quels moyens vous pourriez réaliser vos projets ?
C'est à cette préoccupation que répond la présente causerie : au regard de celles déjà faites ou qui vous sont annoncées elle constitue un intermède tout prosaïque dont le but essentiel sera de vous donner des renseignements, concis et précis sur l'évolution des moyens de communication dans l'extrême-sud algérien ; elle réclame par suite toute votre bienveillante indulgence.
À la vérité, la voie la plus indiquée et sans doute de réalisation prochaine, pour admirer ces espaces immenses à l'échelle convenable, serait la voie aérienne, la seule qui permette des coups d'œil d'ensemble et suggère de vastes pensées. Mais en attendant que des voyages aériens soient entrés dans le domaine de la pratique, c'est sur terre que je vous convie à descendre pour circuler sur les pistes, ouvertes à même le sol, et gagner, par la pensée du moins, le cœur du Hoggar mystérieux ou les bords du Niger.
Il y a quelques années seulement, l'entrée du Sahara était interdite à tous ceux que de longs voyages à cheval, ou mieux, à méhari effrayaient. À la descente des trains qui conduisaient les voyageurs jusqu'à Colomb-Béchar, Djelfa et Touggourt, il fallait soit emprunter dans quelques rares contrées favorisées des diligences gémissantes où les voyageurs fortement pressés les uns contre les autres, étaient terriblement bousculés par les chaos d'une route ingrate, soit le plus souvent organiser à grands frais et non sans difficultés, de véritables caravanes dont l'étape moyenne n'était que de vingt-cinq à trente kilomètres.
Dans ces conditions, seuls quelques touristes intrépides, en dehors des officiers et des fonctionnaires que leur métier appelait dans ce territoire, osaient s'aventurer dans le désert : qui allait à Ouargla, El-Goléa ou Beni-Abbès prenait déjà physionomie de chercheur d'aventures, sinon d'explorateur. Il fallait être un globe-trotter émérite pour pousser jusqu'à In-Salah ou au Hoggar et la traversée du Sahara, de l'Algérie au Soudan, était considérée comme un véritable exploit.
L'introduction de l'automobile et de l'avion au Sahara devait bientôt changer ces points de vue et rendre facile et accessible à tous ce qui, hier encore, était inaccessible, sinon dangereux.
L'origine de ce mouvement de modernisation du Sahara date de 1915 ; sous l'impulsion du Gouverneur Général LUTAUD fut ébauché le tracé de pistes automobiles et en 1922-1923 la firme Citroën réussissait, coup sur coup, grâce à l'utilisation des voitures à chenilles deux traversées complètes du Sahara entre l'Algérie et la boucle du Niger. La Maison Renault créait ensuite la « Six roues » qui, avec le Maréchal FRANCHEY D’ESPEREY et M. GRADIS disputait ses palmes à l'auto chenille.
Outre qu'ils faisaient disparaître la légende suivant laquelle le Sahara apparaissait comme une immense plaine sablonneuse parsemée de dunes infranchissables, ces raids montraient que, sous réserve du choix judicieux d'un tracé, point n'était besoin d'employer l’autochenille, engin sûr mais très lent, pour effectuer le voyage d'Alger au Niger et que des voitures de série, moyennant quelques aménagement spéciaux relatifs aux approvisionnements en eau, carburants et lubrifiants, pouvaient être utilisées avec succès.
Les pistes se déroulent, en effet, très souvent sur de vastes plateaux rocailleux, comme le Tadmaït, ou recouverts de petits graviers agglutinés par du sable argileux appelés « reg », qui permettent les plus grandes vitesses ; l'aménagement de ces sections a consisté presque exclusivement en un nettoyage superficiel pour enlever pierres et touffes de végétation et assurer un jalonnement latéral .au moyen des produits de ce balayage. Quant aux dunes de sable, qui sont pratiquement infranchissables, on les évite soigneusement en acceptant au besoin des allongements de parcours importants. Fort heureusement, tout en se déplaçant sous l’action du vent, ces dunes se maintiennent à l'intérieur d'un périmètre qui limite « l’erg », ou espace entièrement couvert de sable, ce qui facilite la solution du problème. Les ergs eux-mêmes sont séparés par de longs couloirs ou « gassis » qui peuvent, comme celui du Gassi Touil, atteindre une trentaine de kilomètres de largeur, le long desquels la piste se glisse.
Ces heureuses constatations décidaient l'Administration à développer son réseau de pistes, en profitant au maximum des facilités, cependant toutes relatives, que la nature avait complaisamment ménagées à côté de difficultés jusque-là réputées insurmontables comme pour mieux assurer la victoire de l'esprit humain.
Mais alors que dans l'Algérie du Nord l'automobile avait épousé la route, dans une union sans mélange, au Sahara le ménage devait subir la loi commune et connaître à l'origine des réactions assez rudes, pour aboutir, grâce à des concessions réciproques au cours des ans, à une parfaite et sereine entente.
D'autres vous -montreront les efforts faits par les constructeurs pour arriver à un type de véhicule dit « saharien », susceptible de parcourir les pistes, même sommairement aménagées, sans trop de dommages pour les voitures et pour leurs occupants. Disons seulement que le code saharien de la route de janvier 1930 modifiant celui antérieur, en proscrivant les bandages rigides et en limitant la pression sur le sol, a eu pour résultats le développement rapide des pneus à large section et à faible pression; l'initiative prise en cette matière par l'Administration des Territoires du Sud a d'ailleurs été suivie depuis par la Métropole qui vient également de proscrire les bandages rigides.
Palmeraies dans les dunes à In Salah
Pour ce qui a trait à notre objet, j'indiquerai les difficultés qu'il a fallu vaincre et les moyens mis en œuvre dans ce but pour éviter aux voyageurs les contacts trop rudes avec le toit des voilures contre lequel jusqu'alors ils n'étaient protégés que par le casque, coiffure habituelle dans ces régions. Je me bornerai à indiquer les principaux terrains qui, pendant longtemps, ont été la terreur des chauffeurs : terrains sablonneux mous ou fech-fech, traversée des oueds, car s'il ne pleut pas souvent au Sahara, la pluie, quand elle tombe, y revêt toujours un caractère torrentiel.
Il faut souligner ici que les problèmes en matière de travaux publics et de génie civil se présentent, dans le Sahara, sous une forme toute particulière. Le plus souvent, en effet, les solutions perfectionnées admises dans la Métropole, sont pratiquement irréalisables en raison de leur coût élevé accru par les prix de transport. L'auteur de tout projet doit toujours se demander comment il amènera à pied d'œuvre les matériaux dont il prévoit l'emploi ; aussi est-il conduit à rechercher des solutions nouvelles et dans ce domaine encore, à vivre sur le pays.
Pour franchir les terrains mous, on peut établir une sorte de dallage avec des matériaux pierreux ramassés dans le voisinage, quand il en existe. À défaut de pierres, ce qui est le cas le plus fréquent, on répartit la pression sur le sable par l'intermédiaire d'un tapis de branchages recouverts de terre argileuse mélangée de sable ou de gravier, arrosée quand on le peut et pilonnée. On rencontre heureusement par endroits, dans le désert, un arbrisseau à tiges filiformes, appelé « drinn », qui a la propriété précieuse d'être à peu près imputrescible et qui convient admirablement pour l'établissement de ces plateformes.
Quant aux oueds on ne les franchit jamais à l'aide d'ouvrages d'art ; les talus sont abattus pour faciliter le passage des automobiles et la traversée de l'oued assurée par des gabions, sorte de caisses parallélépipédiques en grillage de fil de fer galvanisé et remplies de pierres.
Quand les oueds sont particulièrement encaissés on constitue des drains en pierre sèche dans lesquels on incorpore des tubes en fer pur qu'on transporte par éléments et que l'on assemble sur place grâce à un dispositif spécial. Ces éléments demi-cylindriques s'empilent à la façon de cartes et sont facilement transportés à dos de chameau dont la bosse semble avoir été prévue pour un arrimage facile.
Il peut apparaître que ces procédés ne constituent pas une technique bien relevée ; les matériaux employés (argile, sable, gravier, drinn) ne sont pas nobles comme le ciment, le bitume ou l'asphalte. Leur mise en œuvre exige cependant des études très attentives de granulométrie, de proportions optima qui présentent de réelles difficultés si l'on veut obtenir une surface roulante qui ne se craquelle pas et qui résiste sous la circulation. D'autre part, il faut se représenter l'isolement dans lequel se trouvent les équipes qui travaillent à la confection de ces pistes, les sujétions que comporte le ravitaillement en vivres et en eau, les fatigues qu'entraîne, pour les ouvriers et les chefs de chantier, l'exécution des travaux sous une température toujours excessive. On ne saurait trop rendre hommage à ceux, officiers, chefs de chantiers civils et ouvriers, qui assurent aux pistes, dans de pareilles conditions, un état de viabilité convenable. À noter enfin que les crédits affectés annuellement à l'aménagement et à l'entretien des pistes du Sahara sont extrêmement réduits et de l'ordre de 1 500 000 francs seulement pour un réseau de plus de dix mille kilomètres.
Toutefois, au fur et à mesure de l'amélioration du réseau de pistes, qui se traduit par une augmentation de la vitesse moyenne, l'Administration des Territoires du Sud est devenue plus ambitieuse. À l'origine, l'aménagement des pistes avait été prévu de façon à assurer la liaison des postes éloignés avec les chefs-lieux de territoire ; par la suite il est apparu que la voie transsaharienne pouvait servir à relier l'Algérie du Nord et la Métropole avec les Territoires situés par-delà le Sahara. Du plan algérien la question s'élevait sur le plan intercolonial. On se proposait maintenant d'assurer le franchissement d'étapes importantes sans trop de fatigue pour les voyageurs. On revint donc sur les tracés; des ingénieurs se rendirent sur les lieux pour étudier, dans les sections délicates, des variantes selon les règles de l’art, et substituer aux moyens de fortune des méthodes plus rationnelles. Aujourd'hui on peut se rendre normalement d'El-Goléa à Tamanrasset par, exemple, en quatre jours alors qu'à l'époque du chameau il fallait plus de 40 jours pour accomplir le même trajet de 1 200 kilomètres.
Parallèlement M. le Gouverneur Général Jules CARDE prescrivait, en 1931, l'étude de l'amélioration des pistes au moyen de procédés spéciaux et économiques et, dès 1932, était mis au concours un programme d'essais auxquels ont pris part cinq firmes spécialisées dans l'utilisation des produits bitumineux. Il s'agissait de transformer des sections- choisies de la piste de Touggourt-Ouargla, établies sur un sol mou, en une route susceptible de supporter, sans dommage, la circulation des véhicules admis à emprunter les routes du Nord. Les résultats obtenus, très encourageants, permettront vraisemblablement de mettre au point une technique spéciale utilisant au maximum les matériaux trouvés sur place pour donner à la plateforme la cohésion et la résistance exigées par un trafic sans cesse accru.
Allant ainsi en s'améliorant chaque jour, le réseau des pistes sahariennes comprend trois artères de pénétration reliant chacun des départements algériens à l'Afrique Noire.
De l'Ouest à l'Est, c'est d'abord la piste occidentale qui, partant de Colomb-Béchar, terminus de la voie ferrée, gagne le Niger par la magnifique vallée de la Saoura, le Touat et le Tanezrouft. Puis la piste centrale transsaharienne de Laghouat à Zinder par Ghardaïa, El-Goléa, In-Salah, les gorges d'Arak, Tamanrasset et In-Guezzam. Enfin la piste orientale par Touggourt, Ouargla, Fort-Flatters, Amguid, Tamanrasset relie le département de Constantine à la Colonie du Niger ; le prolongement de cette artère d'Amguid au Tchad par Djanet, Djado et Bilma est d'ailleurs activement poursuivi.
Ces trois grandes voies de pénétration permettent au touriste débarquant en Afrique du Nord en un port quelconque de la côte de Casablanca à Gabès de se rendre facilement en Afrique occidentale ou équatoriale française avec un billet direct, aussi commodément qu'on peut visiter la Côte d'Azur ou la Touraine; des services automobiles subventionnés assurent, en effet, les correspondances avec les voies ferrées et pour des sommes relativement peu élevées, rendent possible tous les circuits à travers le grand désert. Des bretelles ou pistes de rocade complètent ces transversales Nord-Sud :
— de Colomb-Béchar ou de Figuig à Tozeur par Ain-Sefra, El-Abiod, Sidi-Cheik, Géryvîlle, Aflou, Laghouat, Djelfa, Bou-Saida, Biskra.
—d’Ouargla à Adrar par El-Goléa, la perle du désert, Fort Mac-Mahon, Timimoun.
— plus au Sud de Fort Saint à Fort-Flatters, Amguid, In-Salah.
—- enfin, de Tamanrasset à Kidal par Tin-Zaouaten ou de Tamanrasset à Agadès par In-Azaoua.
Au total c'est un réseau de plus de dix mille kilomètres de pistes qui sillonne le Sahara, heureusement complété, d'une part, par des hôtels ou bordjs aménagés dans les centres principaux pour assurer aux voyageurs un gîte convenable et des ravitaillements en vivres, parfois même en légumes, et, d'autre part, par des dépôts d'essence, ateliers de réparations ou centres de dépannage.
Est-ce à dire qu'un voyageur quelconque, propriétaire d'une bonne automobile de tourisme, peut se risquer tout seul sur le réseau des pistes saharienne ? Non. Ceci serait une grave imprudence. Pour se lancer dans le Sahara il faut encore avoir un bon chauffeur au courant des particularités de la route saharienne, l'ayant pratiquée suffisamment pour se rendre compte des conditions spéciales de la conduite des véhicules dans les différents terrains, sable mou, reg dur, terrain rocheux. Au surplus, il est nécessaire d'emporter avec soi des approvisionnements suffisants en vivres, eau, lubrifiant et carburant. Enfin et pour parer à tout imprévu qui, dans ces contrées sauvages, peut résulter avant tout de l'isolement total si dangereux, il convient de ne voyager qu'en convoi de deux voitures. Très sagement le code saharien de la route, dont un exemplaire peut être obtenu sur une demande adressée à la Direction des Travaux Publics des Territoires du Sud, au Gouvernement Général de l'Algérie, énumère dans l'intérêt des usagers, les prescriptions à observer pour un voyage particulier transsaharien.
Ainsi constituées les pistes sahariennes permettront de reprendre, dans des conditions meilleures quant au prix de transport, des échanges commerciaux déjà amorcés entre l'Afrique du Nord et nos possessions de l'Afrique Centrale. À cet égard les missions commerciales de 1929 et de 1931, cette dernière à l'occasion d'un concours de véhicules équipés de moteurs Diesel, ont montré qu'il était possible d'établir une liaison périodique entre l'Algérie et le Niger pour un prix de transport de 1 fr. 50 la tonne kilométrique environ.
Sans vouloir effleurer la question pourtant à l'ordre du jour du transsaharien ferré, qui a déjà donné lieu à de sérieuses controverses, nous estimons que le réseau des pistes améliorées sera de la plus grande utilité. Outre qu'il constitue l’infrastructure indispensable pour des liaisons aériennes il permettrait, si un courant commercial se créait, de fixer les idées sur les possibilités de trafic que réserve la boucle du Niger. Les hypothèses les plus opposées ont été, en effet, formulées sur le trafic probable que d'aucuns croient assez faible alors que d'autres l'estiment capable d'alimenter de nombreux trains journaliers de mille tonnes dans chaque sens. Entre ces deux élongations maxima il y a place pour une position d'équilibre que l'emploi de camions automobiles pourrait contribuer à fixer ; on substituerait ainsi à des évaluations hypothétiques des constatations de fait.
Par ailleurs l'automobile est un engin très souple qui peut s'adapter aux demandes, sans qu'il en résulte une immobilisation massive de capitaux.
En tout état de cause, il y a intérêt à amorcer un courant d'échanges commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Noire, à créer une ambiance favorable au développement du commerce.
On avancerait ainsi l'heure de l'exploitation normale du transsaharien ferré après que le rail aura atteint Gao.
Les pistes peuvent jouer ce rôle à la condition d'être constamment tenues en bon état de viabilité.
Ainsi, établies suivant un tracé soigneusement étudié, contournant les dunes, courant sur les regs et les sebkras desséchées et plates, les pistes permettent des liaisons rapides avec le Soudan, diminuent dans la proportion de 1 à 10 la durée des voyages des fonctionnaires de l'extrême-sud, s'améliorent sans cesse au fur et à mesure que la circulation s'intensifie. Elles constituent, en définitive, un instrument de colonisation remarquable qui donne au Sahara d'aujourd'hui sa vraie figure celle du pays des mirages et des dunes qui ne garde plus de son mystère que la beauté de ses paysages aujourd'hui accessibles à tous.
Entre Fort Miribel et El-Goléa. - La moto devant les dunes
L'arrivée à In-Salah