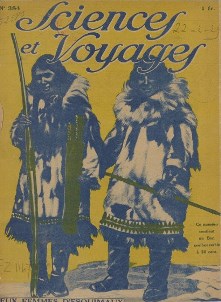
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 384 du 6 janvier 1927
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

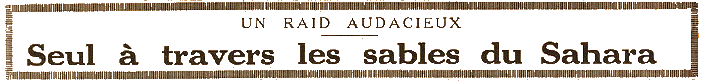
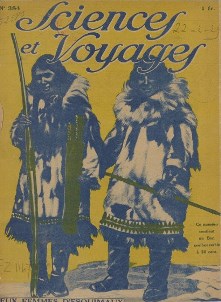
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 384 du 6 janvier 1927
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

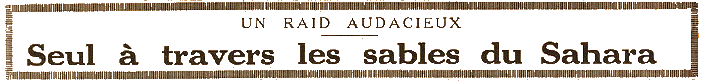
La région du Tanezrouft s’étend au sud du Hoggar, dans des limites assez vastes pour qu’on ait tout le loisir de s’y perdre sans y rencontrer le moindre secours. Elle est sauvage et désolée, ravagée en été par de terribles tempêtes de sable, mal connue encore, et, pendant longtemps, territoire privilégié des hordes de bandits nomades qui profitaient de sa solitude pour harceler les caravanes et les surprenaient en marchant avec la tornade, aussi mobiles qu’elle, brusquement surgies comme elle des profondeurs de l’horizon et disparues en même temps, ne laissant, comme elle, que ravages et ruines sur leur chemin.
Ce nom de Tanezrouft, d’ailleurs, ne s’applique pas uniquement à la zone géographique ou nous allons nous aventurer à la suite de la petite troupe. Toute Ténéré, ou plaine, qui est ainsi stérile, au Sahara, porte ce nom. C’est en somme le désert typique, véritable, dont la superficie se modifie selon la sécheresse, et qui se développe, en principe, jusqu’à la limite tropicale des pluies d’été.
Nos voyageurs y circuleront surtout la nuit, pour s’épargner la fatigue diurne des chaleurs torrides. Pourtant, parfois, il faudra marcher sous le plein soleil, pour atteindre plus rapidement le problématique point d’eau, seule espérance de l’étape et qui ne sera pas toujours réalisée.
C’est ainsi que l’on parvient d’abord au puits de Tiririne, à l’eau sulfureuse et presque imbuvable, mais dont il faut cependant qu’hommes et bêtes se contentent... Et l’on arrive ainsi jusqu’à la pauvre voiture abandonnée, que son propriétaire entoure de soins minutieux pour la protéger, pendant toute son absence, du soleil et du sable, qui s’acharne lentement à sa destruction.
Plus loin, on fait halte, un soir, au puits de Tawardi, trou d’eau de 6 mètres de diamètre, de 8 de profondeur, le dernier qu’on rencontrera avant de pénétrer dans le Tanezrouft, et dont il faut largement profiter.
Les animaux sont largement abreuvés. Et l'on fait aussi, pour eux, provision d’herbes sèches, car, pendant plusieurs jours, on ne trouvera plus rien.
Aussi se hâte-t-on, pour franchir le plus rapidement possible ce redoutable passage. On marche jour et nuit, sous les flammes du soleil ou dans l’air glacial des nuits. Et la fatigue est si forte que les caravaniers s’endorment sur le dos de leurs méharis, brusquement réveillés par la crainte de se laisser choir du haut de leur monture démesurée !
Rien pour reposer le regard, dans cette étendue vide. Pas un brin d’herbe. Et il faut souvent mettre pied à terre, pour laisser reprendre haleine aux dromadaires épuisés, en marchant à côté d’eux.
On va, cependant, on va toujours. À cinq jours de marche est le puits de Tadera, qu’il faut atteindre coûte que coûte...
La fable du chêne et du roseau est toujours d’actualité. Sur les pistes ou passe triomphalement la petite automobile qu’aucune escorte n’accompagne, qu’aucun relai ne secourt, de grosses voitures, spécialement aménagées pour le randonnée restant en panne… Est-ce pour qu’il ne les rencontre pas dans leur détresse qu’on voulait interdire à M. Rossion le droit de se promener tout seul, par ses propres moyens, dans le désert ?
Mais voici qu’en s’approchant de l’endroit où on croit l’atteindre on ne le découvre nulle part... Le guide est envoyé à sa recherche. Il finit enfin par le repérer. Mais l’eau est imbuvable. Il faut aller ailleurs !
En compensation, dans le voisinage, croissent quelques maigres plantes dont les animaux peuvent faire leur profit et qui ont attiré dans la région des gazelles qu’on peut abattre. La restauration faite, tant bien que mal, on se remet en chemin.
Au dire du guide, il y a, à vingt-quatre heures de là, un puits d’eau fraîche. On s’y rend. Hélas, le puits existe bien, mais il est complètement à sec. Ce n’est qu’un jour plus tard encore qu’on rencontre une petite mare boueuse, dont il faut faire ses délices, faute de mieux.
Le Tanezrouft est bien décidément le pays de la peur, et sa réputation est demeurée bien vivace, car, le lendemain, l’arrivée de la petite escorte, aux intentions cependant bien pacifiques, met en fuite tout un camp de Touareg établis dans les environs... Il se sauvent, laissant là leurs tentes et leurs troupeaux, persuadés qu’ils ont affaire à un rezzou de pillards qui vont les attaquer !
Il est de fait qu’on se lance à leur poursuite... mais seulement pour les rassurer. Le guide les rattrape, palabre avec eux... Ils se décident enfin à envoyer des parlementaires, deux femmes et un vieillard, à qui l’on parvient à faire entendre raison.
L’entente redevient cordiale. Et, pour la cimenter, les nomades offrent du lait de leurs troupeaux, ainsi qu’une chèvre, en hommage de bienvenue. Puis ils donnent des renseignements. D'après leurs dires, su jets du reste à caution, la petite troupe ne serait qu’à deux jours de marche d’Iférouane, premier poste de la colonie du Niger.
Il est à souhaiter qu’ils ne se trompent pas, car il ne reste plus qu’une outre d’eau. Aussi, après avoir fait pâturer les chameaux, reprend on en hâte le chemin.
La chaleur est extrêmement pénible et provoque une épuisante fièvre. On s’arrête bientôt pour fabriquer le dernier pain... Et la seule rencontre qu’on fasse ce jour-là est celle d’une vipère à cornes, sur laquelle peu s’en faut qu’on ne mette le pied !
Vers midi, la chamelle qui porte les bagages tombe, écrasant dans sa chute la dernière outre d’eau... Heureusement qu’on doit atteindre Iférouane ce soir !
Mais le soir est venu, et l’on ne découvre aucune trace humaine dans la morne étendue. Le guide part en éclaireur, revient... Il avoue qu’il s’est trompé, qu’il est perdu !
Situation terrible. La soif devient ardente. On trouve un peu de végétation pour les montures épuisées, mais rien pour les hommes. M. Rossion décide de partir en avant, pour essayer de recouper une piste quelconque, soit celle d'Iférouane à Agadès, soit celle d’In Azzaoua...
Et il se met en marche. Toute une journée, il va, la gorge brûlante, la langue enflée à ne pouvoir parler... Rien, toujours rien... Vingt-quatre heures se passent. Le guide s’en est allé dans une autre direction. Toutes les demi-heures, le voyageur tire un coup de feu, comme un appel de détresse. Aucun signal ne répond.
À l’aube, il repart. Puis le soleil se lève et la chaleur devient accablante. Les tortures de la soif s’exagèrent. Et toujours rien.
M. Rossion enlève les bagages d’un des chameaux porteurs, décidé à sacrifier l’animal à midi, si rien n’est survenu.
Mais voici qu’à 8 heures, du fond de l’horizon, parvient l’écho lointain d’une détonation...
Serait-ce enfin un secours ? Trois coups de feu sont tirés. Trois coups y répondent. Sauvé ?
Le voyageur lance au trot son méhari exténué. Et enfin il aperçoit au sommet d’une colline, son guide, qui lui fait des signes.
Il le rejoint. Il a retrouvé la route du poste. Avant peu, si tout va bien, on y sera !
Une heure après, en effet, voici qu’on rencontre deux tirailleurs, qui sont venus, dans ces parages à la recherche de bois.
Sans trouver la force de dire un mot, on se précipite sur eux, on leur arrache leurs gourdes.
Ce n’est qu’après avoir éprouvé la sensation de boire des aiguilles qu’on se décide à leur demander des renseignements ! Les voyageurs ne sont plus qu’à une heure d’Iferouane. Ils y courent, sans questionner plus loin...
Et une heure plus tard, en effet, M. Rossion éprouve la joie délicieuse, indicible, d’être mis en présence d’un boy bien stylé qui lui tend une eau fraîche dans un verre (un verre !), d’ailleurs aussitôt vidé, puis rempli, puis vidé, et ainsi de suite jusqu’à ce que revienne la notion normale des choses et que l’assoiffé puisse enfin remercier le brave lieutenant Niclous, dispensateur de ces délices, et lui exprimer toute sa reconnaissance... Il était temps !
Une semaine plus tard, non compris le repos pris à Iferouane et bien mérité par suite de la fièvre qui avait succédé à cet effort, M. Rossion, à travers plusieurs péripéties, aborde enfin à Agadès, but de cette dernière incursion.
Là, son premier soin est de s’informer où sont les pièces de sa voiture, car, pour lui, tout ce qu’il a fait ne compte pas, si le résultat n’en est pas qu’il puisse continuer son voyage.
Les pièces, bien entendu, ne sont pas là. Télégraphe à Kano, dans la Nigeria anglaise, où on a dit qu’elles étaient déposées... Quelques jours d’attente de la réponse... Puis la réponse elle- même : négative. On ne sait pas ce dont il s’agit.
Les mouflons sont les hôtes de la montagne où ils remplacent pour le chasseur et le targui nomade, les gazelles des plaines.
Ce sont de grands et puissants animaux, comme on peut en juger par les dimensions de la tête d’un de ces ovidés, photographiée iciLe moral est toujours bon... mais le voyageur se sent quand même bien près du désespoir. S’est-il donné toute cette peine en vain ?
Télégraphe à Paris. Télégraphe à Kotonou. Télégraphe partout où on peut espérer des nouvelles...
Et maintenant de longues, mornes, impatientes journées d’attente, sans résultat !
On est au cours de l’été. Que faire ?
Des distractions, cependant. Entre autres, l’arrivée, avec une confortable caravane, réquisitionnée à son profit, du fameux lieutenant suédois, tranquillement venu de Tamanrasset, avec une escorte de guides choisis, avec toutes les autorisations dont il a, ou non, besoin, plein ses poches... Mais, cela, c’est du règlement administratif. N’insistons pas.
Autres plaisirs : arrivé du colonel Abadie, commandant de l’A.O.F. et chef des troupes de la colonie du Niger. Son excellent et cordial accueil fait oublier à notre voyageur toutes ses fatigues et lui prouve, une fois de plus, que s’il n’avait rien à faire, au cours de sa randonnée, qu’aux officiers sahariens, il eût reçu partout les plus bienveillants encouragements et l’aide la plus précieuse !
Puis le 14 juillet, et la fête nationale : courses de chevaux, d’ânes ; distributions de prix... On se croirait dans un de nos villages de province, si le soleil n’était si chaud et s’il n’y avait, aussi, des courses de dromadaires !
Enfin, il y a les charmes de la visite de la ville, fort ancienne cité qui eut son temps de splendeur et qui en est bien déchue. Elle ne compte plus aujourd’hui que 4 000 habitants. Et on a vite fait le tour du poste militaire, qui ne mesure qu’un hectare et demi de superficie.
Puisque nous sommes arrêtés ici pour un temps qu’aucun renseignement officiel ne vient déterminer, profitons-en pour jeter un coup d’œil sur la région que le voyageur vient de parcourir à partir d’Iferouane, où nous aurons à signaler quelques particularités.
C’est celle de l’Aïr, massif montagneux qui fut jadis relativement assez peuplé, comme le prouvent d’antiques témoignages. Cà et là, en effet, on y découvre des « pierres écrites » les hadjira mektouka des Arabes, blocs de roches usés et patinés par le vent de sable et comme vernis d’une croûte noire par le temps. Elles portent parfois des figures d’animaux ou d’hommes, et la représentation du méhari sur certaines d’entre elles permet de les dater, puisque cet animal, n’a été introduit au Sahara que vers le VIIe siècle. Ce ne sont donc pas des documents préhistoriques, au sens où nous entendons ce mot dans nos pays. Ils ne sont pas moins d’une vénérable antiquité et sont « d’avant l’histoire » tout de même, puisque nous ne savons rien de ces époques en ces régions et que les caractères tifinar qui sont gravés sur le plus grand nombre de ces pierres ne nous apprennent rien à ce sujet.
Bien entendu, dans ce parcours, M. Rossion a rencontré aussi des Touareg. C’est leur pays. Mais, spectacle plus inattendu, il y a observé aussi des singes. Ceux-ci appartiennent au groupe des cynocéphales, tous plus ou moins habitants des régions montagneuses. Ils vivent là par petites bandes farouches et parfois agressives, sous la conduite d’un vieux mâle... Sont-ce des descendants de ces singes nubiens qu’adorait autrefois l’Égypte et qui en ont disparu aujourd’hui ? En tout cas, l’espèce semble la même, et c’est tout ce qu’on peut dire présentement.
La faune est d’ailleurs nettement montagneuse, comme le prouvent les mouflons, assez abondants, et aussi de petits rongeurs voisins des marmottes, improprement nommés ratons de montagne, les vrais ratons étant exclusivement américains.
Enfin, les serpents ne sauraient se faire oublier et sont représentés ici par les trigonocéphales et par une grande et grosse vipère, qui se grossit encore en se gonflant outre mesure quand elle est attaquée. Elle se caractérise par sa large tête triangulaire, ses mouvements lents, qui deviennent d’une extrême rapidité quand elle attaque, et sa façon particulière de frapper sa proie avec son museau avant de mordre, d’où le nom de vipère heurtante (Bitis arietans) qui lui a été donné.
Les moutons a tête noire sont caractéristiques de tout le Soudan. Outre leur coloration, ils se remarquent par les réserves de graisse
qu’ils accumulent en divers points de leur corps et sur lesquelles ils se nourrissent quand la disette est venueMais revenons à notre voyageur, dont la patience commence à s’émousser et qui, malgré la cordiale hospitalité reçue à Agadès, y trouve le temps désespérément long !
C’est le 21 juin, en effet, qu’il y est arrivé. Et ce n’est enfin que le 23 août qu’il reçoit un télégramme lui annonçant la mise en marche des fameuses pièces enfin parvenues à Kano et en route pour Agadès.
Par chameaux relayés, c’est encore un voyage de trois semaines. En fait, ce n’est que près d’un mois plus tard, le 19 septembre, qu’elles arriveront.
Et, ce jour-là, le carnet de notes porte cette annotation : il faut repartir au Nord à toute allure.
Le voyageur est en effet si pressé qu'il n'attend pas l’escorte, qu’on lui destine. Son chargement fait, il s’en va. On le rattrapera comme on pourra !
La piste qu’on suit maintenant est la bonne et fait qu’on traverse des agglomérations où campent des Touareg, ce qui motive, chez l’un d’eux, un chef, une cordiale réception, agrémentée d’un couscous d’honneur et même de l’offre d’un lit, sur lequel l’hôte s’endort au milieu d’un bruyant concert de bêlements de troupeaux.
Trois jours plus tard, les goumiers rejoignent. Et l’on force la marche.
Ces gens sont-ils très sûrs ? Peut-être. Sont-ils très honnêtes ? C’est une autre affaire. L’un d’eux, envoyé pour échanger, à quelque distance de là, un chameau qu’on a dû relayer à l’aller, revient, non seulement avec la bête qu’il doit reprendre, mais aussi avec celle qu’il devait restituer. Il assure qu’il l’a achetée à son propre compte. L’explication paraît plus que louche. Il faudra s’informer.
Relation est faite de l’incident en arrivant à Iferouane. Puis on repart. Trois jours après, un courrier rattrape. Le chameau a été bel et bien volé !
Cette incartade permettra du moins de tenir le personnage sur la menace d’un châtiment bien senti, s’il ne marche pas droit... Et, la crainte du gendarme étant au désert même le commencement de la sagesse, on n’aura plus trop à se plaindre de lui durant le reste du parcours.
Et c’est de nouveau, la traversée du douloureux Tanezrouft. Mêmes peines, même fatigues qu’à l’aller. Mais le voyageur est soutenu cette fois par un entraînant espoir. Et il supporte allègrement la privation d’eau, la chaleur épuisante, la déception, en arrivant au puits, de le trouver détruit par les chacals et les renards, parce que, là-bas, est sa voiture, qui l’attend !
Aussi, cette note, sur le carnet de route : « 17 octobre, départ vers 7 heures. Je brûle d’impatience, car la voiture est proche. Aussi pas d’arrêt avant de l’atteindre... »
Et c’est ainsi que, l’après-midi de ce même jour, on arrive au but !
L’automobile est là, toute seule, au milieu du désert.
Vite on en fait la visite. Rien ne manque. Mais le capot est devenu un coffret plein de sable. Et le nettoyage est commencé immédiatement.
Dès le lendemain, essai de mise en marche du moteur. Il fonctionne ! Le soir, toutes les réparations sont terminées. On va pouvoir repartir !
Le guide est renvoyé avec les chameaux sur Tamanrasset.
Demain, troisième traversée, en voiture cette fois, du Tanezrouft.
Comme signal de bienvenue, la tempête de sable s’élève le soir, et la nuit est glacée.
Il faut demeurer cependant un jour encore, pour divers préparatifs, ce qui procure aux goumiers d’Agadès la stupéfaction sans bornes d’une petite promenade d’essai en auto.
Et le 20 octobre, à 7 heures du matin, en route !LA RANDONNÉE DU RETOUR
Deux cent cinquante kilomètres sont couverts dans cette première journée. Cela change de l’allure des méharis, pourtant rapide. Il faut dire que le terrain est favorable et permet ainsi d’atteindre, en cette première étape, la colonie du Niger.
La route maintenant va s’incliner vers l’ouest, car Agadès n’est plus le but. Il faut voir du nouveau.
Tout ne va d’ailleurs pas pour le mieux. Des crevaisons se produisent. C’est facilement réparable. Mais voici la tempête encore, puis la pluie, une pluie comme il en tombe là-bas, quand elle s’y met, une pluie de déluge, aveuglante, infranchissable. Force est de s’arrêter et de camper sur place. Elle cesse enfin, et l’on repart...
Et c’est ainsi, après une course de 630 kilomètres, en deux jours et demi, sans toucher un point d’eau, que la vaillante petite voiture fait son entrée à Tamanrasset.
Ce nom célèbre rappelle de glorieux souvenirs. C’est ici que reposent deux braves sahariens, le général Laperrine, tombé, on s’en souvient, au cours d’une croisière en avion, et son vieil ami, le père de Foucauld, assassiné, le 1er décembre 1916, par les Touareg Ajjer.
Notons ici, en passant, que les assassins bien que connus, n’ont pas encore reçu leur châtiment et que l’un d’eux vit en liberté à Djanet même. Pour y attirer l’autre, dit-on.
Mais cela, comme dit Kipling, c’est une autre histoire.
Le 31 octobre, arrive le soir, à Tamanrasset, la mission Prorok-Raygasse, qui, elle aussi, avec trois voitures six-roues Renault, a traversé le désert. Elle fournira à M. Rossion d’utiles renseignements sur la route à suivre jusqu’à In Salah. Car il va bien falloir songer au retour ! Et c’est ainsi que, le 3 novembre, le voyageur se remet en chemin, non sans avoir eu quelques ennuis avec sa direction, qui a subitement pris, sans raison apparente, un jeu excessif... Mais il est venu à bout d’épreuves plus rudes et, en six heures de route, parcourt ce jour-là 174 kilomètres, ce qui l’amène au nord-est de Tit, aux bord de l’oued Iniker.
L’étape du lendemain se présente avec de plus grandes difficultés à vaincre. Il s’agit en effet de traverser les gorges d’Arak, région abrupte et parsemée d’obstacles, et qui a la réputation d’être pratiquement inaccessible.
Au cours de la longue étape à travers les étendues de sable sans fin, les rencontres sont rares. Quelques nomades cheminant au pas lent de leurs chameaux de bât, suivis des classiques « bourricots » étaient, naguère encore, avec les Touaregs pillards, les seuls hôtes de ces solitudes. Puis sont venus nos soldats, dont cette pittoresque compagnie de méharistes prouve qu’ils se sont si bien adaptés au caractère du pays que rien, sinon leur tenue et leur discipline, ne les distingue plus des « fils du désert ». C’est grâce à eux que les oasis, que les cités des sables, autrefois terrorisés par les incursions des pirates, peuvent aujourd’hui paisiblement prospérer
Mais, pour quelqu’un que l’avis des autres n’a jusqu’à présent fait reculer, les pronostics les plus sombres ne sont pas un empêchement... Pas plus que ne le seront, du reste, les difficultés annoncées, qui, pour être réelles, n’en seront pas moins vaincues !
L’automobile s’y arrête pour le campement nocturne. Puis le lendemain, après un parcours de 270 kilomètres, fréquemment interrompu pour chasser aux gazelles, elle fait halte de nouveau à l’arrivée de la nuit. Il n’y a plus qu’une petite distance à couvrir pour atteindre In Salah.
Le 6 novembre, en effet après une course qui ne dure que quarante minutes, l’automobile arrive au but. Elle a parcouru 756 kilomètres en trois jours. Dans les conditions où s’est fait le voyage, c’est un véritable record.
Que dire de la réception faite au vaillant voyageur par les officiers et sous-officiers du poste ? Elle fut ce que furent toutes les autres dans les mêmes circonstances au cours de cette randonnée au désert. Un détail cependant en fixera la joyeuse cordialité : au cours de la cérémonie, M. Rossion fut élevé à la dignité de Chevalier de l’ordre de la Tarentule du Tidikelt.... Bien des personnages s’énorgueillissent de décorations plus officielles, qui n’ont pas, certes, cette valeur, étant donnée la personnalité de ceux qui l’accordent et de celui qui la reçoit !
Remarquons ici en passant deux intéressantes figures d’In Salah. C’est d’abord un des vétérans de la prise de la ville en 1900, nommé François, qui, depuis cette date n’est guère sorti de l’oasis saharienne que pour aller à Touggourt... et est revenu aussitôt ! Et aussi son compagnon chaudois, installé là seulement depuis vingt ans, et qui ne songe pas du tout à repartir !
Décidément, même dans les « mauvaises terres » du désert, l’automobile vaut mieux que le méhari. C’est ce qui fait qu’un officier, devant faire sur cette dernière monture trois semaines de route pour rejoindre Ouargla préfère, à tous points de vue, la compagnie de notre voyageur pour accomplir ce trajet. Il prend place à bord... Et les trois semaines en question seront de la sorte réduites à trois jours.
Non sans difficultés. La tempête de sable s’en mêle, une fois de plus, voulant laisser un dernier souvenir de sa colère, au seuil des régions civilisées. Et la piste n’est pas partout parfaite, notamment aux environs d’El Baten. Néanmoins, les obstacles sont surmontés, après 121 kilomètres de route. Et le lendemain, les voyageurs arrivent à l’ancien bordj d’Aïn Gettara, abandonné aujourd’hui, et gardé par un unique gardien, plus égaré dans sa solitude que le moins favorisé des gardiens de phare, et qui paraît cependant supporter de bon cœur son isolement.
La « population » du bordj Inifel est plus importante, puisqu’elle se compose de deux hommes ! Et on y trouve tout le confort moderne, c’est-à-dire un « hôtel » possédant plusieurs chambres, et même un garage et une fosse de réparations pour auto. Ce dernier aménagement est moins superflu qu’on ne pourrait croire, comme le prouvent les innombrables débris de voitures qui jonchent la route d’accès.
Il est vrai que trois missions officielles ont passé récemment par là. C’est assez dire !
Temps glacé, dunes mouvantes, piste exécrable, occupent la journée du lendemain et résument, aux heures de l’adieu, les mauvais souvenirs du Sahara. Mais tout cela réuni n’empêche pas d’arriver sain et sauf à Ouargla, où la réception, officielle cette fois, mais cordiale tout de même, du voyageur, est faite par le gouverneur de l’Algérie en personne, qui a compris la valeur de l’effort déployé et sait en exprimer sans réserve son admiration...
D’ailleurs, maintenant que le voici revenu dans le « monde des hommes » M. Rossion va recevoir, tout le long du chemin qui lui reste à parcourir, les félicitations unanimes des personnes les mieux placées pour l’apprécier.
C’est, à Biskra, M. René Estienne, qui ne peut croire à la réalité de l’étonnante randonnée. C’est, à Tunis, l’accueil chaleureux de toute la colonie, sous la présidence du colonel Courtot en personne, qui ne marchande pas ses éloges à celui dont il a suivi avec tant d’intérêt l’audacieuse entreprise, depuis ses débuts. C’est enfin, à Médenine, les chaleureux témoignages d’admiration du maréchal Franchet d’Espérey et du général Toulat...
Mais la grande course est terminée et le voyageur est venu à bout de son extraordinaire et téméraire entreprise... À tous les applaudissements de ces personnages, nous n’avons plus qu’à joindre les nôtres. Pour être moins officiels, ils n’en sont pas moins sincères ni enthousiastes. Et nous sommes certains que l’admirative sympathie des lecteurs de Sciences et Voyages, sera, parmi tant de compliments mérités, un de ceux auxquels aura été le plus sensible M. Rossion, audacieux nomade du Hoggar et du Tanezrouft.R. THÉVENIN