Journal quotidien Le Matin du 21 janvier 1932
source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
L’ENFER DU SEL
de Léo GERVILLE-RÉACHE et Jacques ROGER-MATHIEU
Un amas de cases à demi effondrées,
une fournaise où seuls vivent et bruissent des essaims de mouches,
un mystérieux centre d’horreur, c’est Taoudeni
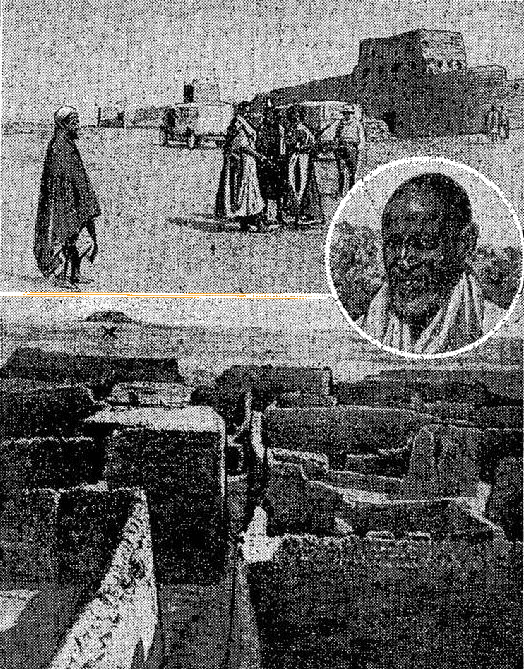
en haut : les voitures devant le ksar de Taoudeni – en médaillon :
le caïd de la ville – en bas : Taoudeni, vue prise d’une des tours
du ksar – au fond : les salines d’Agorgott indiquées par une croix.
Entre la clarté du ciel et la clarté du sol, une raie grise : la ville.
La ville ? Cet amas de pierres brunes qui boursoufle, à peine, la jaune et plate immensité des sables ?
Taoudeni !
Voici, devant nous, ce centre de l’horreur ; ce point géométrique de la solitude ; cette capitale déserte du néant ; le lieu unique au monde où se comprenne le mot : rien !
Là où est Taoudeni, il n’est rien.
Pas un arbre qui donne le bruissement de ses feuilles ; pas un oiseau qui mette, dans cet affreux silence, le friselis léger du battement de ses ailes.
Le soleil qui corrode, la lumière qui aveugle, le vent qui dessèche ont, dans ses plus secrètes cellules, désagrégé la vie.
Il n’est rien !
Au-dessus de la cité, pas une fumée qui vienne inscrire dans le ciel vide la douceur d’un foyer.
Dans cet air de feu, où semble s’être volatilisé le bruit ; pas la moindre de ces rumeurs citadines qui scandent la joie, le travail ou l’effort.
Rien que l’horreur
Il n’est rien !
Autour de ces murs gris, sur ces terrasses désertes, à ces meurtrières étroites qui abritent la peur, pas un seul être humain dans cette cité morte ; pas même un objet familier ; pas même un de ces voiles, un de ces linges qui, séchant au soleil, révèlent une présence laborieuse.
Il n’est rien !
Taoudeni appartient à la chaleur, à la souffrance et à la mort.
Non, il n’est rien, là, rien, qu’une immense, qu’une totale horreur.
Vous voici donc, Enfer du Sel, but misérable d’un patient et courageux effort. Les pierres éclatées, la terre craquelée des murs à demi éventrés de la ville lui donnent l’aspect désespéré de ces koubas à l’abandon, de ces lieux de repos délaissés où, dans l’oubli injurieux des générations qui sont venues de leur souche, d’un sommeil irrité, dorment les ancêtres.
C’est ça, Taoudeni, ce petit point gris dans l’immensité jaune.
C’est ça la ville, ce bourrelet de terre et de pierres que, à deux kilomètres de ses murs, nos yeux peuvent à peine séparer du décor monotone et plat où elle s’enchâsse.
C’est ça que nous prétendions trouver, cette petite dune grise, enfoncée au sein de 1 000 kilomètres de dunes blondes.
Alors, là, devant ce rien, mieux encore que sur l’hammada, mieux même que dans la mouvante prison de l’Erg, nous est apparue la vraie folie de notre gageure.
C’est ça Taoudeni !
Nos esprits, pleins d’humilité et de rétrospective émotion, font un retour sur eux-mêmes, s’interrogent. Aurions-nous réussi jamais si cette fortune qui, dit-on, sourit à ceux qui osent n’était venue à nous, l’autre jour, sous la noire figure d’un Kounta ?
Les derniers tours de roue
Mais la ville a voulu que nous méritions, par un dernier et rude effort, sa conquête. Trois heures durant, nous avons peiné sur cette route longue de quelque vingt kilomètres. Trois heures pendant lesquelles, énervés par l’approche, abrutis par la chaleur, disloqués par les cahots, nous nous demandions avec angoisse si, touchant au but, nos braves voitures, leurs pneus cruellement tailladés, n’allaient pas s’effondrer, pour toujours dans les abominables trous de cette caillasse.
Il était un peu plus de 7 heures quand nous avons quitté le carré, emmenant avec nous le capitaine Poggi, heureux de saisir cette occasion inattendue d’aller s’entendre avec le caïd de Taoudeni, une bonne semaine avant l’arrivée de la caravane du sel aux mines d’Agorgott.
Il va être bientôt 10 heures et, quoique nous soyons maintenant au pied même de cette énorme gara, qui, au soir, couvre d’une ombre tardive et inutile la cité en incandescence, nous n’avons pu encore discerner, dans la buée chaude qui monte de cette terre, qu’un contour indécis et flottant de la ville : un quadrilatère de cent mètres de côté, peut-être, et flanqué de quatre tours !
Dans un dernier et puissant effort pour s’arracher à ce sable meuble et humide qui les aspire, nos deux Renault foncent vers le misérable ksar et, toutes vibrantes encore de ce battement forcené de leur cœur, nous déposent, muets d’horreur et de joie, devant Taoudeni !
La porte de la ville ! Si elle n’était bardée de ce fer qu’apporta jadis, sur ses chameaux de bât, Mansour le Doré, le conquérant cruel venu de ce lointain Maroc, la plus humble masure de chez nous ne voudrait s’en contenter.
Nous sommes attendus
Sans doute, depuis longtemps, un guetteur attentif a signalé l’approche de ces bizarres machines qui avancent sans que les traînent ni des chameaux ni des captifs.
Et ils sont là toute une petite troupe immobile, éberluée, à regarder ces mystérieuses voitures qui ont pu, grâce aux génies « toubab », franchir les sables jusqu’alors inviolés de la sebkha.
À quelques pas en avant du groupe, interloqué, un homme de haute taille se drape, non sans majesté, dans un boubou blanc et bleu.
Ses yeux noirs, souverains et cruels, rendent plus redoutable encore un visage que défigure férocement ce nez que perça jadis un coup de lance.
– Labès, murmurons-nous, en portant la main à nos lèvres.
– Labès, répond l’homme, en nous rendant le geste.
Nous venons ainsi de saluer Yubo Ould Sidi Ahmed, caïd de Taoudeni.
L’excellent et si modeste capitaine Poggi, désolé de voir que son képi, sa vareuse galonnée, son magnifique « flottard » attirent sur lui seul l’attention du caïd et de sa djemma1, se dépêche de nous présenter :
– L e colonel ! Le commandant !
Mots magiques, qui précipitent instantanément sur nous les salamalecs officiels de ce dignitaire et de son « conseil municipal », tout décontenancés de n’avoir pas flairé, sous ces vêtements civils que nous portons, d’aussi hauts chefs militaires.
L’éclat de rire qu’a provoqué chez nous cette promotion aussi rapide qu’inattendue ne peut atténuer longtemps l’impression d’horreur qui nous étreint, au moment de passer cette porte étroite encore éclaboussée d’un sang ardent et généreux._____________________
1 Sorte de conseil municipal, restreint à Taoudeni à la seule et très réduite parenté du caïd.
Dans le dédale des ruelles
Nous avons franchi la poterne, seul point d’ombre fraîche, dans cette fournaise, où maintenant nous pénétrons.
En cortège nous gagnons la demeure du caïd.
Dans les ruelles que nous empruntons, personne. Il semble bien que cette poignée d’hommes qui nous suit soit toute la population de cette horrible cité.
C’est à peine si nous pouvons avancer deux de front, dans ce labyrinthe enclos de hauts murs, dans ces couloirs étroits qui sont moins, à la vérité, des ruelles d’une bourgade que les boyaux repérés sous le feu latent d’une invisible meurtrière.
Dans ce dédale encaissé, une chaleur atroce paralyse vos gestes, délie vos idées, votre volonté, décompose votre cerveau.
Avec ses murs et ses morceaux de terre, Taoudeni, à cette heure, n’est plus que le vaste four de campagne où un soleil implacable volatilise tout ce qui est vivant.
Dans cet air embrasé, irrespirable, qui a tout abattu, tout tué, tout calciné, seule la mouche vit, prospère et se délecte.
Dans la lumière éblouissante elle vole en noirs essaims.
Et comme le soleil a bientôt fait de dessécher, de pétrifier jusqu’aux détritus eux-mêmes, les mouches attaquent l’homme avec frénésie, avec avidité.
Elles ont faim, elles ont soif surtout. Elles se précipitent, se collent à votre peau, entrent dans vos narines, s’abreuvent aux commissures de vos lèvres ou aux coins de vos yeux, indifférentes à la peur, ne cédant qu’au coup brutal qui les écrase.
Leur vrombissement monotone, dans le soleil éclatant, est la seule chanson des rues de cette ville.
Nous allons lentement, écrasés par cette chaleur, par l’affreux de tout ce qui nous entoure.
Et nous songeons que nous sommes en décembre, au mois propice, au mois doux dans ce pays, qui, dans quelques semaines, va retrouver l’intolérable ardeur d’un soleil de feu.
Le puits à l'intérieur du ksar de Tadouemi
Habitations !
Dans ces murs de terre surchauffée que nous frôlons, parfois s’ouvre une ouverture sombre : de l’espèce de grotte, de caverne, qui prend là son jour, on voit alors sortir indifféremment le mouton, la chèvre ou l’être humain qui cohabitent dans cette sentine.
De semblant de maison, il n’est que ces quatre tours qui flanquent les côtés de ce quadrilatère.
Pour le reste, il n’est en cette ville que des cryptes à demi effondrées, des abris de terre à côté desquels sont des palaces les cases de nègres au centre de l’Afrique.
Nous allons bientôt arriver chez le caïd. Déjà voici le puits que commandent, soyez-en sûrs, ces meurtrières où, à l’intérieur d’une des quatre tours, il n’est que besoin d’abaisser un fusil, pour que – sans viser – on soit certain, à l’un des points sensibles de la ville, d’atteindre un assaillant.
C’est que Taoudeni, malgré son affreux dénuement, malgré sa séculaire détresse, vit quand même dans la crainte continue des rezzous.
Un puits profond, où l’on aperçoit à peine le miroitement de cette eau sombre qui emplit les alentours d’une odeur infecte de saumure !
Tout à côté, dernier vestige sans doute de la splendeur passée de la ville conquise, le bronze vert-de-grisé d’un canon de Mansour, sultan magnifique.
Une femme
Dans cette dernière ruelle qui nous amène à la demeure du caïd, un être humain, que la peur empêche même de reculer, s’aplatit contre l’incandescente muraille.
Une femme !
Devant ces hommes qui viennent, elle n’a même plus dans son trouble la force de rabattre sur son visage le voile qu’elle avait haut relevé, sans doute pour montrer à des compagnes les beaux colliers dont, pour elle, des roumis ont fait cadeau à leur caïd.
Elle reste, offerte aux regards en ses voiles mal ajustés, ne cachant tout juste, de sa demi-nudité, que son seul et magnifique regard sur lequel elle aura tout au moins pu, dans ce naufrage émouvant de sa pudeur, abaisser ses paupières bleuies de kohl !
Nous pénétrons dans la demeure de Yubo Ould Sidi Ahmed. En ces quelques minutes, nous aurons déjà parcouru toute la ville, qui, du haut de ces marches de pierre, s’offre maintenant, dans son ensemble, à nos regards.
Voici l’amas des cases à demi effondrées. Voici les gîtes innommables où vous avez atrocement souffert, sergent Soudant, sergent Sue. Voici celui où vous êtes mort d’ennui et de misère, sergent Marchetti.
Taoudeni, cité de l’horreur ! Combien est mérité ce nom qui, paraît-il, veut dire : « Charge et cours ! ».
Charge, caravanier ! Charge ton sel sur ton chameau de bât. Et puis cours, aussi loin que possible de cette désolation ! Cours sans regarder en arrière !
à suivre
Dans la demeure où se fit enfumer Moktar, caïd de Taoudeni


