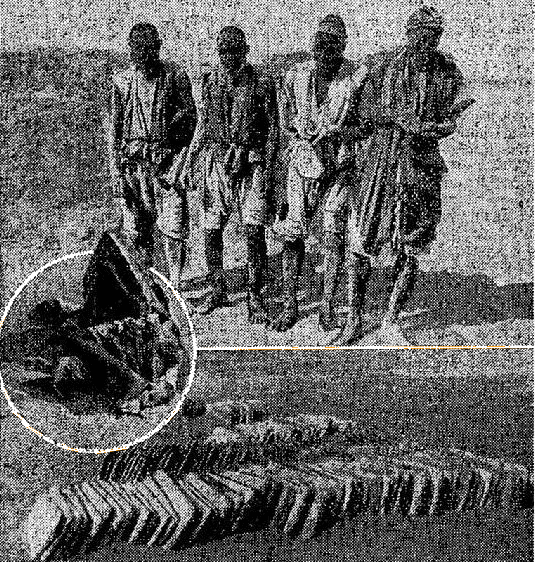Journal quotidien Le Matin du 26 janvier 1932
source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
L’ENFER DU SEL
de Léo GERVILLE-RÉACHE et Jacques ROGER-MATHIEU
Dans les cases salines des troglodytes noirs
« Devant nous, quatre hartâni, si ridés, si parcheminés,
si momifiés qu’on les croirait âgés de deux cents ans. »
en bas : des barres de sel. – en médaillon : un captif moribond.
Les trous de la mine, et puis, à côté, les trous, où gîtent les hommes.
Pour pénétrer dans ces tanières qui s’enfoncent sous le sable soutenues uniquement par une croûte de sel, il faut se baisser résolument – parfois, même, ramper.
C’est là que vivent les hartâni.
Un captif travaille sous les yeux du caïd de Taoudeni.
en médaillon : un autre captif travaillant dans une fosse.
Notre peau offerte, par avance, en holocauste, à toutes les démangeaisons, nous avons pénétré dans ces affreux réduits.
Les couches alternées de la terre et du sel en sont l’unique maçonnerie, comme cet énorme bloc qu’on dirait de verre dépoli, arraché aux salines, en est le seul ameublement.
C’est sur ce bloc que l’hartâni travaille, répare ses outils, accommode le mil. C’est sur le sable qu’il mange ; c’est dans le sable qu’il dort.
Les femmes
À notre approche, une femme a saisi ses deux petits et s’est enfuie.
Car, il y a des femmes en cet enfer. Peu, du reste. Dix, croit le caïd, dont le recensement, dans ce dégoût, est incertain.
Dix femmes qu’ont faites encore plus esclaves qu’eux-mêmes les soixante-dix hartâni qui travaillent aux mines.
Elles sont jeunes et autour d’elles – seule note de gaieté vivante, au sein de cette horreur – la nuée braillante et joyeuse des gosses !
À qui sont-elles au juste ?
Allah seul le sait.
À ceux dont la mine n’a point encore fait des moribonds, à ceux qu’un tremblement sénile – à l’âge où les autres hommes sont jeunes – n’a point tout à fait transformés en vieillards.
À qui sont-ils au juste, eux, les petits ?
À personne et tous. À la famélique communauté de cette détresse. Ils sont beaux, d'ailleurs, ils sont forts, ils sont gentils.
C’est que le rauque appel de l’homme aux soirs de désir, l’appel de celui qui, parmi ces déchets, est resté le plus fort, l’appel du plus beau, du plus vaillant, assure, dans l’enfer du sel, la sélection de la race.
C’est la nature qui la première a poussé le cri affreux de Vae Victis !
Malheur aux vaincus ! Malheur aux faibles. Il y a, dit-on, des nuits tragiques à Agorgott, dans les cases salines des noirs troglodytes.
Ces soirs-là, quand, à l’abri des murs de Taoudeni, le caïd et les notables entendent monter dans la sérénité de ce désert le cri sauvage de bêtes humaines, fusil au poing, on fait bonne garde dans le ksar autour des femmes qui, apeurées, écoutent...
Menus de famine
Dans ce trou où nous avons pénétré il est impossible de se tenir droit. Pour quoi faire d’abord, se tenir droit ! Les hommes à la mine ont pris l’habitude de vivre courbés.
Ici ils rampent.
Sur le bloc de sel, dans une calebasse, on préparait du mil, lorsque notre venue a mis en fuite la jeune et noire ménagère.
Ce mil, c’est d’un bout à l’autre de l’année à peu près l’unique nourriture des captifs.
Ajoutez-y quelques oignons secs, un peu de farine de baobab, pour ceux qui n’ont pu s’habituer à l’eau magnésienne, et enfin du thé. Vous pouvez dès lors composer pour 365 jours le menu journalier de l’hartâni.
Et malgré cette famélique indigence, vous allez voir maintenant que le travail de ces malheureux ne peut même pas parvenir à leur assurer les quantités de ces misérables denrées nécessaires à la vie.
Sur huit jours de travail l’équipe d’une fosse en doit six à ses maîtres. Le produit des deux autres jours lui est concédé pour payer sa nourriture.
L’équipe extrait en moyenne dix barres de sel par vingt-quatre heures. C’est donc vingt barres que ces quatre hommes auront à se partager. Vingt barres de sel, qui seront à la prochaine azalaï troquées contre des aliments, des étoffes ou des outils.
Eh ! bien pour ces misérables qui ainsi ne gagnent même pas une barre de sel par jour, savez-vous quel serait le minimum de nourriture nécessaire ? Un kilo de mil non décortiqué. Et que coûte t-il ce kilo ? Une barre de sel !
Travail forcé
Alors ?
Alors c’est la faim, la misère physiologique, le vol qui se paiera en châtiments corporels, c’est surtout la dette continue, fatale, vis-à-vis du maître, la dette qui, elle aussi, vous fait esclave et vous rive à la fosse.
À voix basse que peuvent à peine saisir nos interprètes, ces hommes nous ont dit leur détresse et le prix exorbitant dont il leur faut payer leurs vivres aux traitants de l’azalaï.
Cinquante barres de sel pour un kilo de thé ; dix barres pour un pain de sucre ; pour quelques oignons secs, encore deux barres ; et de nouveau deux barres pour cette coudée de guinée – cinquante centimètres d’étoffe bleue – dont il faut bien que la coquetterie plus encore que la pudeur des femmes se confectionne de ces longs voiles qui déteignent si joliment sur la peau brune.
Alors quand on ne gagne même pas une barre de sel par jour, comment payer tout cela, comment vivre ?
Sous ce ciel féroce travailler beaucoup pour manger peu, c’est l’épuisement, la misère physiologique.
Le rendement de l’équipe diminue, on peut à peine arriver à fournir dans la semaine les six jours de travail que prélève le maître. Pour l’hartâni, il ne reste rien. Il n’a plus de quoi acheter du mil à l’azalaï.
Alors ?
Alors il crève.
À la prochaine caravane du sel, on le remplacera.
À Tindouf les Tadjakants « connaissent manière » d’avoir de l’embauche pour Taoudeni.
Il n’y a pas seulement la faim. Il y a la soif. La soif inextinguible tout au long de l’année, la soif que cette eau magnésienne et salée attise et que l’on ne peut combattre que par le thé… qui coûte si cher.
Cette eau, un célèbre officier méhariste, aujourd’hui colonel Galet-Lalande, a eu l’idée de la faire analyser. Elle est, paraît-il, chargée en sel, un tiers de plus que l’eau de Janos.
Elle vide les hommes.
Comme par scrupule professionnel nous nous apprêtons à en boire, un hartâni arrête notre geste et à l’oreille de notre interprète :
– S’ils n’ont point l’habitude de cette eau, qu’avant de la boire au moins ils enlèvent leur pantalon !...
Il paraît, que pour les nouveaux venus à Taoudeni, et pour tous les tirailleurs de l’azalaï, cette mesure vestimentaire et conservatoire est de rigueur.
Le sel conserve
Il n’y a pas à dire, malgré l’horreur de ce pays, le sel conserve.
Devant nous, quatre hartâni si ridés, si parcheminés, si momifiés qu’on les croirait âgés de deux cents ans.
Dans ces plis en tout sens, qui sont des visages humains, rient des bouches édentées.
Leur nom ? Ils ne se le rappellent plus. Leur âge ? Ils ne l’ont jamais su.
Depuis quand es-tu ici ?
Celui-là, y est depuis que les Français sont entrés à Tombouctou.
C’était un esclave. Razzié il a été emmené aux mines. Depuis sans doute l’esclavage été aboli… mais celui-là, à Agorgott, on l’a peut-être bien oublié.
Ils sont là devant nous, ces quatre pitoyables squelettes noirs, à danser d’un pied sur l’autre en riant.
Que veulent-ils ?
Rien. De même qu’ils n’ont plus de souvenirs, qu’ils n’ont plus de pensées, ils n’ont plus de désirs.
Hormis un seul : avoir un peu plus à manger !
Nous avons fui, bouleversés, loin de cette déchéance.
Un autre pauvre bougre est là. Il tend, vers nous, une main dont les chairs de la paume crevées jaunâtres livides, et toutes grumeuses du corrosif, laissent apercevoir les os. On lui soigne cette plaie atroce avec du crottin de chameau.
Que voulez-vous, on a les médicaments qu’on peut…
Sortons, sortons de cet enfer où notre cœur défaille.
Comme de grands enfants hilares et jacasseurs, les hartâni entourent nos voitures et ne s’étonnent même pas.
Une chaleur affreuse fait monter, de cette terre blessée par cent ouvertures, une vapeur âcre et lourde, où tout autour de nous miroite un sable blanc.
Ces visions épouvantables ont brûlé nos yeux qui clignent douloureusement.
Partons ! Il vaut mieux encore regagner, là-bas, Taoudeni.
Mais cet enfer ne lâche pas si facilement ceux qui n’ont pas craint de pénétrer son horreur.
Au bord de cette fosse d’où monte le nauséeux relent de la saumure, un hartâni est couché, la tête elle-même recouverte des voiles bleus de son boubou.
Il meurt.
À notre approche il s’est soulevé. Il a dévoilé devant nous ses yeux qu’abandonne la vie.
Pas une plainte ne monte de cette bouche crispée déjà par la fatale étreinte.
Souffre-t-il ? Souhaitons que non pour lui qui ne peut attendre l’adoucissement, ni d’un remède, ni d’une tendresse.
Pour son agonie, il n’aura que ce chant des morts, anonyme et funèbre qui monte de la mine.
Il a vécu sans rien. Il meurt tout seul !
à suivre
Trois mille chameaux en marche vers Taoudeni. C'est l'azalaï 1931