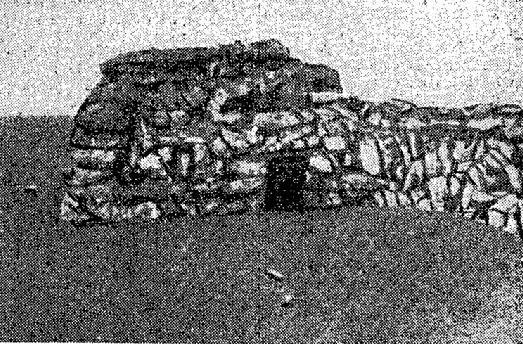Journal quotidien Le Matin du 29 janvier 1932
source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
L’ENFER DU SEL
de Léo GERVILLE-RÉACHE et Jacques ROGER-MATHIEU
Le ravitaillement d'eau au sinistre puits de Telig
*
L’évocation de la tragédie de 1912
où la mort héroïque du lieutenant Lelorrain
ne put sauver de la destruction l’azalaï qu’il escortait
*
Photo prise par le lieutenant Gallet-Lalande (aujourd’hui colonel).
Les troupes rendant les honneurs aux victimes de l’affaire d’El Guettara
Entre les méharistes à la rouge chéchia et les goumiers aux voiles bleus, qui patrouillent sur ses côtés, l’azalaï ayant, à l’aube, levé le camp, sous la caresse dorée et douce encore d’un jeune soleil, lentement chemine.
En files interminables vont les trois mille chameaux de la caravane. Ils vont à pas comptés, à pas égaux.
Leur placidité hautaine impose à cette marche une discipline rigoureuse qu’enfreignent, seuls, par instants, les petits chamelons qui entre eux folâtrent au loin avant que les fasse revenir dans le rang l’appel maternel inquiet et courroucé.
Ainsi, pendant de longs moments, l’immensité vide et silencieuse va s’émouvoir de ce cheminement fantastique et grave, dont s’est empli soudain son lugubre décor.
Mais ce n’est pas vers Taoudeni que se dirige l’azalaï. Il lui faudra, avant de prendre le chemin des salines, attendre quelques jours encore que les hartâni épuisés aient complété le nombre de barres de sel dont on chargera ses chameaux de bât.
Vers l’abreuvoir
Pour occuper ce désœuvrement, le capitaine Poggi a décidé qu’on irait faire, à Telig, l’abreuvoir.
Et nous aussi, dont la provision d’eau a bien diminué, nous nous sommes joints à l’azalaï.
Nous refaisons cette route, parcourue l’autre jour, alors que nous guidait notre providentiel Kounta.
Mais, cette fois du moins, nous irons à Telig. Il n’y est point de djich, point d’embuscade, le chouf1 que, dès hier, a envoyé, en ce lieu, le capitaine Poggi a donné l’assurance que dans ce coupe-gorge nous ne ferions point, aujourd’hui, de mauvaises rencontres.
Et déjà voici les deux énormes gours entre lesquels se dresse la haute colline que couronne la tour du poste abandonné.
Lentement, le cœur étreint par le souvenir de ce que souffrit là, avant de devenir fou et de se suicider, un petit sergent de chez nous, nous avons gravi la funèbre hauteur.
Tandis que les hommes creusent et déterrent les puits, tandis qu’on apporte les guerbas et les tonnelets, et que pour l’abreuvoir des chameaux on tapisse les trous de sable de pièces de hockhoum2, nous nous sommes assis et nous songeons.
De la terre, qu’un soleil déjà ardent fait fumer, monte vers nous le tremblant rappel des horreurs passées.
______________
1 Éclaireurs méharistes.
2 Morceaux de tente de cuir imperméable des nomades
Le puits de Telig
Dans ce miroitement aveuglant des pierres calcinées, l’épopée du désert violemment nous assaille. L’épopée qu’on n’a jamais sue ou qu’on a oubliée. L’épopée qui dans ce pays de la mort seule peut-être est vivante !
La mort du capitaine Grosdemange
Les yeux perdus dans le lointain, le capitaine Poggi murmure :
– C’est de Telig que revenait Grosdemange, l’héroïque Grosdemange, lorsque, arrivé à Araouan, il reçut la nouvelle d’un rezzi Rgueïbat et Beraber, dans le Timetrin. Si vous redescendiez par là, vous verriez encore autour du puits d’Achourat les corps des cent razzieurs qui ont payé de ce prix la mort du capitaine Grosdemange. Achourat ! le combat atroce qui a duré trois jours.
« Vous ne trouverez point un seul goumier targui qui consente à vous y accompagner, car on y entend, au soir, assurent les hommes du voile, la plainte des morts, sans sépulture, qu’on a jetés dans les puits. »
Ô tragique holocauste des Sahariens à l’immensité vaincue de ce désert !
Le geste émerveillé et religieux du capitaine Poggi nous désigne, au bas de ces hauteurs, vers le sud, l’insondable étendue.
C’est tout ce pays affreux, et près d’ici même où est l’eau, qu’ont jalonné de leurs corps les fuyards assoiffés d’El Guettara.
L’embuscade d’El Guettara
Le nom du puits sinistre a fait jaillir en nous le rappel de l’horrible embuscade.
L’affaire remonte à vingt ans, mais elle est toujours d’une sanglante actualité, car elle peut être à nouveau l’affaire d’aujourd’hui, l’affaire de demain, l’affaire de tous les jours à venir dans ce désert auquel tant d’héroïsme et de sang dépensés n’ont pu donner encore une sécurité.
Nous avons souvenance du récit dramatique hâtivement lu par nous dans ces notes palpitantes que livrera peut-être un jour le général Meynier.
Le récit qu’à voix basse, avec des arrêts d’émotion qui poignent, va nous faire le capitaine Poggi, aux sources mêmes de l’information il l’a puisé.
L’affaire d’El Guettara, l’escorte anéantie, l’azalaï détruit, mille chameaux volés par le rezzi Rgueïbat, grâce à Poggi nous allons en connaître la tragique aventure qu’a contée l’époque, en un rapport sobre et magnifique, le lieutenant Galet-Lalande.
Le lieutenant pardon, le colonel Galet-Lalande, le méhariste célèbre et de panache – don Quichotte d’Araouan ! – Celui-là même qui se fit sévèrement admonester par ses chefs parce qu’il avait voulu, à l’annonce du désastre, poursuivre les fuyards et relever sur le sable, où leurs cadavres n’étaient point encore desséchés, les compagnons tombés dans l’accomplissement héroïque de ce devoir obscur et quotidien.
L’affaire ? Le 23 mai 1912.
L’azalaï montait vers Taoudeni.
Ce jour-là, un rezzi de 100 Rgueïbat tenait le puits d’El Guettara. Il venait de razzier les Ouled Djerir et il avait un nombre considérable de chameaux à abreuver, avant de ramener sa prise vers Oum-el-Assel et le nord.
Il se gardait. C’est-à-dire, comme on se garde au désert, non en avant, mais derrière soi, sur les traces qu’on laisse. Les choufs avaient donc les yeux tournés vers le sud.
Et c’est venant du sud qu’ils aperçurent, en ce matin, six goumiers kountas.
C’était la pointe d’avant-garde de l’azalaï. Pour le rezzi, il fallait tenir le puits ou mourir. Il fallait avoir le temps de remplir les guerbas et de faire boire les bêtes qui allaient fournir un long effort dans le désert.
La position était bonne.
Si le Regueïbat pouvait craindre le tirailleur, il avait des raisons de mépriser le kounta et il se devait de tenter une aventure dont le bénéfice se traduirait peut-être par des milliers de chameaux.
Les Maures se retranchèrent et attendirent. Ils pouvaient le faire, ils n’avaient pas soif.
La marche à la mort
L’azalaï, désormais fixé sur le combat prochain qu’il allait falloir livrer, continuait sa marche.
Il lui fallait gagner El Guettara.
Il lui fallait le puits, ou alors se coucher sur le sable et mourir.
Aller de l’avant c’étaient le combat et ses chances. Retourner en arrière, c’était la mort – la plus affreuse – par la soif.
On se battrait donc sauvagement pour la possession de ce point d’eau.
Le lieutenant Lelorrain commandait l’escorte de l’azalaï, secondé par l’adjudant Rossi.
Quand, au soir, il arriva en vue d’El Guettara, il ne pouvait songer à attaquer avec ses tirailleurs et ses goumiers exténués, qui pleuraient en réclamant de l’eau.
Il fit former le camp. On déchargea les bêtes et, quand tout fut en ordre parfait, il fit distribuer à chaque homme le dernier quart de liquide rougeâtre fourni par les tonnelets.
Cette eau était brûlante, comme si on l’avait préparée pour le thé.
Lelorrain avait mûri son plan.
Avec ses braves Sénégalais – si peu nombreux, hélas ! ils étaient trente – il partirait à l’attaque tandis qu’avec ses cinquante goumiers kountas, sur la valeur guerrière desquels il se faisait peu d’illusion, l’adjudant Rossi esquisserait un mouvement de flanc.
Et la nuit vint, prolongeant de sa chaleur énervante les tortures que durant un jour torride avaient connues ces assoiffés.
Les Sénégalais, qui se seraient battus un contre vingt pour un quart d’eau, se préparaient en silence à cet égorgement.
Les Kountas, visages fermés, ne laissaient percer cette terreur folle qui les gagnait que dans leurs prières balbutiées et leurs soupirs.
Tout alentour, les chameaux exaspérés de l’entrave et sentant l’eau toute proche, blatéraient, lugubrement dans cette nuit hostile.
À la première clarté, Lelorrain se dressa :Trois heures de combat
– Tirailleur, cria-t-il, si tu as soif, y a bon l’eau, là-bas !
Et ce fut une charge féroce.
Mais la fusillade terrible qui riposta couchait à plat ventre les plus courageux, les plus assoiffés.
Trois heures de combat, le nez dans la terre, les yeux exorbités, la gorge en feu.
À la fin, n’ayant même plus de voix pour pousser leur cri de guerre, exaspérés et prodigieux, les tirailleurs se dressèrent tout debout pour l’hécatombe.
Le premier, Lelorrain tomba, la gorge sèche percée d’un trou sous la barbe blonde éclaboussée.
Sur le corps de leur chef, héroïques, sacrifiés à cette tendresse enfantine et disciplinée qui était le meilleur d’eux-mêmes, les tirailleurs venaient se faire tuer.
Vingt cadavres protégeaient maintenant dans la mort le corps sans vie du lieutenant Lelorrain.
Aux premiers coups de feu, les Kountas s’étaient débandés.
Seul sur le sable, les bras en croix, l’adjudant Rossi, les yeux grands ouverts, semblait prendre le ciel à témoin de cette lâcheté.
Dans sa troupe : un mort héroïque – lui – et puis : cinquante fuyards !
Mais ceux de ces lâches que dédaignaient même, dans leur fuite, les fusils des Rgueïbat, ce fut le désert qui les régla.
Les derniers devaient venir crever de soif à quelques kilomètres du puits profond de Telig.
Quand ils les dépassèrent, quelques jours plus tard dans leur marche vers le nord, les guerriers du rezzi, qui ont le mépris des lâches, ne leur firent l’aumône ni d’une parole ni d’une balle.
Au désert, pour que les razzieurs vous épargnent, il faut qu’il vous méprisent bien.
L'exécution du dernier tirailleur
Mais lui, Noumouki Taraoré, tirailleur valeureux, ne pouvait trouver grâce aux yeux du Rgueïbat.
Parce que c’était un brave, ils l’ont tué.
Il était pourtant désarmé. Il ne pouvait plus rien. Le massacre était terminé, qui le laissait seul, prisonnier, soumis.
Maintenant que la fièvre du combat était tombée, Noumouki Taraoré ressentait plus cruellement encore la soif qui lui serrait la gorge et lui tenaillait les tempes. Il demanda à boire.
On le mena auprès du puits où les chameaux tiraient les longues cordes auxquelles pendent les seaux de cuir qui montent l’eau.
Avec les bêtes – et comme une bête, car on l’avait dépouillé de ses vêtements – on l’attela.
Son effort exaspéré par le bruissement de ces seaux qui dégoulinaient tirait sur les cordes avec fureur.
Par moment, les Rgueïbat arrêtaient le travail épuisant dans cette chaleur pour donner à boire aux animaux.
Mais à Noumouki Taraoré, malgré ses supplications, ils ne donnaient rien.
Enfin, comme il pleurait de souffrance et de folie, l’un de ses tortionnaires parut s’adoucir.
Il remplit du liquide une coupe de bois. Le Sénégalais, le regard en extase, sentait la vie s’approcher de ses lèvres.
Il n’osait croire pourtant à la mansuétude et reculait devant son bonheur.
Il reculait sans détourner la tête. Et pour cela il ne voyait pas derrière lui cet autre Rgueïbat qui, souriant d’un rire cruel, armait son bras de la lame brillante d’un poignard.
Quand il fut à toucher l’arme, le premier Rgueïbat, de sa coupe d’eau renversée, frappa le tirailleur en plein visage.
Du même coup, entre les deux épaules, le fer homicide entrait à petites secousses.
Maintenant, étendu les bras en croix, Noumouki Taraoré, tirailleur méhariste au groupe nomade d’Araouan, buvait, de ses grosses lèvres noires, quelques gouttes d’eau qui, ruisselant de sa face, venaient, miséricordieuses, se mélanger au sang de son dernier hoquet !
à suivre
Sous la menace des rezzou que la T. S. F. signale de toute part