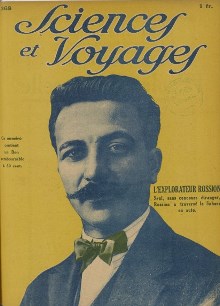
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 368 du 16 septembre
1926
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

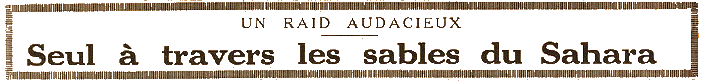
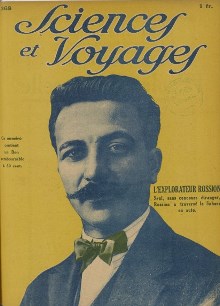
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 368 du 16 septembre
1926
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

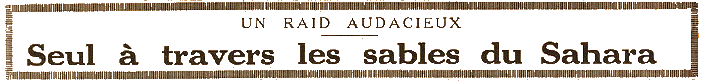
photo du haut à gauche : C’est dans une simple voiture de tourisme, dont la carrosserie seule avait été aménagée pour la circonstance, que M. Rossion a traversé les montagnes du Hoggar et les déserts du Tanezrouft.
photo du haut à droite : Il fallait parfois monter à l'assaut des dunes mouvantes où les roues s'enlisaient jusqu’aux essieux. Et les descentes, sur ce sol instable, étaie parfois plus périlleuses encore que les montées.
photo du bas : Partout, dans les postes isolés du désert, la réception fut, comme ici, au bordj de Bir Kescira, pleine de cordialité
Ce n’est pas la première fois, ni, espérons-le, la dernière que Sciences et Voyages rend hommage et accorde sa large publicité à l’initiative, au courage, à l’endurance, voire même à la témérité de certains jeunes hommes qui, dédaigneux de suivre les routes battues et de se soumettre aux directives officielles, entreprennent, seuls, sans aide, sans subventions, sans tapageuses réclames, des exploits que d’autres, pourvus de tous ces moyens et dont la tâche est, d’avance, facilitée au maximum des possibilités, réussissent tout juste à accomplir.
Bien mieux, ceux-là dont nous parlons, loin de recevoir les encouragements des autorités, voient se dresser autour d’eux toutes sortes d’obstacles, d’empêchements, de contre-ordres, — disons le même, — de jalousies et de méfiance , qui suffiraient, en dehors des difficultés matérielles, à faire reculer les plus hardis.
Cependant, ils n’en tiennent pas compte et vont toujours droit à leur but. Et ils finissent tout de même par l’atteindre, parce qu’ils ont en eux ce qu’aucun « personnage » ne leur pourrait donner : la conviction, l’ardeur et la foi. C’est avec le secours de ces dons précieux que nos lecteurs ont vu réussir hier, dans de magnifiques randonnées, M. Jean Thomas, lors de sa mission chez les pêcheurs du Niger ou de son voyage en cyclecar dans le nord du Sahara. C’est grâce aux mêmes vertus qu’ils pourront suivre, avec un intérêt et une admiration qu’ils ne lui marchanderont pas, l’extraordinaire « fugue » de M. Rossion, traversant seul la partie la plus redoutable de l’immense désert africain.
Cette traversée d’un territoire jusqu’à ces dernières années considéré comme presque infranchissable, il n’est pas certes le premier à l’avoir accomplie. On a fait assez de bruit autour des diverses tentatives de ce genre pour que cette constatation ne soit une nouveauté pour personne. Loin de nous l’idée d’enlever rien du mérite de ceux qui l’ont ainsi réussie. Mais alors que le monde entier retentissait de leurs exploits, on s’est bien gardé de dire un mot des autres... Pourquoi ?
Qu’on nous permette, pour toute réponse d’évoquer un souvenir déjà lointain.
photo du haut à gauche : Les « routes » du désert laissent parfois beaucoup à désirer au point de vue du confort ! Heureux encore quand la piste, comme ci-dessus, s’étend sur un terrain à peu près plat
photo du haut à droite : Une vue de Ghadamès, sur la frontière de Tripolitaine. Ce sol hérissé du premier plan est celui du cimetière, où chaque pierre levée désigne un mort anonyme
photo du bas : L'accueil fait par la garnison italienne de la ville ne diffère en rien de celle des postes français sous le rapport de la cordialitéIl y a une quarantaine d’années, l’Amérique, à grand renfort de tam-tam, de grosse caisse et de journalisme enflammé, envoyait au cœur de l’Afrique un reporter, Stanley, dont la valeur, certes, fut grande, mais dont, surtout, le nom fut enfoncé à coups de dithyrambes dans toutes les mémoires... Or, ce même Stanley rencontra, un jour, au Congo alors inconnu, une sorte d’individu minable, une espèce de mendiant loqueteux, selon ses propres termes, « nu- pieds, ayant sur le dos un restant d’uniforme d’officier de marine qu’un chiffonnier n’aurait pas ramassé, miné par les fièvres, s’avançant péniblement... ».
Ce chemineau en déroute s’appelait Savorgnan de Brazza, et il venait lui aussi, de traverser la grande sylve vierge, mais seul, sans appui, sans argent, sans trompettes ni tambours.
La manière de Brazza, c’est la manière française. Celle de Stanley, c’est la méthode américaine... ou américanisée.
Sans autre commentaire, disons que c’est à la manière française que M. Rossion vient de traverser la Sahara.LA RÉGION À PARCOURIR
Le Sahara est grand comme l’Europe, ce qui revient à dire que sa superficie, en chiffre rond, est égale à dix millions de kilomètres carrés.
Du nord au sud, soit de l’Atlas algérien au lac Tchad la route à couvrir est de plus de 3 000 kilomètres. C’est la distance de Bayonne à Moscou, mais une distance qu’il faut franchir à travers les sables mouvants, les montagnes ou les déserts de pierre, sans chemins, sans jalons sans cités, sans secours.
Pays de chaleur torride et de glace à la fois, rongé par d’ardentes sécheresses ou noyé sous de soudains déluges, sans autre végétation que celle des miraculeuses oasis, plus éloignées les unes des autres que les villes des pays les moins peuplés.
Il est possible qu’à des époques perdues dans le lointain des âges, cette terre maudite ait été riche et plantureuse. Des inscriptions et des dessins rupestres, qu’on retrouve en grand nombre dans le Hoggar, prouvent que l’éléphant, l’autruche, le cheval, le bœuf, etc., habitaient jadis ces contrées et que les deux derniers même y étaient domestiqués, ce qui est le témoignage d’une civilisation avancée. Mais, depuis que les hommes écrivent l’histoire, ils l’ont connue telle qu’elle est encore, aujourd’hui, déserte, désolée, pratiquement inhabitée, sinon par une race aussi ancienne, aussi farouche, aussi mystérieuse qu’elle-même : les Touareg.
Si la théorie darwinienne est vraie — et il y a ici toutes les apparences qu’elle le soit — que le milieu façonne l’être à son image, ce peuple est bien l’expression vivante de sa patrie sans bornes. Fils des soleils de feu et des nuits de glace, les Touareg sont purement représentatifs de leur habitat, d’une énergie morale qui n’a d’égale que leur vigueur physique. « La sécheresse comme le froid, dit, en parlant d’eux, le capitaine Aymard, durcit la fibre humaine. Et le désert est un créateur et un conservateur d’énergie. »
Une autre vue de Ghadamès, dont les maisons aux lignes simplifiées à l’extrême
rappellent les conceptions de nos architectes futuristes les plus avancésNous aurons d’ailleurs maintes occasions de reparler de ces tribus. Aussi bien, nous ne nous attarderons pas sur l’histoire et la géographie saharienne, puisque nous les observerons chemin faisant, suivant en cela l’exemple de notre voyageur qui s’en alla à sa magnifique aventure, presque sans s’inquiéter où elle le menait.
PRÉPARATIFS DE DÉPART
Au cours de l’avant-dernière année, tandis que s’organisaient les grandes randonnées automobiles qui après d’autres causes devaient attirer l’attention universelle sur le Sahara, deux jeunes gens, MM. Rossion, d’origine belge, et de Précourt, français s’intéressèrent comme tout le monde à la question. Présentons-les brièvement à nos lecteurs : Le premier d’entre eux fit la guerre dans l’Est africain et fut parmi les vainqueurs de Tabora. Le second est le fils d'un officier mort au champ d’honneur.
Or, ces jeunes gens, se demandèrent un jour l’un à l’autre si ces expéditions coûteuses mobilisant un personnel nombreux et nécessitant des frais considérables, ne pouvaient être de beaucoup simplifiées et si on ne pouvait remplacer tout ce mouvement d’hommes, de forces et d’argent par de la volonté et de l’énergie.
Ils se donnèrent à eux-mêmes la réponse et reconnurent que, si ces vertus suffisaient, ils en possédaient assez pour espérer réussir. Alors, sans bruit, sans rien demander à personne, sans rien attendre de quiconque, ils se préparèrent...
Ce qui revient à peu près à dire que M. Rossion monta dans sa voiture sans beaucoup plus d’émotion que s’il se fût agi d’aller faire une excursion dans la banlieue, et se mit en route vers « là-bas », laissant à plus tard le soin de se ravitailler et de se prémunir... Ajoutons d’ailleurs que connaissant déjà l’Afrique il se sentait spécialement attiré par la région vers laquelle il allait accomplir ses exploits.
Son véhicule lui-même n’avait absolument rien de spécial. C’était la plus ordinaire des voitures de tourisme, une Delage 11 CV, évidemment solide et élastique, mais qui n’avait reçu aucune modification aucune adaptation particulière au travail qu’on allait exiger d’elle. Le moteur était un quatre-cylindres, à soupapes commandées par culbuteurs, nerveux et endurant et avantage tout de même en la circonstance, strictement hermétique.
Partie, donc, de Paris, l’« expédition »» se rend à Marseille et, de là, s’embarque pouf Tunis.
En haut et de gauche, à droite : En route pour la grande randonnée.— Le sable est le pire ennemi de l'automobiliste en ces régions. Tout s'y enfonce et lui-même pénètre partout ! La première voiture automobile qui soit allée à Ghadamès. Au volant, M. de Précourt. — Au-dessous : à gauche. Pour ces orientaux, tous ces miracles, l'automobile, la photographie, etc. sont autant de rites mystérieux dont l'accomplissement est dû, non à la science des hommes, mais au pouvoir des génies et des démons ! — À droite : Le premier puits, rencontré en plein bled, après avoir campé dans la montagne auprès des dunes d’El Bab, est le bienvenuLa voici sur cette terre d’Afrique qu’elle rêve de conquérir.
LES DIFFICULTÉS COMMENCENT
Sans savoir ce qu’elles seront, notre voyageur s’attend bien à rencontrer des vicissitudes sans nombre au cours de sa randonnée. La chaleur, le froid, la solitude, l’égarement, le sable, la soif, les pillards, sont, il le sait des ennemis terribles. Cependant, il est prêt à leur tenir tête et, déjà se mettrait en route, si un obstacle plus formidable que tous ceux-là réunis ne se levait à ce moment devant lui : l’autorité officielle et compétente.
On peut demeurer plusieurs jours sans boire, subir l’attaque d’un rezzou ou recevoir l’assaut d’une tempête de simoun, et s’en tirer si on a le cœur bien pendu. Mais obtenir d’un fonctionnaire l’autorisation d’entreprendre ce que les règlements n’ont pas prévu est une affaire bien autrement redoutable. Et l’inertie à laquelle on se heurte alors est une force beaucoup plus puissante que toutes celles de la nature déchaînées !
Notez bien que notre voyageur ne demande absolument aucune aide, quelle qu’elle soit, aucun subside, aucun secours. Il prie simplement qu’on le laisse faire, c’est-à-dire qu’on lui permette d’installer à ses frais sur un point de sa route un poste de ravitaillement qui lui facilitera le chargement de sa voiture. Cela n’est pas bien difficile à comprendre et, de plus, ne coûte rien... Mais... cela ne se fait pas ! Le paragraphe tant de l’article tant ne porte aucune mention de la chose. Ni pour, ni pour ni contre. C’est d’une logique admirable et d'autant plus solide qu’elle n’existe pas. Comment, dès lors, voulez-vous la discuter ?
M. Rossion cependant discuta, avec cette obstination des êtres d’action qui ne comprennent pas d’abord comment leur énergie s’annihile en frappant dans le vide. On ne lui opposait du reste aucun refus catégorique. C’eût été faire preuve d’existence. Mais on parlait d’autre chose, on détournait la question on laissait ses demandes sans réponse. Il n’y a pas de meilleur tactique pour décourager les gens.
Messouda.— Le lieutenant Lederff, le cheik Hamed et les notables
Il vaut mieux, dit le proverbe, s’adresser à Dieu qu’à ses saints. Notre voyageur finit par comprendre la vérité du vieil adage. Il n’hésita pas, laissa là sa voiture, reprit le bateau, reprit le chemin de fer, revint à Paris, et s’en alla trouver Dieu lui-même, c’est-à-dire, M. le résident général en Tunisie, qui d’ailleurs, comme pour faire mentir le dit proverbe, s’appelle M. Saint.
Celui-ci, comme il fallait s’y attendre, fit au visiteur le meilleur accueil, et le confia aux bons soins du colonel Courtot.
Nos officiers sahariens ont cet avantage sur les employés des bureaux affectés au même domaine, qu’ils connaissent, autrement que sur les statistiques ou sur la carte, les régions dont ils ont la surveillance ou la direction. Le colonel accorda donc cordialement toutes les autorisations qu’on lui demandait et qui étaient de sa compétence. Cependant, malgré sa meilleure volonté, son autorité ne s’étendait pas au-delà de certaine limites. Pour ce qui était de la traversée des territoires du Sud, il fallait s’adresser à leur commandant, M. le colonel Toulat (depuis général).
Nouveau départ. Chemin de fer, bateau, etc. Le colonel réside à Médenine, en Tunisie. M. Rossion se rend à Médenine, trouve le colonel, lui expose son cas.
Réception plus cordiale encore, si possible, qu’à Paris. Pas plus que le précédent, cet officier simple, franc, aimable, n’a rien d’un rond-de-cuir ; et il connaît son territoire comme un bon intendant connaît son domaine...
Le seul malheur est qu’il le connaît même trop bien et en sait tous les dangers, tous les obstacles, tous les détours, toutes les embûches, et, lorsqu’il voit de ses yeux dans quel équipage on s’y veut risquer, il ne peut dissimuler son appréhension.
Du moins, il prend gaiement et paternellement la chose et essaie, loyalement, honnêtement, de démontrer à celui qu’il appelle le « volontaire du suicide » les périls où il s’expose. Mais l’aspirant explorateur tient bon, et, cette fois du moins, s’il discute, obtient l’honneur qu’on écoute avec une attention bienveillante ses arguments. Il plaide si bien sa cause que l’officier, ému d’un si jeune et fervent enthousiasme, fait incliner le devoir de sa responsabilité devant les droits sacrés d’une si belle espérance. Mais comme sa conscience parle avant tout et qu’il s’agit, en somme, d’une vie humaine il subordonne son autorisation à la décision d’une épreuve. Le volontaire fournira la preuve de son endurance et de celle de sa machine en faisant un raid d’essai ; on lui accorde quarante-huit heures pour aller à Ghadamès !
Le colonel a promis cela un peu comme on promettrait à un enfant de le laisser jouer avec le feu à condition qu’il décrochât d’abord la lune. Mais le champion a été piqué au vif.
— Quarante-huit heures s’écrie-t-il. Que de temps de perdu ! Dans vingt-quatre, je serai au but.LA COURSE À GHADAMÈS
L’équipement de la voiture comprend 18 litres d’huile, 360 litres d’essence, un ressort arrière et un ressort avant, quatre roues montées et quatre en réserve pour pouvoir être jumelées au besoin, 20 litres d’eau, le ravitaillement pour dix jours, cartes, boussoles, armes, munitions, outillage, etc.
Elle emporte à son bord, outre MM. Rossion et de Précourt, un guide, et... un invité...
Un mot, en passant, sur l’invité. C’est un aimable officier de l’armée suédoise, en promenade, lui aussi, dans ces régions, et qui, lui aussi, a besoin, partout où il passe, de l’autorisation de l’Administration française...
Mais vous comprenez bien qu’étant étranger, et, qui plus est, militaire étranger, il les obtient toutes, toutes, sans la plus petite difficulté. Et, sans doute pour favoriser le change, il peut réquisitionner guides et chameaux au prix réduit, tandis que nos Français ne purent jamais les obtenir, quand ils les obtinrent, qu’au prix fort !
N’insistons pas et reprenons notre voyage.
C’est le matin, du 22 octobre 1924, que la petite voiture avec ses quatre passagers quitte le poste de Foum-Tatahoine et s’engage sur la piste, dans la direction du bordj Lebœuf.
Oui, le colonel connaît bien son territoire, car l’épreuve qu’il a imposée est un résumé de toutes celles qui attendent nos voyageurs au cours de leur grand raid. Ils vont rencontrer, en effet, chemin faisant, toutes les difficultés du désert : d’abord la région montagneuse, avec ses oueds plus ou moins ravagés par les orages, leurs lits encombrés de pierrailles et d’alluvions. Puis le sable. Puis la grande dune mouvante, l’erg, dont il faudra surmonter les obstacles en risquant de s’y enliser.
Messouda et sa garnisonEn tout, à vol d’oiseau, 1 000 kilomètres, environ, aller et retour, sur une piste qui n’a rien de celle d’un autodrome et qui, en bien des endroits, n’existe même pas du tout.
Mais, si la foi déplace les montagnes, elle permet aussi de s’y déplacer. Voilà nos automobilistes en route. Advienne que pourra. Ils se sont juré de réussir.
La première étape à atteindre, le bordj Lebœuf, que l’on appelle aussi Bir Kessira, de son nom indigène, est situé à peu près au point où le Djebel Daha devient le Djebel Tebaga, chaîne de collines plutôt que de montagnes, si l’on ne considère que leur altitude, qui ne dépasse guère quelque 600 mètres, mais où la circulation est certainement beaucoup moins facile que sur nos plus hautes routes des Alpes ou des Pyrénées ! La direction générale du soulèvement est nord-sud, mais des contreforts la coupent perpendiculairement, laissant passage à des lits de ravins tantôt à sec, tantôt torrentueux, dont les uns vont se perdre à l’ouest dans les sables, dont la plupart se réunissent pour former le lit du Karoui Laghered qui roule ses eaux, lorsqu’il en a, jusqu’à la Méditerranée.
Les méharistes s’en retournent, laissant les voyageurs courir leur audacieuse aventure...
Plus que partout ailleurs, les adieux sont émouvants au désert !La piste que l’on suit est celle des caravanes. Après quelques détours, elle s’incline nettement vers le sud-sud- ouest, s’écartant un peu de sa direction droite, mais gagnant tout de suite les pentes plus douces du versant occidental. Pour arriver jusque-là, cependant, il faut faire parfois de rudes efforts, étant donné surtout le lourd chargement de la voiture. Celle-ci arrive au but tout de même, sans graves incidents, à une moyenne de 30 à l’heure, ce qui est plus qu’honorable en de telles conditions.
Il s’agit maintenant de gagner Djanéen, poste situé sur l’oued du même nom, dans la région des hautes dunes.
Le cheik AMED ose prendre place dans la voiture ensorceléeLa sortie du bordj ne s’opère pas sans mal. C’est qu’il faut traverser un lit de torrent dont aucun service vicinal n’a aménagé les abords et où le seul travail de voirie qui s’y fasse est laissé aux soins de la pluie et du vent. Ceux-ci ne s’inquiètent pas spécialement des automobilistes. Ils apportent des pierres, charrient du sable, mêlent le tout de la façon la plus inconfortable qu’ils peuvent. C’est à vous de vous débrouiller là-dedans.
La Delage II HP s’y débrouilla, sautant de roc en roc, avec une confiance qui honorait ses ressorts et une agilité qui honorait son conducteur. Tant de constance fut enfin récompensée. On atteignit les dunes. Cela allait aller tout seul, à condition de ne s’y pas enliser.
C’est ce qu’on fit néanmoins aussitôt.
Les roues entrèrent dans le sable avec décision et unanimité, y enfoncèrent jusqu’aux essieux, s’y implantèrent solidement.
Et les voyageurs commencèrent à comprendre que l’épreuve imposée par le colonel était bien une épreuve.
Il y avait un remède : jumeler les roues. On s’y employa sans tarder. Et, comme l’aide arrive toujours à qui sait s’aider soi-même, celle-ci parut sous la forme d’un nuage de poussière où se précisa bientôt un groupe de goumiers, accourant au galop de leurs petits chevaux nerveux : les Arabes du poste de Djanneen, prévenus par ceux de Kessira et venant à la rencontre des voyageurs.
Leur secours, d’ailleurs, ne fut que moral, puisqu’ils se bornèrent à tourbillonner magnifiquement autour de la voiture, puis à se déployer à ses côtés en royale escorte, quand elle put démarrer. Mais la beauté du spectacle était digne de redonner du cœur à ceux-là même qui en eussent manqué. Comme ce n’était pas présentement le cas, les choses n’en allèrent que d’autant mieux. On rencontra bientôt une piste moins impossible, et, peu après, on atteignit le bordj.
Si vous jetez les yeux sur une carte de Tunisie un tant soit peu détaillée, vous y trouverez Djanneen indiquée par un petit point rond exactement comme le serait chez nous un chef-lieu de canton ou d’arrondissement.
N’allez pas en conclure que vous êtes parvenu ici dans une bourgade, ni même dans un hameau, si modeste qu’il soit. Représentez-vous plutôt un espace, grand en tout comme le plus petit de nos jardinets de banlieue, mais un jardin sans fleurs ni arbres, où vivent, seuls, isolés de tout l’univers, quelque chose comme quatre hommes et un caporal, ou plutôt un brigadier puisque c’est de cavaliers qu’il s’agit.
Ces jeunes hommes font là, comme en tant d’autres postes semblables de nos lointains territoires, un stage de douze mois, quand ce n’est pas de vingt-quatre, sans autre spectacle, sans autre distraction, sans autre pensée que le désert. Saluons-les bien bas en passant. Mais ne leur demandons pas la permission de les plaindre. Ils nous la refuseraient certainement. Vous n’avez pour vous en convaincre, qu’à interroger ceux qui reviennent de ces solitudes et qui en ont gardé le spleen !
L’amour de cet imposant isolement ne va pas cependant jusqu’à exclure la sympathie pour ceux qui le viennent troubler. C’est vous dire si notre expédition fut chaleureusement accueillie dans le petit poste. Hâtons-nous de dire, comme vous vous y attendez, du reste, qu’il en fut de même dans tous les postes du désert où elle passa.
Au-delà de Djanneen jusqu’à Méchiguig, sur la frontière de Tripolitaine, à 100 kilomètres au sud, la route est relativement facile. On déjumela donc les roues, et on repartit, après un cordial déjeuner, pour aller camper à Bir-Zar, au tiers environ du chemin.
Cette première journée de marche a permis de couvrir 190 kilomètres. C’est une remarquable performance. Mais le plus dur est encore à accomplir.
Le lendemain, à deux heures, arrivée à Méchiguig, poste plus important, qu’un officier, le lieutenant Lowden, commande. Nous n’insistons pas sur la réception. Ce sera, nous l’avons dit, partout la même, cordiale, chaleureuse, fraternelle...
Après un repos bien gagné, à l’aurore du jour suivant, la voiture se remet en route.
Un nouveau guide a pris place à son bord. C’est que la région qu’il s’agit de traverser maintenant est la plus mauvaise qu’on ait rencontré jusqu’alors. On ne va pas tarder à s’en apercevoir.
C’est d’abord un terrain mélangé où tous les échantillons de la géologie saharienne sont plus ou moins représentés : collines, sables, pierres, tout y est. Mais ce n’est rien encore. Voici enfin l'erg.
On sait ce qu’on nomme ainsi : c’est ce qu’on pourrait appeler également la « dune en marche », ou le « désert mobile ». C’est l’immense vague de sable qui déferle, à 500 kilomètres au-delà, jusqu’aux oasis du Sud, pour s’interrompre et reprendre vers l’occident jusqu’au Guir marocain C’est la houle mouvante que déplace, efface, reforme, soulève, emporte le souffle du simoun, dressant les crêtes de ses lames à des hauteurs de 300 mètres, et qu’arrêtent, seules, comme autant de digues, les pierres stériles et noires des Hammadas.
Cette comparaison avec une grande étendue liquide n’est pas qu’une image. Elle constate un rapport avec l’origine de ces terribles régions autrefois, aux temps quaternaires sans doute, couvertes de vastes fleuves, qui, au cours des âges, se sont peu à peu desséchés. En déposant leurs sédiments, ces fleuves ont accumulé ces sables en nappes plates que le vent a reprises et modelées. La légèreté des éléments qui les composent les rend essentiellement mobiles et changeantes. Aussi leur aspect est-il constamment modifié. On comprend que s’y guider d’après les seuls aspects du paysage serait aussi vain que de se conduire sur la mer en prenant des repères sur la courbe des vagues. Aussi arrive-t-il aux meilleurs guides de s’y égarer. Et celui de nos voyageurs n’échappa pas à l’accident.
Après quatre heures de route, en effet, cherchant de tous côtés un passage à peu près possible et ne le trouvant pas, l’auto, à plusieurs reprises, s’enlisait... Il fallait passer, cependant, coute que coûte... On avait fait tous ces détours Pour éviter les grandes dunes d’El Bab. Puisqu’on ne trouvait pas où se glisser à côté d’elles, il n’y avait plus qu’une ressource : les attaquer de front !à suivre
n° 369 du 23 septembre 1926 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs