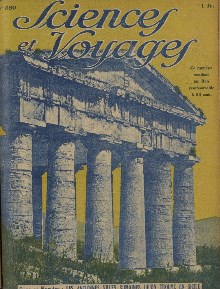
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 380 du 9 décembre 1926
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

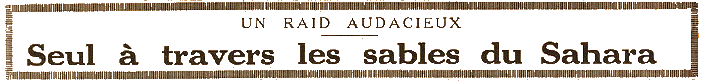
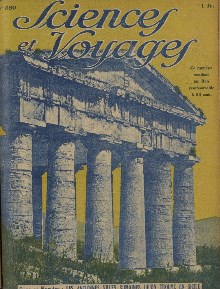
Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 380 du 9 décembre 1926
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

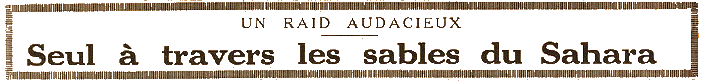
Cette morne plaine ou pas une herbe ne pousse, c’est le Tanezrouft, le pays de la soif et de la peur, le désert, dans sa plus terrible acception.
Au centre : L’architecture futuriste la plus audacieuse ne semble-t-elle pas retourner
de dix siècles en arrière, en imitant ces vestiges d’un lointain passé ?
Les gazelles sont les hôtes charmants de ces lieux sauvages. Elles fournissent un excellent gibier
L’ERMITE DANS SON ERMITAGE
Cependant, le printemps s’approche. et sa venue commence à s’annoncer par des nuits plus tièdes. Au lever du jour, le thermomètre indique 7° au-dessus de zéro. C’est un progrès et une consolation.
Le voyageur isolé s’installe dans sa solitude. Avant lui-même, il songe à protéger sa fidèle voiture, pour qui ce garage en pleins sables n’est pas spécialement recommandé. Et il met également à l’abri le matériel et l’essence dont il n’aura plus à se servir désormais avant longtemps.
La précaution n’est pas superflue, car voici bientôt, avec l’approche de l’équinoxe, les perturbations atmosphériques, dues peut-être aux mouvements des alizés, là-bas, vers le lointain Ouest, et leur conséquence, la tempête de sable.
Cela s’annonce par une sorte de calcination de la lumière qui devient roussâtre et trouble, tandis que l’horizon s’efface dans une nuée fauve. Puis le nuage monte en trombe, obscurcit le ciel, semble se matérialiser en poussière ardente, qui, comme une grêle cinglante, s’abat bientôt.
Tout disparaît là-dedans, tout se couvre de poudre impalpable qui pénètre toutes choses. La vue est bouchée à quelques pas, comme par un épais brouillard. D’ailleurs, on ne songe pas à regarder. Le voyageur s’est couché sous une couverture et laisse passer le tourbillon... Si toutefois on peut employer ce mot « passer » pour un phénomène qui dure et se prolonge de longues heures !
Heureux encore s’il se trouve au camp en ce moment. Car, éloigné de lui, il risquerait de ne le retrouver jamais, tant l’aspect des choses se modifie après l’assaut de la tornade, qui bouleverse le sol, efface les pistes, transforme le terrain. En de tels instants, si bien trempé qu’on soit, il est assez difficile de ne pas se laisser aller aux réflexions amères. Et, malgré lui, M. Rossion pense aux derniers adieux du guide, qui ne pouvait croire qu’il resterait là seul, à l’attendre, tout le temps que son absence durerait.
Mais les pires choses ont une fin, et la tempête s’atténue et s’apaise. Rassurons-nous, d’ailleurs. Il en viendra d’autres !
En attendant, il faut profiter de l’accalmie et faire l’inventaire de l’installation.
Les vivres sont plutôt maigres. Ceux qui sont partis en ont emporté la meilleure part, car ils en auront besoin, eux aussi. Le sucre, notamment, et les épices font défaut. On s’en passera, voilà tout. Mais la provision de viande commence aussi à s’épuiser et il ne reste plus grand chose de la dernière gazelle tuée. Il faut aller à la chasse.
Ces gazelles, elles sont assez abondantes dans les environs pour qu’on n’ait pas trop de craintes sur les possibilités de ravitaillement du garde-manger. À condition toutefois que la tempête de sable ne se renouvelle pas. Or, c’est justement ce qui arrive ! Après une excursion de quelques kilomètres, le chasseur, surpris, est obligé de revenir en hâte au gîte. Il se passera de dîner ce soir-là. À moins qu’on ne compte pour un dîner quelques comprimés alimentaires.
Et la vie continue ainsi, dans l’infinie solitude. Quant aux impressions du solitaire, essayons de les retrouver en feuilletant le carnet de route pendant cette période. Elles doivent être, vous le pensez, sombres, mélancoliques, désespérées... Pour vous le prouver, je relève toutes les courtes phrases qui correspondent à des états d’âme, en ces jours-là :
« Nuit très bonne. » — « Je constate avec le sourire que je n’ai plus de sucre. » — « Comme je ne ferai plus que deux repas par jour, je n’ai pas à me plaindre. » — « Le cœur content, je pars pour la chasse. » — « Ce soir, j’emploierai mes derniers comprimés Prevet, qui me semblent excellents... »
Et voilà, c’est tout. N’est-ce pas que ce sont bien là les sentiments d’un homme accablé par son destin ?
Entre temps, pour s’occuper, il explore les environs et surtout se met à la recherche de l’eau, question de vie ou de mort.
Nulle part, elle n’apparaît affleurant le sol. Mais, à quelques kilomètres du camp, existe une dépression formée par la jonction du lit desséché de plusieurs oueds, et où croissent quelques plantes que l’œil déjà exercé de notre Robinson des sables reconnaît pour être de celles qui trouvent à vivre sur les terrains qui recouvrent une nappe liquide. Il faudra creuser à cet endroit, quand la nécessité l’exigera.
Y a-t-il aussi quelques êtres vivants, dans ces parages ? Il est bon de s’en assurer.
Nous verrons bientôt qu’il s’y trouve certains hôtes des moins désirables, notamment plusieurs espèces de serpents très venimeux, dont nous aurons à reparler. Puis, en dehors de gazelles, quelques mammifères assez typiques, entre autres un petit carnivore, dont il n’est pas sans intérêt de donner une brève description.
Le lecteur n’est pas sans avoir entendu parler des fennecs, petits canidés assez proches des renards et dont l’espèce la plus commune est le fennec zerda, habitant typique des déserts africains, gracieux animal au museau pointu, à la fourrure couleur de sable, à la queue épaisse et touffue, et remarquable surtout par ses vastes oreilles, beaucoup plus longues et larges en proportion que celles des renards et garnies intérieurement de longs poils blancs.
Ce sont des rôdeurs nocturnes, habitants de terriers qu’il savent creuser rapidement dans le sable, et qui se mettent en chasse à la tombée du jour, pour surprendre les gerboises, les lézards, les sauterelles même, et aussi pour se nourrir de fruits, là où il s’en trouve, et dont ils sont très friands.
Leur excessive prudence fait qu’ils ne se rendent aux abreuvoirs que par de nombreux détours, en demeurant toujours cachés dans les plis du terrain. Et, c’est justement en suivant leurs traces qu’on arrive parfois à découvrir les points d’eau, à des distances plus ou moins grandes.
Or, le zerda est répandu dans tout le Sahara, depuis l’Algérie jusqu’en Égypte et en Nubie. Il fut un des animaux symboliques des mauvais génies du désert, bien qu’assez inoffensif, chez les anciens Égyptiens.
Mais, au voisinage d’Akafour, à la hauteur du tropique, où se trouvait alors arrêté notre voyageur, il semble que ce soit une autre espèce de fennec qui soit particulière à cette région, probablement le sabora, que Ruppell avait déjà signalé en Nubie, et qui se distingue du premier par une taille plus grande (longueur du corps, près de 50 centimètres au lieu de 40), une coloration plus gris brunâtre des oreilles relativement plus petites et une physionomie générale qui le rapprocherait un peu plus du renard. M. Rossion captura vivant un de ces animaux, qui eut, plus tard, les honneurs de l’objectif !
Enfin, parmi la faune observée par le voyageur en ces lieux, il faut encore signaler de curieux reptiles, les varans, sortes de grands lézards dont les dimensions rappellent presque celles des crocodiles, car certains d’entre eux atteignent jusqu’à 2 mètres de longueur.
Ce sont des sauriens mi-terrestres mi-aquatiques, à la queue longue et forte, remarquables surtout par leur langue allongée, qui peut rentrer, comme celle des serpents, dans une sorte de fourreau. Ils se nourrissent, selon les régions, de petits mammifères ou de poissons et, malgré leur grande taille et leur mauvaise réputation auprès des Arabes, sont à peu près inoffensifs.
Cependant, le temps passe. Les nuits sont devenues plus chaudes, atteignant maintenant 11°. Et tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, s’il ne s’agissait que de vivre au gré de l’heure présente, sans penser à rien.
Mais, malgré sa bonne santé morale, le solitaire ne peut oublier qu’une certaine caravane a dû, depuis longtemps déjà se mettre en route de Djanet, où on l’avait recrutée, avec la mission de s’avancer sur les traces des automobilistes.
Or, depuis ce temps, elle doit être loin, si elle marche toujours ! Mais marche-t-elle ? Est-elle même partie ? Là est la question !
Et voici qu’un jour, étant à la chasse et inspectant l’horizon à la jumelle pour essayer de découvrir le gibier, M. Rossion aperçoit, tout au loin, un groupe qui s’avance lentement.
Il s’approche, peu à peu. Et l’on distingue une patrouille de méharistes. Amis ou... douteux ? On ne sait encore. L’observateur s’est prudemment dissimulé derrière un repli de terrain et attend.
Enfin il croit reconnaître des réguliers sahariens. Il sort de sa cachette, s’avance à leur rencontre...
Quelle n’est pas sa surprise de les voir se déployer en tirailleurs, comme pour se préparer à une attaque !
S’est-il trompé ? Il regarde encore. Non. Ce sont des Sahariens.
Mais alors, pourquoi ce mouvement stratégique ?
Il n’en eut l’explication que plus tard.
Les nouveaux venus, au nombre de huit, étaient bien cette escorte qu’il attendait depuis longtemps, mais qui s’était mise en route, — pour quelles mystérieuses et administratives raisons ? — avec un grand retard.
Toujours est-il que, voyant cet homme seul, armé, et ne voulant, ne pouvant pas croire qu’il fût là tout seul, ils avaient craint une embuscade et avaient pris toutes leurs dispositions en conséquence. Il fallut que « l’ennemi » se présente à eux pour les convaincre !
Il est inutile de décrire ici leur stupéfaction, pas plus que le soulagement éprouvé par celui qu’ils venaient enfin rejoindre. On a beau avoir pris son parti des évènements et s’être adapté aux circonstances, on n’en éprouve pas moins une grande joie de revoir ses semblables, surtout lorsque ceux-ci vous apportent des nouvelles du reste du monde, qu’on n’était pas plus sûr que cela, après tout, de jamais revoir.
Et puis, joie qu’il faut comprendre, les arrivants apportent du sucre ! Quel thé succulent on va pouvoir faire ! Et avec quelles délices on l’absorbera, le soir venu, tous réunis autour du grand feu où rôtissent deux gazelles fraîchement tuées !
C’est d’ailleurs une ère de raffinements qui commence pour notre voyageur : n’a-t-il pas maintenant à sa disposition toute l’eau nécessaire pour se débarbouiller ? Et même, comble de volupté, il peut abattre sa barbe hirsute et se raser de frais. « Quelles. Délices ! » note-t-il dans son carnet...
La voiture de M. Rossion, prête à achever sa randonnée
Cependant, cette eau précieuse, il ne faut tout de même pas la prodiguer inconsidérément. Et il est bon de songer à l’avenir. Notamment il faut, maintenant qu’on est en nombre, aller visiter ce point d’eau possible, observé, comme nous l’avons dit, aux environs.
Mais, avant tout, il faut donner aux amis lointains de ses nouvelles. Lettres, télégrammes, sont écrits. Et un courrier, détaché de l’escorte, les emportera à Djanet.
Maintenant, la vie est bonne. On chasse pour ravitailler la petite troupe, et on a la chance d’abattre un énorme mouflon, qui, outre sa chair appréciable, procure fort à propos une précieuse réserve de graisse, qui justement commençait à faire défaut.
Cette question de la chasse, primordiale en de telles circonstances, fournit d’ailleurs un ample sujet de conversation, le soir, autour du feu de bivouac, et révèle au voyageur l’existence d’animaux plus ou moins étranges sur la piste desquels ses propres recherches ne l’ont pas encore mené.
C’est ainsi qu’un Targui de l’escorte affirme la présence dans la contrée d’une espèce de loup, dont la description qu’il en fait n’est pas assez « scientifique » pour permettre de l’identifier d’après ses seuls dires, et aussi celle d’un certain buffle, dont le principal caractère serait qu’il peut rester plusieurs jours sans boire, mais que, les faits se précisant, il semble qu’on peut reconnaître comme n’étant qu’une antilope, probablement le mohar, grand et bel animal, assez commun en effet dans la région.
Quoi qu’il en soit, la recherche des traces de cet être mystérieux fait que nos chasseurs se dirigent, à peu de temps de là, vers cette région où M. Rossion a déjà remarqué la présence possible d’un point d’eau. Maintenant qu’il a des aides et aussi des outils à sa disposition, il va pouvoir se rendre compte si ses provisions ne l’ont pas trompé. La solution du problème est d’un intérêt général assez grand pour qu’on se mette sans plus tarder à sa recherche.
Les dispositions sont prises. Et bientôt on creuse dans le sable, à l’endroit présumé, un trou d’un mètre environ de diamètre.
Les prévisions étaient justes. À une profondeur de deux mètres, on commence à trouver le sable humide. Et voici l’eau enfin, mais qui ne filtre que goutte à goutte, parce que, quelques décimètres plus bas, ce n’est plus le sable, mais la roche, qu’il semble bien difficile ici d'éventrer à coups d’explosifs, car tout s’éboulerait.
Constatations faites, on s’aperçoit que le précieux liquide suinte à travers des fentes de la pierre. Il n’y a donc qu’à prendre patience et c’est ce que l’on fait. Si bien qu’au bout de quelques heures le trou s’est suffisamment rempli pour permettre de faire le plein de deux outres et d’abreuver deux chameaux.
Si on ajoute à cela que cette eau est limpide et pure, que la source coule lentement, mais régulièrement, on comprend la valeur de cette découverte et le plaisir avec lequel elle est accueillie !
Tout irait donc à souhait, malgré la déprimante monotonie de ces interminables heures d’inaction, si, de temps en temps, la tempête de sable ne venait se rappeler au bon souvenir des campeurs et imaginer, à chacune de ses visites de nouveaux désagréments.
Comme les hommes et les animaux, la pauvre voiture éclopée en prend plus que son compte et disparaît alors sous une manière de petite dune, bien menaçante pour ses engrenages et ses organes internes, car le sable essaie de s’insinuer partout et emplit l’intérieur du capot. Mais le moteur est bien hermétique et paraît réfractaire à toute pénétration. D’ailleurs, tout essai de nettoyage serait inutile. Ce serait à recommencer à peine fini !
Et les jours continuent de passer... Quand on ne chasse pas, ou qu’on n’attend pas, complètement empaqueté dans une couverture, que la tornade soit apaisée, on s’occupe comme on peut. C’est ainsi qu’avec un vieux bidon d’essence, M. Rossion fabrique une poêle à frire ! Cela permettra de varier le menu, ou du moins la façon de l'accommoder...
Mais la patience et la bonne humeur sont des vertus qui, comme telles, méritent récompense. Si bien qu’un beau jour, la récompense arrive, sous forme d’un méhariste, courrier envoyé de Djanet, et qui apporte, ô miracle, des lettres, des journaux et même des livres ! On devine s’il est bien reçu.
Mieux que tout cela, il apporte des nouvelles du plus haut intérêt, car elles concernent la Grande Mission, dont il y avait bien longtemps, semble-t-il, qu’on n’avait entendu parler.
Si longtemps, même, qu’il ne doit plus y avoir grand-chose à en dire, sinon que son voyage s’est triomphalement terminé et qu’elle est en train, peut-être, d’en recommencer un autre ? Justement, les journaux que voici parlent d’elle. Éclatant succès... Exploit unique... Miraculeux tour de force... Il n’y a pas d’épithètes assez louangeuses pour qualifier ce qu’elle a fait.
Cela, c’est ce qui est imprimé. Mais le récit du messager diffère légèrement... Ne raconte- t-il pas que, non seulement, la mission n’a pas atteint son but, mais encore qu’elle est dans l’impossibilité absolue de revenir en arrière ?
C’est curieux tout de même, dans la vie, comme on constate d’étranges variations entre les récits faits par les témoins directs des événements et ceux qui sont rédigés à quelques milliers de kilomètres... Mais ce sont, vous n’en doutez pas, ces derniers seulement qu’il faut croire, puisqu’ils représentent, fournis par l'infaillible administration, les seuls documents authentiques et officiels !DE NOUVEAUX VISITEURS
Cependant, voici le printemps qui s’affirme, puisque les hirondelles... s’en vont ! Elles retournent en effet vers le nord et notre voyageur, qui les regarde s’enfuir, ne songe pas sans quelque mélancolie que certaines d’entre elles seront avant peu en France...
La vie au désert : de nombreux chiens errent autour des campements,
signalant de loin l’étranger qui, par tradition, a toujours été un ennemi dans ces parages
— À droite, tout un résumé de la vie nomade : le décor, la maison, le véhicule et, devant lui la maigre végétation qui suffit à son entretien !
Mais d’autres hôtes les remplacent, dont la présence de plus en plus effective ne laissera plus le temps de s’abandonner au spleen, car elle réclamera l’attention de tous les instants.
C’est d’abord un petit scorpion qui se révèle, à l’heure du thé, de la façon la plus aimable, en grimpant sur les genoux de l’hôte. Manifestation qui est en même temps un avertissement, car elle signifie qu’avec le retour des nuits moins froides, insectes, arachnides et surtout serpents vont se remettre en mouvement et ménager aux dormeurs, obstinés à coucher à même le sable, les plus agréables réveils.
La prédiction se trouve réalisée plus tôt qu’on ne l’attendait...
Quelques jours plus tard, un matin, un des Sahariens est mordu par une vipère à cornes !
Heureusement, M. Rossion possède du sérum antivenimeux. Il fait immédiatement une piqûre, garrote le bras au-dessus de la plaie et... fait de son mieux pour relever le moral du pauvre homme qui, sachant les conséquences habituelles de l’accident, lorsque des soins peu efficaces sont pris, comme cela se produit d’ordinaire en pareil cas chez ces peuplades, est complètement déprimé.
Crainte justifiée, d’ailleurs, malgré l’effet puissant du sérum, la main du blessé enfle. Puis il est pris de vomissements et la fièvre monte pendant la nuit.
Le lendemain, une poche de sang noir se forme à l’endroit de la morsure. Une incision y est faite, qui semble apporter un peu de soulagement. Mais, sous ces climats, et avec la chaleur torride qui règne maintenant pendant le jour, des complications sont encore à craindre, et on ne peut se prononcer.
La situation ne s’améliore pas du fait qu’un autre indigène, ce même jour, trouve un gros scorpion dans son burnous. Et il n’est pas consolant non plus de constater que les vivres s’épuisent, que la dernière boîte de conserves vient d’être vidée, qu’il ne faut plus compter que sur le gibier, qu’il n’y a presque plus de thé, ni de sucre, et, plus grave encore, que le tabac va manquer !
En revanche, ce qui ne manque pas, ce sont les mouches ! Elles s’abattent par nuages, par tourbillons, couvrent d’un grouillant manteau tout ce qui est comestible, sans qu’il soit possible de s’en débarrasser.
Voici maintenant qu’on craint la gangrène, pour l’homme mordu. Son doigt, où est la plaie venimeuse, enfle toujours, noircit toujours. L’ongle s’en détache... Et l’état moral est à l’avenant.
Encore des scorpions dans les vêtements... Puis ce sont les traces d’un naja qu’on relève dans le camp, traces qu’heureusement on peut suivre et qui conduisent à l’animal lui-même. Inutile de dire qu’on lui ôte aussitôt toute velléité de renouveler sa visite... Mais c'est égal. Les nuits, dans ces divers voisinages, manquent de sécurité, et, malgré la bonne couchette du sable, l’intérieur de la voiture est encore préférable.
Deux figures pittoresques d’In Salah. Ces vétérans de la conquête,
MM. Chaudois et François, demeurant la depuis de longues années
Mais le temps passe, le temps passe, et l’absence de nouvelles de ceux qui s’en sont allés commence à devenir inquiétant. Le courrier devrait être de retour. On l’attend anxieusement, et en vain.
La privation de thé et de tabac est si grande qu’on recherche maintenant, dans le terrain d’alentour, tout ce qu’on en a jeté, après usage, les jours d’abondance. Les vieux « mégots » sont recueillis avec un soin pieux, et l’on tamise le sable où le thé a été répandu comme s’il était aurifère... Et le résultat est qu’on obtient une boisson à peu près imbuvable, à laquelle on préfère encore l’eau !
Enfin, un beau jour, ce courrier tant attendu arrive ! Grande joie ! Mais peu de résultats. Ils manquent aussi de vivres, là-bas, à Djanet, et n’en ont pu faire qu’un envoi insignifiant. Et les nouvelles fraîches que le courrier apporte ne sont pas plus riches. Pas de lettres. Et aucun renseignement sur ce qu’est devenu M. de Précourt.
Il faut prendre une énergique décision. La situation ne peut se prolonger éternellement ainsi. De plus, l’homme mordu par la vipère est toujours dans un état assez inquiétant...
C’est décidé. M. Rossion retournera à Djanet, pour se remettre en contact avec la civilisation et prendre les mesures qui seront nécessaire pour poursuivre sa route. Car, plus que jamais, il veut réussir !
Le soir même, il est en chemin.
Et c’est alors une rapide randonnée, à travers les nuits glacées ou sous le soleil de feu, en s’arrêtant aux rares points où se trouve du bois pour le foyer et de l’herbe pour les chameaux.
Tant et si bien qu’on arrive enfin au but.
Là, comble de malchance, la T. S. F. ne fonctionne pas. Il faut attendre. Enfin, M. Rossion apprend que les pièces, les fameuses pièces qu’il attend toujours pour la réparation de sa voiture, sont à Kano, dans la Nigeria anglaise au sud-ouest du Tchad, point terminus de la voie ferrée, et aussi de la grande route des caravanes par où elles parviendront à Agadès.
À cette nouvelle, plutôt que d’attendre, notre voyageur préfère aller au-devant... C’est une nouvelle course à dos de méhari, de plus de 1 000 kilomètres. Mais l’épreuve de cette sorte d’exercice est faite maintenant.
Et tout vaut mieux que l’inaction !À TRAVERS LE TANEZROUFT
Le 24 mai, à 8 heures du soir, M. Rossion se met en route, à la tête d’une petite escorte de méharistes qu’on lui a imposée et dont il se serait d’autant plus volontiers passé qu’elle lui sera plutôt une gêne qu’une aide. Mais il n’y avait pas à discuter !
La région qu’il va traverser est ce fameux Tanezrouft, dont le nom, célébré par la littérature d’aventures, évoque les dangers, d’ailleurs réels, qui y menacent le voyageur.
C’est le pays de la peur et de la soif, le premier de ces maux résultant surtout, sans doute, du second, du moins à l’époque actuelle, car les rezzous de pillards y sont moins à craindre qu’autrefois, tandis que le péril de ne pas trouver de points d’eau y demeure certain, comme on va bientôt le voir.
à suivre
n° 384 du 6 janvier 1927 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs